C’est un raisonnement, un fait ou un exemple destiné à prouver ou justifier une affirmation ou une proposition quelconque. Il doit répondre à une problématique précise et être opératoire. Il faut ici distinguer l’argumentation rhétorique et l’argumentation philosophique : l’argument rhétorique a pour vocation de convaincre et persuader, y compris lorsqu’il prétend démontrer, alors que l’argument philosophique, même lorsqu’il prétend justifier une proposition, a principalement pour vocation d’approfondir, de mettre au jour la pensée. L’argument philosophique convoque un ou des concepts susceptibles de rendre compte de la nature d’une idée ou d’un jugement, de sa légitimité, de son fondement ; en ce sens, il doit établir du lien et clarifier un contenu, permettant à la pensée de se construire et s’élaborer.
Dans l’argumentation philosophie, la finalité est principalement de rendre consciente une pensée particulière : d’articuler ses concepts, son axiologie, sa démarche intellectuelle, sa genèse, de rendre visibles ses présupposés, etc. Pour ce faire, la clarté semble le critère premier, ce qui implique l’explicitation et la cohérence. Bien que périodiquement, le problème se posera de déterminer ce que l’on peut accepter comme donnée implicite, ou de dénoncer ce qui manque et devrait être explicité. Il n’est pas toujours facile de faire dire ce qu’elle dit à une idée, tout en évitant la surinterprétation. En ce sens, la capacité critique est nécessaire à l’argumentation, comme outil d’évaluation de l’argument. Le terme « critique » est repris ici dans son sens original : celui de séparer, de discriminer. Il ne s’agit donc pas de toujours trouver quelque chose à redire – ce n’est pas avoir l’esprit de contradiction – mais de savoir distinguer. Pour examiner l’argumentation, nos nous référons principalement au principe de critique interne, selon Hegel. Ce n’est pas la critique externe qui nous intéresse ici, où l’on propose de remplacer certains concepts par d’autres qui nous semblent meilleurs, moralement ou épistémologiquement. La critique interne consiste à évaluer la clarté et la cohérence, la pertinence, la force ou la faiblesse des conclusions et des arguments, de distinguer les concepts entre eux, les formes entre elles, etc… La valeur des arguments ne nous intéresse donc pas en terme de leur vérité intrinsèque, mais uniquement dans le rapport de cohérence qu’ils entretiennent avec la question et la réponse qu’ils doivent appuyer. Quand bien même a réponse sera considérée uniquement comme provisoire, elle exprimera tout de même le mode de penser qui l’a produite. Finalement, nous devons ajouter aussi le critère de la non répétition : bien souvent, au cours d’une discussion ou d’un écrit, les idées se répètent, directement ou par le biais d’une reformulation, ce qui tend à entraîner une certaine confusion. Il s’agit donc de repérer toute répétition à l’identique afin d’assurer la production de nouveaux concepts et hypothèses.
Quels que soient les divers critères d’évaluation d’arguments que nous proposons dans cet article, il ne sera pas toujours évident de déterminer la validité ou non des arguments rencontrés. Il s’agira toujours de produire un jugement singulier, parfois rapide, parfois hésitant, car la ligne rouge entre un argument acceptable ou non n’est pas clairement défini. Nous en prenons pour preuve les arguments faibles, qui à la fois son des arguments sans l’être : ils le sont par degré, et il ne sera pas toujours facile de trancher entre l’acceptation et le refus. Après analyse, ce jugement renverra toujours à des présupposés qui pourront être considérés contestables, et à l’expression d’une subjectivité. Le travail d’interprétation et d’évaluation de l’interprétation sera inévitable, et posera problème. C’est là que le travail de groupe s’avèrera utile, afin d’envisager les diverses possibilités de réception du problème, à travers l’élaboration de différentes matrices conceptuelles. La question restera de savoir dans quelle mesure une position devra s’imposer ou non, dans quelle mesure une interprétation aura plus de valeur qu’une autre, ou s’il s’agira tout simplement de les renvoyer dos-à-dos.
Nous devons néanmoins admettre aussi un choix pédagogique et épistémologique qui a été le nôtre : celui d’inclure le travail de la réponse – ou de la conclusion – dans celui de l’argumentation. Expliquons-nous. En général, une idée ne surgit pas seule : elle survient en réponse à un problème, qui se pose à l’auteur de l’idée ou à une tierce personne. S’il est besoin d’argumenter, c’est que nous pensons que notre idée ne va pas de soi, sans quoi nous n’éprouverions guère le besoin d’argumenter. En général, une argumentation est composée d’une conclusion et d’éléments de preuve que l’on nomme arguments. il peut y avoir un ou plusieurs arguments qui constituent les raisons d’accepter la conclusion qui a été énoncée. Aussi, afin d’inclure le problème de l’argument dans son cadre, pour en simplifier et en clarifier le fonctionnement, nous avons opté pour la structure générale suivante : une question, ce qui pose problème, une réponse, ce qui conclut ou positionne, et l’argument, ce qui soutient le positionnement ou la conclusion. Il nous semble donc que tout argument s’inscrit nécessairement dans un contexte réductible à une telle forme : question, réponse, argument. Bien entendu, le couple « réponse et argument » n’a pas nécessairement valeur de certitude, contrairement à une opinion répandue.
La nécessité de ce deux éléments pour constituer une « véritable réponse » implique les deux postulats philosophiques suivants. Premièrement, un positionnement n’est pas en soi une réponse adéquate, car nous ignorons quel est son sens, quel est son origine, aussi ce positionnement a-t-il besoin d’un argument pour lui fournir de la substance. Deuxièmement, un argument qui n’est pas précédé d’un positionnement ne peut pas avoir de sens en tant qu’argument : puisqu’un argument doit soutenir une position, cette dernière se doit d’être déterminée, claire et précise. Ce choix de présupposé que nous avons élu pourra paraître téméraire ou biaisé en un premier temps, mais le lecteur s’apercevra que bien que réducteur, il reste assez opératoire. Car si les réponses non argumentées sont monnaie courante au quotidien, les argumentations sans positionnement le sont tout autant, qui se cachent généralement dans la confusion du discours prolifique. À quoi servirait d’argumenter si nous ne soutenions rien ? Il s’agirait sans doute d’explications, mais pas d’argumentation, erreur tout à fait courante au demeurant. L’argument a des exigences que l’explication ignore.
Si l’on désire établir une grille simple d’évaluation des réponses et arguments, nous proposons les critères suivants :
1 – Clarté de la réponse
2 – Pertinence de la réponse
3 – Existence d’un argument
4 – Pertinence de l’Argument
5 – Force ou faiblesse de l’argumentation
6 – Pluralité ou répétition des idées. (En cas de pluralité des réponses et des arguments)
C’est dans le but de ce travail critique que nous avons tenté de mettre au jour différents types d’erreur argumentative. Pour cela, il est nécessaire d’expliciter la nature de l’argument et d’exposer sa pluralité de forme. Pour cela, rappelons-nous d’abord que l’argumentation est censée adresser des problèmes, afin de les approfondir, de les clarifier, de les traiter, voire de les résoudre. Elle produira donc des concepts, non pas pour les définir mais pour les rendre opérationnels.
Un argument peut être un fait établi ou une démonstration logique, il peut être de forme subjective ou objective : le premier relèvera plutôt de choix personnels, le second aura certaines prétentions à déterminer la réalité. Néanmoins, l’argument n’ayant pas à relever d’une quelconque certitude, il peut être une supposition ou une spéculation, voir un espoir ou une crainte qui sert de motivation, voire une condition. Bien entendu, l’intérêt ou la force de l’argument variera selon la fiabilité et la nature de son contenu,
Les arguments peuvent être de types très divers : moral, pratique, psychologique, intellectuel, logique, factuel, etc.
Voici quelques brefs exemples de ces divers cas de figure.
(Ces arguments sont parfois incomplets car ils servent uniquement à montrer le registre argumentatif.)
Question : Devrais-tu entre entreprendre cette action ?
Argument moral : Non, parce qu’il n’est pas moral d’agir sans se soucier du bien-être de la société.
Argument pratique : Non, je devrais m’entraîner trop longtemps pour la réussir.
Argument psychologique : Non, car je n’en ai pas du tout envie.
Argument intellectuel : Non, car il est prioritaire de se consacrer à la recherche.
Argument logique : Non, car une telle action est dépourvue de sens.
Argument factuel : Non, car jamais personne n’a réussi à mener à bien une telle action.
Dans les formes d’argumentation, on peut utiliser soit l’intention d’une proposition, soit les conséquences de cette proposition, soit des concepts abstraits, soit des exemples, soit encore des principes généraux. Ceci ne prétend pas épuiser l’étendue des formes : il s’agit seulement d’en montrer la pluralité.
Voici quelques exemples brefs de ces divers cas de figure.
(Ces arguments sont parfois incomplets car ils servent uniquement à montrer le registre argumentatif.)
Question : Devrais-tu entre entreprendre cette action ?
Argument portant sur l’intention : Oui, car le but de cette action est très noble.
Argument portant sur les conséquences : Oui, car une telle action améliorera la manière de fonctionner du groupe.
Argument utilisant des concepts abstraits : Oui, car cette action implique de la générosité.
Argument utilisant des exemples : Oui, car on observe la nécessité de cette action dans le domaine politique.
Argument portant sur des principes généraux : Oui, car tout ce qui peut faire bouger les choses est bien en soi.
Autre point posant problème dans la structure d’un argument : les connecteurs. Comme nous l’avons proposé ci-dessus, l’existence d’un argument doit s’inscrire dans la forme générale : problème, positionnement, argument. De manière générale, le lien entre le positionnement et l’argument, entre la réponse proprement dit et l’argument, s’établit par un connecteur. Le plus courant est « parce que », ou bien « car ». Ils indiquent tous deux un lien logique de causalité, puisque l’argument entraîne théoriquement le positionnement qu’il vient soutenir. La forme générale reste « c’est à cause de ceci » que « cela se passe ». Néanmoins, d’autres formes structurelles sont possibles dans la la mesure où elles sont réductibles à celle que nous venons d’énoncer. Par exemple l’inversion syntaxique : argument puis positionnement, qui sera introduite par exemple par le terme « comme ». D’autres connecteurs sont possibles, qui implicitement peuvent exprimer le « parce que » : la virgule en est un exemple, il en est d’autres, parfois un peu alambiqués, qu’il s’agira de décrypter pour clarifier l’énoncé. Le « sinon » en est un cas intéressant : il utilise l’évitement ou la négation comme outil d’argumentation : la raison d’être d’une idée ou d’un acte est la menace de ce qui se passerait si cette idée ou cet acte n’était pas mis en place.
Néanmoins, une mention particulière doit être effectuée à propos d’un argument qui pose régulièrement problème : l’argument conditionnel. On le reconnaîtra par exemple à l’utilisation des connecteurs suivants : « quand », « lorsque », « à condition », « dès lors que », « si », etc. Il est hypothétique et non pas catégorique. C’est un argument qui est valide dans certaines circonstances, uniquement dans certain cas, ce qui ne le prive guère de son statut d’argument, puisqu’il vient soutenir une position, aussi conditionnée et hypothétique soit-elle. La condition participe de la cause de la décision, ou détermine la cause de la décision.
Exemple : Est-ce bien ou mal pour un enfant de désobéir aux adultes ?
C’est bien lorsque c’est un ordre qui est contraire à la morale ou à la raison.
L’argumentation donne à la fois le cadre ou la condition du « pourquoi c’est bien de désobéir », et ce cadre/condition coïncide avec la raison de désobéir.
Bien entendu, la condition énoncée dans l’argument se devra de respecter les données du problèmes, afin de ne pas devenir un argument contradictoire. De la même manière, il devra autant que faire se peut ne pas être trop exceptionnel ou extraordinaire, afin de ne pas devenir un argument faible ou une hypothèse gratuite. L’argument de « l’homme totalement seul sur une île déserte », est le grand classique de ce type d’argument ou de condition : personne n’a jamais rencontré cet individu, à part dans son imagination. Même Robinson Crusoë a rencontré Vendredi…
II/ Les erreurs d’argumentation
Dans cet article, nous avons tenté de recenser les erreurs courantes d’argumentation philosophique. Les catégories que nous avons identifiées ne sont pas produites pour séparer radicalement les différents types de propositions irrecevables ou fragiles afin de les classer formellement, mais uniquement pour aider à percevoir les types de problème rencontrés dans l’argumentation et à les comprendre. Ceci implique qu’une même erreur peut parfois recouper deux ou trois catégories différentes, l’important pour le lecteur étant d’apprendre à reconnaître ces divers problèmes. Le but n’est donc pas d’apprendre à classifier les problèmes, la classification est uniquement un outil de compréhension, et de développement de la pensée.
1) Absence d’argument
2) Argument non pertinent
3) Argument indifférencié
4) Argument incomplet
5) Argument contradictoire
6) Glissement de sens
7) Faux argument
8) Tautologie
9) Rejet du problème
10) Argument interrogatif
11) Indétermination du relatif
12) Argument de conviction
13) Argument illogique
14) Fausse évidence
15) Argument faible
1)ABSENCE D’ARGUMENT
Proposition qui n’est appuyée par aucun concept complémentaire qui viendrait la soutenir. Lorsqu’il s’agit d’une réponse à une question, la réponse contient uniquement les termes de la question ou bien une reformulation de cette dernière.
Exemple: Le professeur dit qu’il ne faut pas couper la parole aux autres, mais elle coupe souvent la parole aux élèves. A-t-elle plus le droit que nous de couper la parole ?
— Non, car si nous n’avons pas le droit, elle non plus.
La formulation reprend uniquement les éléments de la question : aucun concept n’est fourni qui justifierait l’absence de droit particulier du professeur. L’argument exprime une égalité implicite, mais non articulée ni justifiée.
Exemple acceptable : Le professeur dit qu’il ne faut pas couper la parole aux autres, mais elle coupe souvent la parole aux élèves. A-t-elle plus le droit que nous de couper la parole ?
— Non, car les adultes n’ont pas tous les droits : si le professeur enseigne quelque chose, il doit déjà nous montrer l’exemple.
L’argument est acceptable car l’absence de droit absolu du professeur est justifié par un principe pédagogique : « il faut montrer l’exemple ».
Exemple: Dois-je aider une personne qui ne veut pas que je l’aide ?
— Non, car je n’aide pas les personnes qui ne veulent pas de mon aide.
La formulation reprend uniquement les éléments de la question : aucun concept n’est fourni.
Exemple: Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour ne pas blesser.
— Non. Ce n’est pas une bonne raison car même si cela blesse, il faut toujours dire la vérité.
Le connecteur « même si », qui indique l’opposition concessive, sert à montrer la radicalité de la proposition sans fournir d’argument ; on pourrait dire qu’il représente uniquement un effet rhétorique : il insiste pour renforcer l’affirmation, mais ne fournit aucun concept.
2)ARGUMENT NON PERTINENT
C’est un argument qui utilise des concepts qui ne relèvent pas du tout de la proposition énoncée. On ne voit pas le rapport entre l’argument et l’idée qu’il vient soutenir.
Exemple:
Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? La loi nous y oblige.
— Non, car si on me disait qu’il faut que je parte loin d’ici à 18 ans, je ne le ferais pas.
Il s’agit de « croire » et non pas de « faire ». Ce sont deux problèmes différents. L’argument n’adresse donc pas le problème soulevé. De plus, l’exemple répond , mais il n’argumente pas.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? La loi nous y oblige.
— Oui, si on a l’intention de respecter la loi. Non, si la loi nous oblige à une absurdité.
L’argument du oui » n’est pas pertinent, car il s’agit de » respect », ce qui n’a rien à voir avec « croire ». Mais l’argument du « non » est pertinent, car l’absurdité est en effet une raison de ne pas croire, de ne pas adhérer à une loi. Néanmoins, il aurait été utile d’expliciter le problème.
Exemple:
Je n’ai pas le droit de sortir toute seule. Est-ce juste ou injuste ?
C’est juste, car mes parents sont plus prudents que moi.
Le fait que « mes parents soient plus prudents que moi » ne prouve pas pourquoi il est juste que « je ne sorte pas seule » : sans quoi, toute personne devrait sortir avec quelqu’un de plus prudent. Ou alors, il faudrait expliciter en quoi « mon imprudence » nécessite la présence de « mes parents ».
Exemple acceptable: C’est juste, car je suis jeune, et donc plus vulnérable aux dangers extérieurs, et un enfant fait moins attention qu’un adulte.
L’argument est pertinent car il adresse le problème de l’injustice en expliquant que la jeunesse est « plus vulnérable » par ce qu’elle « fait moins attention ».
Exemple: On t’offre une bague qui te rend invisible. Tu es au magasin. En profites-tu pour prendre ce qui te plaît ?
Je préfère surveiller le magasin que prendre ce qui me plaît.
Le désir de surveiller le magasin ne vient en rien justifier le fait que je ne prenne pas ce qui me plait. Car je pourrais faire les deux à la fois : surveiller et voler.
Exemple acceptable : Non, parce que si je prends ce que je veux, je vole. Et je ne dois pas profiter de ma situation pour enfreindre la loi.
L’argument est pertinent parce qu’il qualifie le geste : c’est du « vol », et explique que ce geste signifie « enfreindre la loi ».
Quelques types d’arguments non pertinents courants
Argument émotionnel
Exemple:
Je ne veux pas mettre cette robe ? Je la mets tout le temps !
— Il y a des enfants qui n’ont aucun vêtement à se mettre, et qui seraient bien contents d’avoir cette robe.
Le fait que « des enfants n’aient pas de vêtements » ne justifie en rien qu’il faille mettre cette robe. Ou alors il faudrait expliquer le lien, par exemple celui de l’humilité : « Savoir que certains enfants n’ont rien à se mettre devrait t’inviter à être plus humble et moins soucieuse de ton apparence ». Sans cela, il s’agit uniquement d’un recours à la pression émotionnelle.
Argument du « un prêté pour un rendu »
Exemple:
Sors de la salle de bains ! Il faut que je parte au collège ! Je vais être en retard.
Dis donc, toi tu prends tout ton temps quand tu te pomponnes !
Le fait qu’une personne fasse une erreur ou commette une faute ne justifie pas en soi l’erreur ou la faute d’une autre personne.
Inversion causale
Exemple :
Pourquoi as-tu frappé ton frère ?
Parce qu’après, lui aussi il m’a frappé.
La conséquence imprévisible d’un geste ne peut pas justifier ce geste, sauf si cette conséquence était voulue. Au moment où il a frappé son frère, il ne savait pas que celui-ci allait le frapper : ce retour des choses n’était pas le but de l’acte. Cette erreur peut aussi être considérée comme un argument incohérent.
3) ARGUMENT INDIFFÉRENCIÉ
Argument utilisé pour justifier un choix dans une alternative (oui ou non, a ou b), qui pourrait néanmoins être utilisé de manière équivalente pour justifier la proposition opposée. Il n’est pas opératoire, puisqu’il peut être utilisé indifféremment dans un sens ou dans un autre.
Exemple:
En cas de danger extrême, en priorité, te sauves-tu toi-même ou sauves-tu quelqu’un d’autre ?
Quelqu’un d’autre car je n’ai pas le temps de penser et j’agis sans penser.
Le fait d’agir sans penser pourrait en soi tout aussi bien justifier le fait de « se sauver soi-même en priorité ». Ou alors il faudrait expliquer par exemple que l’altruisme est la réaction la plus immédiate en l’être humain.
Exemple: Est-il souhaitable ou non souhaitable d’aller à l’école ?
— Il est souhaitable d’aller à l’école pour se faire respecter.
On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas se faire respecter justement en n’allant pas à l’école. Ou alors il s’agit là d’une prise de position qui mériterait d’être explicitée, par exemple : « Celui qui va à l’école mérite le respect, car il apprend à travailler, au lieu de traîner dans la rue et de ne rien apprendre ».
Exemple: Est-on obligé de dire la vérité lorsque l’on a faim ?
— Non, car la personne aura pitié de nous.
Pourquoi la personne aurait pitié de nous si on lui dit que l’on a faim ? On peut imaginer qu’en exprimant sa faim, on fera « pitié », mais alors il faudrait expliquer pourquoi cette « pitié » empêche de dire la vérité. Sans quoi on pourrait aussi penser que la « pitié » joue au contraire en notre faveur.
4) ARGUMENT INCOMPLET
Argument dont l’énoncé va dans le sens d’une justification mais qui s’interrompt avant que l’énoncé soit complété. La fin de l’argument est implicite, on peut entrevoir son aboutissement, mais on ne peut pas le considérer comme achevé, car trop allusif, non articulé, ou en manque de clarification. Généralement, un concept supplémentaire serait nécessaire pour terminer la justification.
Exemple: Est-on obligé de dire la vérité lorsque la personne à qui l’on parle est malade ?
— Non, car cela peut la blesser et lui faire de la peine.
L’énoncé constitue l’ébauche d’un argument, mais reste trop général : on peut affirmer cette possibilité dans n’importe quelles circonstances. L’argument n’adresse pas précisément le problème. Il faudrait par exemple ajouter que la personne est fragilisée ou plus sensible à cause de la maladie.
Exemple: Est-on obligé de dire la vérité lorsque l’on risque d’être frappé ?
— Non, car les conséquences seront graves.
Il faut préciser de quelles conséquences il s’agit, quand bien même elles sont « graves ». Sans l’explicitation de leur gravité, l’argument est incomplet, même si l’on reprend les termes de la question, « le risque d’être frappé». Par exemple : « avoir très mal et être blessé ».
Exemple: Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? J’ai bien réfléchi.
— Non, car même si j’ai réfléchi ça peut être faux.
Il faudrait préciser en quoi ça peut être faux, sans quoi la possibilité semble trop gratuite ; par exemple : on peut avoir oublié des informations importantes.
Exemple: Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? C’est écrit dans les livres.
— Oui, si c’est dans des livres scientifiques.
La condition donnée est celle d’une catégorie d’ouvrages. Pour que l’argument soit complet, il faudrait expliquer en quoi le « scientifique » est plus fiable ; par exemple : c’est prouvé par des expériences.
Exemple :Faut-il toujours obéir aux parents ?
— Il faut obéir aux parents, parce que sinon on ferait n’importe quoi.
Qu’est-ce qui autorise à dire que l’on ferait n’importe quoi ? En quoi consiste ce n’importe quoi ? Ces éléments manquent à l’établissement d’un argument complet.
Exemple: J’ai vu mon pire ennemi voler l’argent de mon meilleur ami. Je sais qu’il a déjà reçu des avertissements, et que si je rapporte ce qu’il a fait, il sera renvoyé de l’école. Dois-je le dénoncer ?
— Oui, car c’est pas parce qu’il va être renvoyé de l’école que je ne le dis pas, ça pourra peut-être lui servir de leçon.
L’argument est acceptable, mais mériterait d’être explicité un peu : en quoi consisterait la leçon ? Par exemple pour apprendre à ne plus voler. On peut néanmoins considérer que c’est implicite.
Exemple :Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? La loi nous y oblige.
— Non, les lois n’ont pas le droit de nous forcer à y croire.
On ne comprend pas en quoi consiste ce « droit de nous forcer à y croire ». À nouveau, le lecteur peut imaginer diverses possibilités, mais cela n’est bien entendu pas suffisant : l’auteur doit expliciter sa pensée, par exemple en expliquant pourquoi les lois n’ont pas ce droit. Exemple : « Les lois peuvent nous obliger à faire quelque chose, mais elle n’ont pas le pouvoir de nous faire changer notre manière de penser ».
Exemple: Est-ce bien ou mal de ne rien dire ?
— C’est mal car ça dérange des personnes.
On ne sait pas en quoi le fait de « ne rien dire » dérangerait, ni en quoi ce dérangement serait « mal ».
5) ARGUMENT CONTRADICTOIRE
Argument dont les éléments utilisés ou invoqués sont contradictoires. Certains éléments viennent soutenir la proposition initiale, d’autres au contraire l’infirment. La forme la plus courante de l’argument contradictoire est le classique « oui, mais » : dans ce cas de figure, rien ne vient étayer le « oui », alors que l’argumentation du « mais » vient infirmer la réponse affirmative initiale.
Exemple: Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? C’est écrit dans les livres.
— Oui, ceux qui écrivent dans les livres sont des personnes cultivées
qui n’ont pas le droit d’écrire des contrevérités, sauf dans les romans ou les BD.
On répond par « oui » mais on explique aussi « pourquoi non », en l’introduisant pas le « sauf ». C’est le problème du « oui, mais » : on ne sait pas quel est le statut de cette exception, ni quel est son rapport à la réponse initiale. L’exception des « romans et BD » ne représente-t-elle pas une immense catégorie qui remet en cause la réponse initiale ?
Exemple: Je n’ai pas le droit de sortir toute seule. Est-ce juste ou injuste ?
— C’est injuste car on a grandi, on peut sortir tout seul maintenant.
Mais pour le soir on comprend qu’il ne faut pas sortir tout seul, ça peut être dangereux.
On ne sait pas vraiment pourquoi on peut sortir seul maintenant, le concept de « grandir » est vague, mais on ajoute pourtant immédiatement des raisons de ne pas le faire. Il s’agit d’étayer la réponse initiale plutôt que de vouloir trop vite aborder les exceptions.
Exemple: Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
— C’est de la lâcheté. Cela peut être légitime car au final l’intention est bonne.
La lâcheté a une connotation négative, on ne peut pas l’utiliser comme preuve de légitimité. La phrase suivante affirme que « l’intention est bonne » mais ne dit pas en quoi cette intention est bonne. Nous avons là deux idées inachevées qui se contredisent.
Exemple: Faut-il défendre la liberté d’opinion ?
— Tout le monde a le droit de penser ce qu’il veut. Par contre, il y a des pays où l’on est emprisonné si on pense le contraire de ce que le gouvernement veut.
L’auteur n’argumente pas sa réponse initiale, mais montre que l’idée n’est pas toujours appliquée. Il utilise un fait comme contre argument à sa propre proposition, ce qui ne constitue en rien une preuve et engendre de la confusion.
6) GLISSEMENT DE SENS
Argument dont le contenu se trouve en décalage par rapport à la proposition initiale : il s’est effectué un déplacement dans l’utilisation des concepts ou dans le sens de l’idée. Soit la relation est trop indirecte, soit l’écart est trop important, ce qui rend l’argument inadéquat.
Exemple: Est-on obligé de dire la vérité lorsqu’on a faim ?
— Oui, car il n’y a pas de honte à avoir faim.
Cela répond à la question : « Peut-on dire la vérité quand on a faim ? » et non pas « Doit-on dire la vérité quand on a faim ? ». De ce fait, le problème soulevé n’est pas traité.
Exemple: Je crois ce que je veux. Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ?
— Oui, parce que tout le monde peut croire ce qu’il veut.
La question demande si c’est légitime, l’auteur répond que c’est possible. La possibilité est un glissement courant, car elle offre une sorte de réponse minimale, alors que l’obligation est plus exigeante.
Exemple : Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour ne pas blesser.
— Ce n’est pas un mensonge, c’est plutôt de la pitié.
Confusion entre l’acte et sa finalité, ou entre l’acte et sa raison d’être. « La pitié » n’indique pas si c’est un mensonge ou pas, pas plus qu’elle ne s’oppose au mensonge : elle indique pourquoi on dit ce qu’on dit. De plus, ni le mensonge, ni la pitié ne sont en soi légitime ou illégitime : il s’agirait de clarifier et d’expliciter ce parti pris.
Exemples : Pourquoi lui as-tu donné une claque ?
Ce n’était pas une claque, je ne l’ai pas fait exprès.
Ce n’était pas vraiment une claque, ça ne lui a même pas fait mal.
C’était à peine une claque, ce n’était pas très fort.
Une des diverses manières de gommer l’acte, c’est de glisser de l’acte en soi vers la motivation, vers l’intention, vers l’effet, en utilisant la quantité : un peu, pas fort, ou bien en créant des circonstances atténuantes. Gommer l’acte en le dénaturant sert à le justifier, par un processus de réduction, de dilution, de redescription.
7) FAUX ARGUMENT
Proposition qui n’est justifiée par aucun concept complémentaire. Certains termes sont rajoutés à la proposition ou réponse initiale, parfois cela peut prendre la forme d’un argument grâce à des connecteurs appropriés, sans pour autant produire de véritable sens. Il s’agit généralement d’un alignement de mots ayant parfois une valeur phatique ou rhétorique, parfois tout simplement hors sujet.
Exemple: Le professeur dit qu’il ne faut pas couper la parole aux autres, mais elle coupe souvent la parole aux élèves. A-t-elle plus le droit que les élèves de couper la parole ?
— Non, car les élèves, eux, doivent lever le doigt pour parler.
Le fait que « les élèves doivent lever le doigt » pour parler ne prouve en rien que l’enseignante a le droit ou pas de « couper la parole ». Rien ne vient justifier l’absence de légitimité : on décrit ce qui se passe déjà, au lieu d’émettre un jugement sur ce qui se passe.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? C’est écrit dans des livres.
— Généralement, les livres ne mentent pas. Alors on peut croire les livres. Et si on n’est pas sûr, on peut toujours vérifier.
On ne sait pas pourquoi il faudrait croire les livres, ni d’où sort l’idée qu’ils ne mentent pas. L’idée de « pouvoir vérifier » ne change strictement rien au problème de savoir si on peut faire confiance ou non aux livres, et donc ne constitue en rien un argument.
Exemple : Est-ce que ce qu’il dit est vrai ?
C’est vrai parce que je pense la même chose depuis toujours.
C’est vrai, je te jure que c’est la vérité.
Le fait de « penser la même chose depuis toujours » ne vient en rien appuyer une idée, sinon de façon purement psychologique, mais non épistémique, comme il se doit. Le fait de jurer n’indique qu’une certaine sincérité ou un désir de convaincre.
8)TAUTOLOGIE
Proposition qui prétend justifier une réponse ou une idée en répétant à l’identique ou en reformulant sous d’autres termes cette réponse ou cette idée. Aucun nouveau concept n’est fourni, ni pour justifier, ni pour expliquer : l’argument reprend seulement la proposition initiale.
Exemple: Faut-il toujours être poli ?
— Oui, c’est une question de politesse.
On ne peut justifier le fait d’être poli par la politesse : c’est une reformulation de la réponse initiale « oui » en reprenant les éléments de la question.
Exemple: La loi nous y oblige. Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ?
— Oui, parce qu’on est bien obligé.
La transformation de l’obligation, de la forme active à la forme passive, est une simple reformulation de la réponse initiale « Oui ».
Exemple: Es-tu toujours toi-même si tu changes de culture ?
— Oui, car le changement de culture ne modifie en rien le soi-même.
Reformulation de la réponse en une phrase complète, mais aucun argument, aucun nouveau concept n’est fourni : il s’agit d’une reprise des termes de la question.
9)Rejet du problème
Réponse ou argumentation qui ne prend pas rigoureusement en charge la formulation du problème, en prétextant de manière explicite ou implicite un désaccord avec les données du problème. Ce désaccord s’exprime soit dans la réponse initiale, soit dans l’argument qui vient soutenir la réponse initiale, au risque d’engendrer des incohérences.
Exemple: Es-tu toujours toi-même si tu changes de métier ?
— Non, car je n’en ai pas.
Rejet de la question hypothétique en alléguant une situation personnelle. De ce fait l’argument est hors sujet.
Exemple : On t’offre une bague qui te rend invisible. Tu es au magasin. En profites-tu pour prendre ce qui te plaît ?
— Non, car ça n’existe pas.
Rejet de la question hypothétique en alléguant l’inexistence de son objet. De ce fait l’argument est hors sujet.
Exemple: Si Spiderman est un être humain, alors il mourra un jour. Est-ce logique ?
— Ce n’est pas logique, car Spiderman n’existe pas.
Invocation abusive de la logique, car il s’agit plutôt d’une opinion, aussi légitime soit-elle. Rejet de la question hypothétique introduite par le « si », en alléguant l’inexistence de l’objet traité. De ce fait l’argument est hors sujet.
Exemple acceptable : Les martiens peuvent-ils débarquer sur terre demain ?
Non, car ils n’existent pas : personne n’en a jamais vu.
L’argument est acceptable, car le présupposé de l’existence des martiens n’est pas inclus dans l’énoncé du texte. Et leur non-existence justifierait leur non-débarquement.
Exemple:
En cas de danger extrême, en priorité, te sauves-tu toi-même ou sauves-tu quelqu’un d’autre ?
Les deux à la fois, car je sais bien nager.
Le problème moral présenté n’est pas traité : le choix demandé n’est pas effectué, de plus, il dérive sur un problème de compétence physique.
Exemple:
Préfèrerais-tu être riche ou célèbre ?
Ni l’un ni l’autre, parce que c’est le bonheur qui compte.
Le problème existentiel présenté n’est pas traité : le choix demandé n’est pas effectué. Une tierce proposition est utilisée en guise d’argument.
10)ARGUMENT INTERROGATIF
Utilisation d’une question en guise de justification d’une proposition. Une telle question a en général pour fonction de renvoyer le problème à l’auteur de l’énoncé initial , de simplement évoquer la possibilité de la réponse proposée, ou bien de mettre en cause toute objection à la réponse proposée. Un tel argument est au mieux trop allusif, au pire non pertinent.
Exemple : Dois-je aider une personne qui n’aide pas les autres ?
— Non, car pourquoi s’embêter à aider un égoïste ?
La question n’est pas un argument, parce qu’on pourrait répondre en trouvant des raisons pour lesquelles on pourrait « s’embêter ». La question est trop ouverte, elle ne démontre pas, ou elle tente d’exprimer indirectement une affirmation comme réponse implicite ou évidente à la question. Elle a plutôt un effet rhétorique. De plus, il n’y a pas de concept suffisant pour répondre « non » à la question de « l’argument », alors que le « non » est implicite.
Exemple: Pierre te dit qu’il est menteur. Le crois-tu ?
Je ne le crois pas, car comment croire quelqu’un qui ment tout le temps ?
La question reste ouverte, elle ne démontre pas, n’argumente pas : elle demande un moyen, une manière. À moins de prendre cette question pour une affirmation déguisée en pensant qu’elle montre une impossibilité, ce qui serait un choix très spécifique méritant d’être étayé par quelque concept. De surcroît l’effet est plutôt rhétorique : aucun concept n’est fourni.
Exemple: Faut-il toujours dire la vérité ?
— Non, parce que quelle vérité ? Est-ce qu’on connaît toujours la vérité ?
Le fait de demander la nature de la vérité ou si on la connaît ne prouve rien. Les postulats implicites des questions devraient être énoncés et justifiés, par exemple l’impossibilité de connaître la vérité. Mais il faudrait aussi établir un lien avec l’obligation de « dire la vérité », sans quoi, nous aurions un glissement de sens nous entraînant vers un hors sujet.
11) INDÉTERMINATION DU RELATIF
Utilisation de termes relatifs : ça dépend, pas forcément, parfois, pas totalement, pas nécessairement… sans autre complément d’information qui permettrait de clarifier et comprendre les raisons et les conséquences de cette relativisation. Ces termes « indéterminés » sont périodiquement utilisés de manière inadéquate comme réponse ou comme argument. Lorsqu’ils sont utilisés en guise de réponse, ils sont souvent utilisés pour ne pas répondre à la question posée.
Exemple: Est-on obligé de dire la vérité lorsqu’on vient de mentir ?
— Non, tout dépend du pourquoi du mensonge.
On peut comprendre que l’obligation de dire ou non la vérité dépende de la raison du mensonge, mais il s’agirait de donner sens à cette relativité en expliquant quels types de motivations ou quel exemples obligeraient ou non à dire la vérité.
Exemple: Est-ce bien ou mal de se venger ?
— Ça dépend comment on se venge.
La dépendance du mode de vengeance demande à être expliquée pour savoir de quoi l’on parle ; sans cette précision, l’idée est creuse.
Exemple: Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? Je crois ce que je veux.
—: C’est une bonne ou mauvaise raison, ça dépend pour qui.
En s’exprimant ainsi, on ne sait aucunement faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Il s’agit là, d’un relativisme radical qui n’est ni expliqué, ni justifié.
12 – Argument de conviction
Proposition qui énonce un simple état subjectif n’offrant aucune preuve ou fondement pour soutenir la réponse initiale tout en prétendant le faire. Il s’agit en général de l’expression d’une certitude ou d’un doute, ou encore d’une attestation formelle et emphatique quant à la vérité ou à la fausseté d’une réponse. Ce type d’argumentation relève plutôt de la rhétorique, puisqu’il s’agit de faire partager sa conviction pour persuader autrui.
Exemple : Qui a pris mon stylo ?
— C’est Pierre. Je suis certain que c’est lui.
Il s’agit de l’argument de la sincérité : prétendre justifier une proposition en attestant de sa propre conviction. Ce type d’argument sera en général introduit par des expressions subjectives, comme « Je te promets que.. », « Je te jure que… », « Je t’assure que.. », « Je suis certain que… » et parfois des expressions objectives : « Il est certain que… », « Il est sûr que… ». On y utilise aussi des adverbes de conviction : honnêtement, franchement, sincèrement, vraiment… Tous ces termes n’ont de valeur que rhétorique, ils ne fournissent aucune preuve, ils assurent et rassurent : la sincérité du locuteur est censée emporter l’adhésion de l’auditeur.
Exemple: Penses-tu que Yann a raison quand il dit que ce médecin n’est pas compétent ?
— Oui, parce que j’ai exactement le même avis sur la question.
Il s’agit de l’argument du sentiment personnel : prétendre justifier une opinion ou un jugement en attestant de son accord avec son contenu. C’est une sorte d’argument d’autorité où le locuteur valide une proposition en tant qu’autorité incontestable qui n’a nul besoin d’argumenter ou de fournir un quelconque contenu pour justifier sa position.
Exemple :Est-ce Pierre qui a pris mon stylo ?
Non, je ne suis pas sûre qu’il en soit capable.
Il s’agit de l’argument du doute : le fait que l’on doute d’une proposition ne montre en rien qu’elle est fausse, ni au demeurant qu’elle est vraie. L’expression d’un tel doute montre uniquement l’état d’esprit du locuteur, mais n’adresse pas du tout le problème posé. De surcroît, il n’est pas besoin d’être « sûr » pour répondre ou argumenter, puisqu’il s’agit toujours de pensée hypothétique. Dans le cas présent, cela pourrait devenir l’argument suivant, plus affirmatif : « Non, car il ne semble pas capable d’un tel geste. »
13) ARGUMENT ILLOGIQUE
Argument dont la construction transgresse certaines règles élémentaires de la logique. Par exemple l’inversion entre la cause et l’effet, les déductions invalides, les syllogismes mal construits, etc. Ces paralogismes peuvent se trouver à l’intérieur de l’argument, ou dans le rapport entre l’argument et la proposition qu’il vient soutenir.
Exemple: Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
— Non, parce que c’est de la méchanceté gratuite.
Il y a là une incohérence entre la réponse et l’argument. La question énonce l’on ne dit pas la vérité dans un but spécifique : « pour obtenir quelque chose », auquel cas l’acte n’a rien de gratuit.
Exemple : Comment sais-tu que Jean est chez lui ?
il est chez lui parce qu’il n’est pas à l’école.
Le fait de ne pas être à l’école n’implique pas nécessairement qu’il est à la maison, sauf si les données du problème le spécifient ainsi. Car il pourrait être dans bien d’autres endroits.
Quelques types d’arguments illogiques courants
Argument du contraire.
Exemple :Pourquoi dis-tu qu’il n’y a de la vie que sur terre ?
Il n’y a de vie que sur terre parce que personne ne peut prouver le contraire, et montrer qu’il y a de la vie ailleurs que sur la terre.
Cet argument erroné consiste à affirmer que le contraire d’une proposition n’est pas prouvé, ou ne peut pas être prouvé, en guise de preuve de cette proposition. Or cela déplace simplement la charge de la preuve sur le parti adverse, sans prouver quoi que ce soit.
Argument irrationnel
Exemple : Le professeur de mathématiques est-il un bon professeur ?
Non, parce que les maths, ça m’énerve.
Cet argument erroné utilise un argument subjectif pour valider une déclaration objective n’ayant pas de surcroît de lien causal entre eux. Dans un cas il s’agit du professeur, dans l’autre la matière.
Inversion logique
Exemple : Pourquoi cette personne est-elle ton amie ?
C’est mon amie parce que nous sommes toujours ensemble.
Cet argument erroné commet une inversion entre la cause et l’effet, la cause et le symptôme, la cause et les conséquences. On est ensemble parce que l’on est ami, et non l’inverse. Le fait d’être toujours ensemble n’est ni la cause, ni l’explication de l’amitié : cela constitue à la rigueur la preuve de cette amitié, ou sa manifestation : c’est comme cela que l’on peut reconnaître cette amitié.
Réaction défensive
Exemple : Pourquoi as-tu cassé ce pot.
Mais je ne l’ai pas fait exprès.
La réponse ne traite pas du tout la question demandée, elle tente uniquement de se dégager de toute responsabilité en protestant de l’absence de mauvaise intention. L’utilisation du « mais » indique déjà le refus de répondre. Le fait de « ne pas le faire exprès », de nier l’intention, ne justifie rien. L’argument aurait pu être : « J’étais trop pressé », ou bien « Je ne faisais pas attention », etc.
14) FAUSSE ÉVIDENCE
Proposition qui considère comme indiscutable un principe général, un lieu commun, ou un propos banal, justifié d’emblée par leur apparente évidence, laquelle relève en fait de la prévention, du préjugé ou de l’absence de réflexion. Ces propositions seront parfois introduites par des termes comme « normalement », ou des expressions comme « tout le monde sait que ».
Exemple: Faut-il obéir à ses parents ?
— Il faut obéir aux parents car on sait qu’ils nous mènent sur la bonne voie.
« On sait » n’est pas en soi un argument, il faudrait clarifier ce qui fait dire « qu’ils nous mènent sur la bonne voie », par ex. parce qu’ils ont une expérience de la vie. Le « savoir commun » ou le « bon sens commun » ne constituent pas en soi des arguments.
Exemple: Je ne regarde jamais la télé quand je veux. Est-ce juste ou injuste ?
— C’est injuste car tout le monde, normalement, a le droit de regarder la télé quand il veut.
On ne sait pas de quelle « norme » il s’agit, ni ce qui la justifie. Au mieux, il s’agit d’un état de fait, d’une pratique courante, ce qui ne justifie en rien la justice ou l’injustice d’un fait.
Exemple: Faut-il obéir à ses parents ?
— Oui, parce que c’est plus raisonnable
On ne sait pas ce que signifie ce « raisonnable », ni ce qui justifie ce qualificatif. Cette affirmation paraît « sensée » mais en fait elle ne dit rien.
Exemple: Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
— C’est de l’hypocrisie. Ce n’est pas légitime car cela fait du tort à l’autre.
Le fait de qualifier l’acte par un terme ayant une « connotation négative » ne suffit pas à montrer que ce n’est pas bien : il faudrait montrer en quoi cette hypocrisie n’est pas légitime. Et si elle « fait du tort à l’autre », il s’agit d’expliquer de quelle manière.
15) ARGUMENT FAIBLE
Proposition qui a la forme et la valeur d’un argument, mais dont le contenu reste en deçà par rapport à la proposition qu’il prétend étayer. La faiblesse de cet argument peut relever d’un problème de proportion ou de probabilité, d’une légitimité fragile ou de l’utilisation abusive des circonstances. Il tend à ne pas aller à l’essence des choses.
Exemple: Faut-il respecter ses camarades ?
— Non, parce qu’ils m’agacent.
Cet argument, plutôt irrationnel, utilise la subjectivité comme une réponse à un problème moral. Cela est dans l’absolu toujours possible, mais reste un argument pauvre, tout en s’approchant de l’argument irrationnel ou illogique.
Exemple : L’être humain est-il bon ?
Oui, les gens de ma famille s’aident tous les uns les autres.
S’il s’agit de qualifier l’humanité, on en peut pas tirer des conclusions à partir des quelques membres d’une famille. Cela relève presque de la généralisation abusive, bien que l’exemple aille déjà dans le sens d’une preuve pertinente.
Quelques types d’arguments faibles courants
Argument du précédent
Exemple : Pourquoi penses-tu que ce garçon est celui qui a volé ta montre ?
Parce c’est un voleur : il s’est déjà fait attrapé une fois.
Certes, le fait « d’être un voleur » peut être un argument pour prouver qu’une personne a volé, au niveau de la probabilité tout au moins. Mais cela reste un argument faible : car être un voleur n’est pas une « essence », un voleur ne vole pas tout le temps, certains voleurs ont arrêté de voler, il existe plus d’un voleur, il existe des voleurs qui volent tellement bien qu’on ne sait pas qu’ils volent, etc. Il s’agirait donc de produire un argument plus spécifique, traitant du cas spécifique en question : le problème de la montre volée. D’autre part, on peut considérer que d’avoir été attrapé une seule fois à voler ne suffit pas à qualifier quelqu’un de voleur.
Hypothèse gratuite
Exemple: T’es-tu préparé pour le contrôle de maths ?
Non, parce qu’on ne sait jamais, la prof sera peut-être malade.
Il s’agit de l’argument du simple possible, qui consiste à utiliser comme justification quelque chose qui n’est simplement qu’une éventualité, sans raison particulière de probabilité. Le fait que cela peut être vrai renvoie à un espoir plutôt qu’à une raison, sans toutefois en être conscient et l’avouer. On pourrait aussi nommer cela : prendre ses désirs pour des réalités. Bien que dans l’absolu, un tel argument puisse être une raison d’agir, très subjective, tout à fait commune.
Généralisation abusive
Exemple : Pour quoi penses-tu que c’est ce garçon qui a volé ?
Parce son copain est aussi un voleur.
Le fait d’appartenir à un groupe donné ou d’avoir des relations avec quelqu’un ne constitue pas un argument solide pour justifier une accusation ou une qualification. Sauf si cette qualification fait partie de la « nature» de ce groupe ou de cette relation : dans ce cas, il faudrait étayer cette qualification globale. Néanmoins, le « qui se ressemble s’assemble » reste formellement un argument acceptable.
Argument de l’habitude
Exemple: Et pourquoi dois-je aider à mettre la table ?
— Parce que les enfants ont toujours aidé leurs parents, et on ne va pas changer le monde du jour au lendemain.
Invoquer une tradition, une coutume ou une habitude en guise d’explication. Cela n’explique ni ne justifie que très superficiellement la valeur ou le sens d’un acte ou d’une idée.
Alibi des circonstances
Exemple : Pourquoi n’as-tu pas fait ton travail ?
— Parce que j’avais beaucoup de choses à faire.
Bien que l’on comprenne les circonstances et la difficulté qu’elles posent, cela n’explique pas pourquoi le travail n’a pas été fait. En effet, il faudrait rendre compte du choix qui a donné priorité à d’autres activités parmi ces nombreuses « choses à faire ». Les circonstances peuvent avoir une valeur atténuante ou aggravante, mais elles ne modifient pas l’acte, la raison de l’acte en soi ou la responsabilité de cet acte.
Alibi d’autrui
Exemple : C’est injuste que je sois punie pour avoir parlé en classe. Parce que ce n’est pas de ma faute, c’est ma voisine qui me demande tout le temps quelque chose.
Il s’agit de renvoyer la cause et la responsabilité de nos actes sur une tierce personne. Certes il n’est pas facile de ne pas parler si autrui nous parle, mais on peut envisager diverses manières de résoudre ou prévenir ce problème si nous le voulons. Autrui n’est en cela qu’une cause secondaire, ou une cause efficiente : il ne peut servir pour nier notre part de liberté et de responsabilité.
Argument d’exagération
Exemple: Et pourquoi devrais-je faire mes devoirs ?
— Si tu ne fais pas tes devoirs, tu auras une mauvaise note, tu ne pourras pas aller au lycée plus tard, et tu deviendras une clocharde.
Il s’agit de forcer le trait sur la description d’un acte, ses implications ou ses conséquences, afin de persuader autrui. Si ce type d’argument peut avoir un impact sur le plan des émotions, il est pauvre sur le plan de la raison, en raison de sa nature excessive et caricaturale. C’est ainsi que l’on justifie couramment un point de vue en exagérant le point de vue adverse qui en devient ridicule ou absurde.
Argument minimaliste
Exemple: Doit-on obéir à ses parents ?
— Non, car on a bien le droit de faire ce que l’on veut.
Il s’agit de l’argument minimaliste : produire un argument trop général car utilisable dans des situations trop diverses. De ce fait, il ne traite pas la spécificité du problème posé. De surcroît, il est facilement critiquable à cause d sa généralité : il est facile de prouver que l’on n’a pas toujours le droit de faire ce que l’on veut. C’est le cas des arguments « bateau » qui explique tout, tels que le « je n’ai pas envie » ou le « il est paresseux ».
Argument d’autorité
Exemple: Pourquoi dis-tu cela ?
— Parce que Kant l’a prouvé.
Il s’agit de l’argument d’autorité : utiliser le nom, la fonction ou le titre d’une personne pour justifier une pensée ou un acte. Au mieux, l’autorité invoquée a une compétence en la matière et peut constituer une référence, au pire, elle n’en a aucune et l’argument est absurde, bien que très utilisé pour convaincre, en particulier dans la publicité. Le problème principal est que ce type d’argument ne fournit aucun contenu.
Argument de la personne
Exemple : Pourquoi penses-tu que cette idée est mauvaise ?
— Parce que celui qui l’a dit est un idiot.
Il s’agit de réfuter une idée en disqualifiant son auteur. C’est l’inverse de l’argument d’autorité. Or rien n’empêche une personne idiote d’avoir une bonne idée, ne serait-ce que par accident. Ce type d’argument trouve une certaine valeur lorsque des compétences sont impliquées, liées à une fonction par exemple : les conseils médicaux d’une personne qui n’est pas qualifiée en médecine. Le problème reste néanmoins que ce type d’argument est dépourvu de contenu.
Alibi du nombre
Exemple : Pourquoi n’es-tu pas venu hier ?
Parce que les autres non plus ne venaient pas.
Il s’agit de l’argument du nombre : utiliser le fait que plusieurs personnes on fait la même chose pour justifier une pensée ou un acte. Le problème principal est que ce type d’argument ne fournit aucun contenu. On peut facilement en montrer l’absurdité : le nombre ne constitue pas en soi un critère de légitimité. L’argument de la rumeur ou de la suspicion fait partie de cette catégorie : « Si on le dit, il doit bien y avoir une raison ».
Justification abusive
Exemple: Pourquoi tu lui as pris son stylo ?
— De toute façon, il était abîmé et elle ne s’en servait pas.
Il s’agit d’utiliser des prétextes pour justifier un acte a posteriori, qui tentent de gommer l’intention réelle en inventant des raisons fallacieuses ou en caricaturant la réalité. Les raisons fournies sont spécieuses, voire contradictoires avec la réponse : elles ne fournissent ni contenu réel, ni légitimité. La mauvaise foi, même flagrante, ne peut être retenue pour refuser l’argument. C’est d’ailleurs tout le problème que pose la mauvaise foi : formellement, elle est irréprochable.
Argument superstitieux
Exemple : Penses-tu qu’il pleuvra demain ?
Oui, parce que demain c’est mardi, et en général il pleut le mardi parce c’est le début de la semaine.
Il s’agit de trouver ou inventer des coïncidences en leur fournissant des explications fantaisistes ou absurdes. Malgré tout, nous sommes obligé de considérer qu’il s’agit bien là d’un argument acceptable, quand bien même sa pertinence relève d’un acte de foi très singulier.
Quels sont les éléments indispensables au dialogue philosophique? Qu’est-ce qui distingue une discussion philosophique d’une discussion “ordinaire”? Avant toute chose, il nous faut tenter de répondre à ces questions, afin de traiter diverses objections qui s’élèveront. Car il ne manquera pas de voix pour affirmer que la pensée philosophique s’effectue uniquement dans la solitude, en soutenant que le cours magistral, la conférence ou le livre représentent les moyens exclusifs de la formation philosophique, qui reste en fin de compte une transmission, une passation de savoir. Certes la discussion est admise dans l’enceinte philosophique, mais elle l’est principalement dans un échange entre pairs, chargée d’érudition, centrée sur des problèmes d’interprétation et d’exégèse, qui prendra généralement la forme d’une suite discontinue de perspectives plus que d’une véritable discussion. Ou bien entre maître et élève, avec le présupposé d’une réponse philosophique à une question qui n’est sans doute pas philosophique, ou peu. Si l’érudition reste au centre de toute préoccupation, si la complexité du savoir est le but à atteindre, il ne faut pas s’étonner du côté “vases communicants” de tout échange en philosophie. Par définition, celui qui sait éduquera celui qui ne sait pas. Ainsi l’on constatera que dans l’histoire de la pensée occidentale, rares sont les auteurs qui utilisent le dialogue comme moyen d’expression, cet exercice en commun où chacun a besoin de l’autre. Encore moins de textes valorisent l’ignorant ou le naïf, la “docte ignorance”, pour en faire l’outil et le vecteur d’une initiation philosophique. Platon et Nicolas de Cues sont parmi les rares auteurs à mettre en scène de tels personnages et de telles paroles, bien que dans la littérature et le théâtre foisonnent des exemples de “héros” qui incarnent une sorte de sagesse naturelle ou servent à l’illustration d’un imprévisible dépassement moral ou intellectuel. Ceci s’explique en partie par le postulat d’une philosophie cantonnée généralement à la construction du discours, occultant l’idée d’une pratique philosophique comme mise à l’épreuve singulière ou collective de l’être.
TRAVAILLER L’OPINION
Partons de l’hypothèse que philosopher, c’est arracher l’opinion à elle-même en la problématisant, en la mettant à l’épreuve. Autrement dit, l’exercice philosophique se résume à travailler l’idée, à la pétrir comme la glaise, à la sortir de son statut d’évidence pétrifiée, à ébranler un instant ses fondements. En général, de par ce simple fait, une idée se transformera. Ou elle ne se transformera pas, mais elle ne sera plus exactement identique à elle-même, parce qu’elle aura vécu; elle se sera néanmoins modifiée dans la mesure où elle aura été travaillée, dans la mesure où elle aura entendu ce qu’elle ignorait, dans la mesure où elle aura été confrontée à ce qu’elle n’est pas. Car philosopher constitue avant tout une exigence, un travail, une transformation et non pas un simple discours; ce dernier ne représente à la rigueur que le produit fini, atteint parfois d’une rigidité illusoire. Sortir l’idée de sa gangue protectrice, celle de l’intuition non formulée, ou de la formulation toute faite, dont on entrevoit désormais les lectures multiples et les conséquences implicites, les présupposés non avoués, voilà ce qui caractérise l’essence du philosopher, ce qui distingue l’activité du philosophe de celle de l’historien de la philosophie. En ce sens, installer une discussion où chacun parle à son tour représente déjà une conquête sur le plan du philosopher. Entendre sur un sujet donné un discours différent du nôtre, nous y confronter par l’écoute et par la parole, y compris au travers du sentiment d’agression que risque de nous infliger cette parole étrangère. Le simple fait de ne pas interrompre le discours de l’autre signifie déjà une forme importante d’acceptation, ascèse pas toujours facile à s’imposer à soi-même. Il n’y a qu’à observer avec quel naturel on se coupe instinctivement et incessamment la parole, avec quelle aisance certains monopolisent abusivement cette même parole. Ceci dit, il est tout de même possible d’utiliser l’autre pour philosopher, de philosopher au travers du dialogue, y compris au cours d’une conversation hachée où s’entrechoquent bruyamment et confusément les idées, idées entrelacées de conviction et de passion. Mais il est à craindre, à moins d’avoir une rare et grande maîtrise de soi, que le philosopher s’effectuera uniquement après la discussion, une fois éteint le feu de l’action, dans le calme de la méditation solitaire, en revoyant et repensant ce qui a été dit ici ou là, ou ce qui aurait pu être dit. Or il est dommage et quelque peu tardif de philosopher après coup, une fois le tumulte estompé, plutôt que de philosopher pendant la discussion, au moment présent, là où l’on devrait être plus à même de le faire. D’autant plus qu’il n’est pas facile de faire taire les élans passionnels liés aux ancrages et implications divers de l’ego une fois que ceux-ci ont été violemment sollicités, s’ils n’ont pas complètement bouché toute perspective de réflexion.
MISE EN SCENE DE LA PAROLE
Pour ces raisons, dans la mesure où le philosopher nécessite un certain cadre, artificiel et formel, pour fonctionner, il s’agit en premier lieu de proposer des règles et de nommer un ou des responsables ou arbitres, qui garantiront le bon fonctionnement de ces règles. Comme nous l’avons évoqué, la règle qui nous semble la plus indispensable est celle du “chacun son tour”, de préférence en s’inscrivant chronologiquement au tour de parole géré par un de ces arbitres. Elle permet d’éviter la foire d’empoigne et protège d’une crispation liée à la précipitation. Elle permet surtout une respiration, acte nécessaire à la pensée, qui doit pour philosopher avoir le temps de s’abstraire des mots et se libérer du besoin et du désir immédiats de réagir et parler. Une certaine théâtralisation doit donc s’effectuer, une dramatisation du verbe qui permettra de singulariser chaque prise de parole. Une des règles qui se révèle efficace est celle qui propose qu’une parole soit prononcée pour tous ou pour personne. Elle protège de ces nombreux apartés qui installent une sorte de brouhaha, bruit de fond qui restreint l’écoute et déconcentre. Elle empêche aussi l’énergie verbale de se diffuser et de s’épuiser en de nombreuses petites interjections et remarques annexes, qui bien souvent servent plus au défoulement nerveux qu’à une véritable pensée. La théâtralisation permet l’objectivation, la capacité de devenir un spectateur distant, accessible à l’analyse et capable d’un métadiscours. La sacralisation de la parole ainsi effectuée permet de sortir d’une vision consumériste où la parole peut être complètement banalisée, bradée d’autant plus facilement qu’elle est gratuite et que tout le monde peut en produire sans effort aucun. On en vient alors à peser les mots, à choisir de manière plus circonspecte les idées que l’on souhaite exprimer et les termes que l’on veut employer. Une conscience de soi s’instaure, soucieuse de ses propres propos, désireuse de se placer en position critique face à soi-même, capable de saisir les enjeux, implications et conséquences du discours qu’elle déroule. Ensuite, grâce aux perspectives qui ne sont pas les nôtres, par le principe du contre-pied, un effet miroir se produit, qui peut nous rendre conscient de nos propres présupposés, de nos non-dits et de nos contradictions.
QUESTIONNEMENT MUTUEL
Comme nous l’avons vu, le simple fait d’installer une procédure formelle d’écoute induit déjà au philosopher, mais il ne faut toutefois pas se leurrer: l’opinion est tenace et les habitudes de la parole réfléchie ne s’acquièrent pas de façon aussi miraculeuse et instantanée. Pour cette raison, des dispositifs supplémentaires s’avèrent utiles à l’introduction de la pensée philosophique dans la discussion. Parmi ces diverses procédures, l’une d’entre elles nous paraît plus particulièrement efficace: la pratique du questionnement mutuel. Le principe en est simple. Une fois qu’une parole s’est exprimée sur un quelconque sujet, avant de passer à l’expression d’une autre perspective, avant de laisser la place à une autre réaction, un temps est réservé de manière exclusive aux questions. Dans cette partie du jeu, chaque participant doit se concevoir comme le “Socrate” de la personne qui vient de s’exprimer, comme la sage-femme d’un discours considéré a priori comme à peine ébauché. Ainsi chaque idée ou hypothèse sera étudiée et approfondie avant de passer à une autre. À la grande surprise de tous, il est plus difficile de questionner que d’affirmer. C’est la constatation qui s’imposera rapidement aux participants dans cet exercice particulier. Car une question se doit d’être une véritable question. Il s’agit là d’exclure les affirmations plus ou moins déguisées qui ne manqueront pas de s’exprimer. Dans ce jeu nous entendons par question une interrogation qui tient de ce que Hegel appelle une critique interne, c’est-à-dire une mise à l’épreuve de la cohérence d’un discours et une demande d’éclaircissement de ses hypothèses de départ. Cette pratique s’inspire aussi du principe de remontée anagogique, telle que décrite par Platon comme méthode socratique. On y voit peu à peu l’interrogé prendre conscience des limites et contradictions implicites de ses propres affirmations, confrontation l’amenant à revoir sa position dans la mesure où il entrevoit les enjeux sous-jacents restés jusque-là invisibles. Le dévoilement de ces enjeux est généralement induit par la découverte d’une unité paradoxale, substantielle et première, précédemment obscurcie par la multiplicité éparse du propos. Pour ce faire, pour connaître une efficacité maximale, la question se doit de reprendre le plus possible les termes mêmes du discours qu’elle souhaite interroger, de coller le plus près possible à l’articulation de sa structure et de ses éléments. L’exemple même d’une “mauvaise” question est la forme du “Moi je pense que, qu’en pensez-vous?”. Un des critères pour une “bonne” question est que l’auditeur doit au maximum ignorer l’opinion de celui qui interroge, sa position devant se cantonner à une perspective principalement critique, même si dans l’absolu une position aussi dénuée de subjectivité n’est pas totalement concevable. Mais le simple fait de se risquer à une telle ascèse est important. Tout d’abord elle est un exercice d’écoute et de compréhension, puisqu’elle oblige à entendre et comprendre avec rigueur celui que nous prétendons interroger. Puis elle nous apprend à nous débarrasser momentanément du “sac à dos”: la masse d’opinions et de convictions qui nous habite. Ensuite elle nous apprend à nous “oublier”: à nous décaler et nous décentrer de nous-même par le fait de se recentrer sur une autre personne, un autre discours, d’autres prémisses, une autre logique.
QUESTIONNER POUR APPRENDRE À LIRE
Ces divers éléments sont en principe essentiels à une discussion ou à la lecture d’un texte. Car bien souvent, ce qui empêche la lecture ou l’écoute n’est pas tant l’incompréhension face à ce qui est dit, que le refus d’accepter les concepts avancés par l’auteur à tel point que le texte nous paraît dépourvu de sens. L’exercice proposé, qui revient à penser l’impensable, constitue donc une sorte de mise en abîme du lecteur ou de l’interrogateur. En confrontant la difficulté du questionnement, le questionneur s’apercevra de la rigidité de sa pensée. Ainsi, souvent, il se lancera dans un discours affirmatif avant de poser une question, s’y perdra, pour ne plus arriver à conclure et poser sa question. Au moment où il finira par s’en rendre compte, il réalisera qu’il est en train de développer ses propres idées, en ayant complètement oublié la pensée de la personne qu’il devait interroger. Une autre manière d’obtenir cette prise de conscience est de demander à l’interrogateur ce qui lui paraît essentiel dans ce que son interlocuteur a dit, ou de reformuler son discours, et l’on s’aperçoit alors que la difficulté de questionner vient en grande partie du manque d’attention et d’écoute. Un processus identique opère chez celui qui est interrogé. À maintes reprises, en prétextant répondre, il se lancera dans un développement très éloigné du propos ou se perdra dans un méandre confus qui ne touche en rien à la question posée. Il suffira de lui demander à quelle question il répond pour s’en apercevoir: soit il ne s’en souviendra plus, soit il en donnera une lecture vague ou biaisée. Cette vérification est une procédure à utiliser en permanence, afin d’assurer un maximum de concentration et de précision dans le dialogue. Lorsque quelqu’un a développé une idée, surtout si l’explication en a été un peu longue, l’animateur pourra exiger une synthèse de trois ou quatre phrases, voire une phrase unique capable de rendre la problématique claire et distincte. Ou encore, une fois la question posée il demandera à son destinataire si la question lui semble explicite, quitte à ce que ce dernier vérifie sa compréhension en proposant une reformulation. Une procédure semblable s’appliquera aussi aux réponses proposées: on demandera à l’interrogateur d’une part si la réponse obtenue lui paraît claire et d’autre part si elle correspond vraiment à la question ou si elle l’esquive et passe à côté. Une reformulation pourra à tout moment être sollicitée comme outil de vérification. Deux types de difficultés vont se poser ici. D’une part la difficulté d’entendre, de comprendre et d’assumer un jugement en conséquence, car il nous en coûte parfois de déclarer à notre interlocuteur qu’il n’a pas compris notre propos ou qu’il n’a pas répondu à notre question. D’autre part la crainte de ne pas avoir été compris et le sentiment permanent d’avoir été “trahi” par l’autre, qui feront que certains exprimeront constamment leur insatisfaction, au point de rendre toute discussion impossible. Les premiers fonctionneront sur un schéma trop conciliatoire, les seconds sur une perspective trop personnelle et conflictuelle. Ces deux cas de figure se poseront de manière plus fréquente chez les adolescents, plus fragiles dans le rapport qu’ils entretiennent à leur propre discours.
LA DIMENSION DU JEU
Cette aliénation, la perte de soi en l’autre qui est exigée par l’exercice, avec ses nombreuses épreuves, met à jour à la fois la difficulté du dialogue, la confusion de notre pensée et la rigidité intellectuelle liée à cette confusion. La difficulté à philosopher se manifestera bien souvent à travers ces trois symptômes, en diverses proportions. Il est alors important pour l’animateur de percevoir au mieux jusqu’à quel point il peut exiger de la rigueur avec telle ou telle personne. Certains devront être poussés à confronter plus avant le problème, d’autre devront plutôt être aidés et encouragés, en gommant quelque peu les imperfections de fonctionnement. L’exercice a un aspect éprouvant; pour cela, il est important d’installer une dimension ludique et d’utiliser si possible l’humour, qui serviront de “péridurale” à l’accouchement. Sans le côté jeu, la pression intellectuelle et psychologique mise sur l’écoute et la parole peut devenir trop difficile à vivre. La crainte du jugement, celle du regard extérieur et de la critique, sera atténuée par la dédramatisation des enjeux. Déjà en expliquant que contrairement aux discussions habituelles, il ne s’agit ni d’avoir raison, ni d’avoir le dernier mot, mais de pratiquer cette gymnastique comme n’importe quel sport ou jeu de société. L’autre manière de présenter l’exercice utilise l’analogie d’un groupe de scientifiques constituant une communauté de réflexion. Pour cette raison, chaque hypothèse se doit d’être soumise à l’épreuve des collègues, lentement, consciencieusement et patiemment. L’un après l’autre, chaque concept doit être étudié et travaillé grâce aux questions du groupe, afin d’en tester le fonctionnement et la validité, afin d’en vérifier le seuil de tolérance. De ce point de vue, c’est rendre service à soi-même et aux autres que d’accepter et d’encourager ce questionnement, sans craindre de ne pas être gentil ou de perdre la face. La différence ne se trouve plus entre ceux qui au travers du discours se contredisent et ceux qui ne se contredisent pas, mais entre ceux qui se contredisent et ne le savent pas, et ceux qui se contredisent et le savent. Tout l’enjeu est dès lors de faire apparaître les incohérences et les manques grâce aux questions, afin de construire la pensée. Pour cela, il est important de faire passer l’idée que le discours parfait n’existe pas, pas plus chez le maître que chez l’élève, aussi frustrante que soient ces prémices.
LE ROLE DE L’ENSEIGNANT
Dans la fonction que nous décrivons, l’enseignant peut sembler perdre sa fonction traditionnelle: celui qui en gros connaît les réponses aux questions. Soit il donne ces réponses, soit il vérifie dans quelle mesure les élèves savent les donner. Dans une telle perspective, seule la dissertation reste un travail – solitaire – où une place relative, selon les critères des correcteurs, est accordée à l’apport personnel de l’élève. Dans l’exercice proposé, l’enseignant ressemble plus à un arbitre ou à un animateur. Son rôle est tout d’abord d’assurer que les pensées sont claires et comprises, ce qu’il vérifiera non seulement au moyen de sa propre compréhension mais aussi grâce aux paroles de ceux qui réagissent à un discours ou à une question donnée. Il doit au maximum utiliser les relations entre participants plutôt que d’émettre lui-même un jugement. En agissant ainsi, il permet à chaque élève de mesurer la clarté de sa parole et de ses concepts, ce qui dans de nombreux cas représente déjà beaucoup. Ensuite il sera là pour souligner les enjeux soulevés par l’échange. Il devra savoir reconnaître les “grandes” problématiques au moment où elles émergent, sans que ceux qui les articulent en soient nécessairement conscients. Il pourra donc reformuler, ainsi qu’établir des liens avec des problématiques d’auteurs. Induire cette prise de conscience aidera à la fois à conceptualiser le discours et à valoriser celui qui le prononce. Un défi se posera ici à l’enseignant: il devra manifester une grande flexibilité intellectuelle afin de déceler une problématique classique sous une forme transposée, voire très schématique. Car il s’agit d’apprendre à chacun à s’écouter afin de profiter au maximum de ses propres intuitions – comme dans une dissertation – tout autant que d’écouter les autres et de profiter de leurs intuitions. Le rôle spécifique de l’enseignant reste quand même principalement d’initier les participants à la pratique philosophique en introduisant dans le débat un certain nombre de principes constitutif de la pensée, tels la logique, la dialectique ou le principe de la raison suffisante, même si ces outils ne constituent en rien des absolus. Ou faire accepter l’idée qu’à défaut de justifier un argument face à une contradiction, on se doit de l’abandonner, ne serait-ce que temporairement, condition indispensable à la réflexion rigoureuse. Mais ceci se fera au cours du débat, plutôt que par une théorisation a priori, permettant ainsi à chaque participant d’appréhender par lui-même la légitimité de ces outils. Comment éviter le piège d’un relativisme fourre-tout, avec les “ça dépend” qui en eux-mêmes ne veulent rien dire, ou la multiplicité infinie qui prétend à l’évidence sans fournir de réel argument. Construire un métadiscours plutôt que tomber dans le “oui-non-oui-non”. Peser le choix des termes utilisés. Autant d’éléments indispensables à la construction d’une dissertation. Remarque qui permet de répondre à l’enseignant réticent à se lancer dans ce genre de projet, par souci du programme et crainte de la perte de temps. Il est clair que l’enseignant n’est pas tellement formé à ce genre de pratique. Toutefois, ceci n’est pas un problème dans la mesure où il ne craint pas l’erreur et le tâtonnement. Car s’il est une difficulté principale, identique chez les élèves et les enseignants, c’est la crainte liée à l’incertitude de la prise de risque, en une activité où l’on ne se sent pas nécessairement à l’aise. Mais voilà peut-être une excellente occasion d’effectuer un rapprochement entre le maître et ses élèves, qui feront ensemble l’expérience de précieux moments philosophiques, inquiétants, formateurs et marquants. Car philosopher, n’est-ce pas avant tout installer un état d’esprit ?
La conceptualisation reste un terme mystérieux, cependant caractéristique du philosopher, essentiel à son activité. On l’utilise comme outil, on s’y réfère comme critère, sans pourtant jamais suffisamment tenter de définir son être ou de cerner plus précisément sa fonction. Dans l’enseignement de la philosophie, aucun effort particulier n’est exercé pour mettre en place une pratique de son utilisation : ce que l’on pourrait appeler des exercices ou un apprentissage de la conceptualisation. Ceci pour une première raison, habituelle et limitative du philosopher : sur la notion même de concept, les thèses philosophiques se heurtent. Qu’est-ce qui distingue le concept de l’idée, de la notion, de l’opinion, du thème, de la catégorie, etc. ? Déjà, demandons-nous quel peut être l’intérêt ou l’utilité de ce type de nuance ou de distinction. Pour certains, la spécificité du concept réside dans une certaine prétention à l’objectivité, à l’universalité. Dans quelle mesure ce terme est-il à la mesure de cet attribut spécifique, ou des prétentions générales qui lui sont attribuées ? De ce fait, et pour éviter les querelles et procès en hétérodoxie, si courants en philosophie, le concept reste quelque chose que l’on utilise intuitivement, sans jamais vraiment se risquer à articuler sa “véritable” nature, en évitant de trop théoriser sur la question. “Véritable”, tout au moins dans l’esprit de celui qui est censé initier des élèves à la démarche philosophique ; “cohérence” ou “clarté” devrait-on dire. Démarche qui, si elle peut s’épargner le concept du concept, pourra difficilement se passer de concepts. Peut-être est-ce justement en ce décalage entre la définition et l’utilisation que s’articule la nature particulière du concept. En effet, en suivant le langage courant, si l’on “trouve” ou l’on “a” une idée, si l’on “a” des notions, on “invente” et l’on “utilise” un concept. Ainsi le concept est très naturellement un outil, un instrument de pensée, une invention, comme celle de l’ingénieur. Si l’idée est une représentation, si la notion est une connaissance, le concept est donc un opérateur. Qu’en est-il de l’universalité du concept ? Les concepts sont-ils spécifiques ou sont-ils généraux ? Appartiennent-ils à un auteur, tel le concept de noumène, attribuable spécifiquement à Kant ? Tombent-ils sous le sens commun, tel le concept de justice, qui semble émerger de la nuit des temps ? On peut opposer ces deux types de concept, mais on peut aussi affirmer qu’ils sont indissociables. Si le premier est plus particulier et moins fréquent, il trouve son sens et la preuve de son opérativité dans l’écho que lui offre le sens commun. En effet, dans le cas du noumène, il est facile d’admettre ou d’imaginer que toute entité déterminée est dotée d’une sorte d’intériorité. Le deuxième, la justice, en dépit de sa banalité aujourd’hui, est le produit d’une genèse et d’une histoire qui, d’une intuition commune, a d’ailleurs engendré deux sens : l’institution et la légalité d’une part, le principe et la légitimité d’autre part. Toutefois, afin de relier les deux attributs du concept, universalité et fonction, proposons l’hypothèse suivante : l’universalité d’un concept est déterminée par son efficacité, par la possibilité de son utilisation et par son utilité. Autrement dit, le concept se doit d’être clair pour être un concept, de même que son utilité se doit d’être manifeste. Il évitera les nuances à l’infini de définitions dont on ne saisit plus tellement l’intérêt. À l’instar d’une fonction mathématique, il doit permettre de résoudre un problème, il n’existe pas pour son propre intérêt. S’il ne peut faire l’économie de la précision, il ne peut surtout pas faire celle de l’application. Ainsi, aussi singulier soit-il, son opérativité lui accordera un statut d’universalité. Pour émerger d’une pratique empirique où tout s’effectue au cas par cas, au travers d’une simple recette, on tentera de conceptualiser l’action ou la pensée particulière. C’est-à-dire d’abstraire ce qui est essentiel et commun aux divers cas de figure possibles. Il s’agira dès lors de sortir de la narration, de l’opinion et du concret pour entrer dans l’analyse.
FONCTION DU CONCEPT
Proposons trois types d’activité liés au concept. 1- connaître les concepts engendrés et approuvés par la tradition philosophique. 2- reconnaître un concept général. 3- créer un concept spécifique. 1- Il s’agit ici de connaître et d’utiliser des concepts reconnus par la tradition, qui sont présentés en tant que concepts, avec tout le crédit qui leur est accordé d’emblée. Ces concepts peuvent être généraux ou spécifiques. Pour connaître, il faut donc apprendre, c’est-à-dire acquérir, se mettre en mémoire. Il faut aussi définir, c’est-à-dire préciser, expliquer la nature du concept. Une connaissance qui, bien entendu, conditionne la capacité d’utilisation du concept. L’écueil classique majeur est ici d’apprendre des concepts sans apprendre à les utiliser. En se cantonnant à un simple énoncé ou à une définition, dépourvus d’une réelle appropriation. 2- Il s’agit ici de reconnaître un concept utilisé lorsqu’il apparaît, sans qu’il apparaisse explicitement comme tel. Pouvoir identifier un concept lorsque l’on en rencontre un. Ici se pose très souvent le problème de l’abstraction : la crainte de l’abstraction, accompagnée de l’impossibilité de percevoir cette abstraction lorsqu’elle apparaît. Certains en font une posture : refus de voir l’abstraction. Le concept n’en est plus un : il est relégué à la simple articulation d’un cas particulier. Il est privé de son opérativité générale, privé de son universalité, il reste un cas de figure concret. 3- Il s’agit ici d’articuler un concept afin de résoudre un problème de pensée. Le terme utilisé peut être un terme courant dans son acception habituelle, un terme dévié de son sens, ou un néologisme. L’important est de reconnaître l’utilisation spécifique qui en est faite, car bien souvent le concept surgira de manière assez intuitive. Dans l’enseignement traditionnel de la philosophie, l’apprentissage des concepts classiques reste le seul aspect du concept à être relativement systématisé. Au travers des cours du professeur et des textes étudiés, l’élève devra assimiler un certain nombre de concepts qu’il s’appropriera plus ou moins. Ainsi, dans l’exercice clé, celui de la dissertation, il devra de préférence montrer qu’il en a retenu un certain nombre, non pas simplement en les citant, mais en les utilisant d’une manière appropriée qui en démontre la compréhension et la maîtrise. Toutefois, in fine, il lui est surtout demandé d’élaborer sur un sujet donné une pensée construite à partir de ses propres idées, autrement dit de fournir un certain nombre de concepts qui lui appartiennent, auxquels il devra intégrer des éléments de cours, articulant ainsi un ensemble cohérent. Mais aucune pratique, aucun exercice, aucun cours, ne l’auront entraîné à une telle maîtrise de sa propre pensée. Il aura d’une part sa culture personnelle, d’autre part il aura vu et entendu l’enseignant accomplir de tels gestes, mais il ne se sera pratiquement jamais exercé en classe. Le seul moment où il mettra en œuvre cet art sera à l’occasion des quelques dissertations qu’il effectuera seul, en examen ou à la maison, bénéficiant pour tout conseil des quelques commentaires griffonnés sur sa copie par le correcteur. Autrement dit, seule la première partie de notre triptyque est véritablement un objet de cours. Et encore, uniquement sur le plan théorique, pas dans la pratique.
RECONNAITRE LE CONCEPT
La question cruciale la plus immédiate à traiter nous semble donc la deuxième partie évoquée : reconnaître le concept que l’on utilise intuitivement, en son statut d’opérateur de pensée. Penser une chaise après l’autre rend impossible toute démarche scientifique, car un tel fonctionnement est négation de toute universalité, ou au moins de toute généralisation. Or cette universalité ou cette généralisation, qui nous permet d’appréhender l’univers, est un produit de l’esprit : une construction, une intuition, etc. Cette chaise-ci, spécifique, je peux la toucher, la voir, m’asseoir dessus, etc. Les sens servent de point de départ, d’outil de vérification de ce qui est exprimé. À l’extrême, je n’ai même pas besoin du terme pour m’exprimer : je peux montrer du doigt. Le concept (ou idée) de chaise, lui, privé de tels éléments, repose sur un accord tacite : l’autre est censé savoir de quoi je parle, sans possibilité immédiate de montrer et de vérifier empiriquement. Premier type de problème : le cas limite s’applique-t-il ou pas ? Le tronc d’arbre sur lequel je m’assieds est-il une chaise ou pas ? Et une caisse en bois ? Cette situation nous oblige à reconnaître que la chaise n’est pas un objet particulier, elle n’est pas une évidence : elle est un produit de l’esprit, qui comme tout produit de l’esprit connaît ses limites. Nous oscillons ici entre reconnaître et créer : me confronter aux cas limites oblige à préciser le concept, à le sortir de son statut de pure intuition, à le conceptualiser. Exemple : la chaise se définit-elle par sa forme ou par sa fonction ? Selon le cas, si une chaise est définie par son utilité : s’asseoir, alors le tronc est une chaise. Si elle est définie par sa forme : elle exige des pieds et un dossier, et le tronc n’est pas une chaise. L’opérativité est ici soit une fonction, soit une forme, ou les deux ensemble : cette précision est ce qui pourrait distinguer une idée d’un concept. En émettant le principe que l’idée est plus générale, ou plus subjective que le concept. Bien que l’exigence de définition, inhérente et nécessaire à l’idée, nous rapproche énormément du concept. Proposons l’hypothèse suivante, afin de distinguer concept et idée. L’idée se rapporte plutôt à une entité générale, elle se réfère plutôt à un en soi, alors que le concept est plutôt une fonction, ou un rapport. Si l’idée se cantonne à l’intuition et à la définition, le concept s’intéresse plutôt à l’utilisation. Avouons qu’en fin de compte cette distinction peut être très fragile. Elle permet toutefois de réfléchir au statut de l’objet de pensée. Pour éviter une théorisation outrancière, du concept ou d’autre chose, posons-nous la question : qu’est-ce que cela change ? Dans la présente réflexion, une première distinction nous paraît importante. S’agit-il d’abord de définir puis d’utiliser, ou est-il possible, voire préférable, d’utiliser puis de définir ? La première hypothèse est la plus courante dans les conseils donnés aux élèves pour les aider à disserter. Mais l’inverse constitue une pratique tout aussi valable. Le présupposé de la définition comme action première implique de connaître à l’avance les idées utilisées, puis de les composer entre elles, au risque de figer la pensée. Plutôt que de procéder par hypothèses générales successives et d’en définir ensuite les concepts ou idées utilisés. Dans le premier schéma, l’élève risque de proposer quelques concepts premiers, mais par la suite il ne cherchera plus nécessairement à analyser finement son travail en tentant de percevoir les concepts engendrés par le flux de la rédaction. Concepts aussi importants que les premiers, concepts qui risqueront aussi de modifier, voire de contredire les propositions initialement annoncées. C’est pour cette raison que nous proposons de travailler sur le principe de la “reconnaissance du concept”. Il ne s’agit pas ici de clamer la primauté d’une méthode, mais d’envisager différentes possibilités, avec leurs divers avantages, sur le plan philosophique et pédagogique. D’autant plus que certains élèves se sentiront plus à l’aise avec un cheminement qu’avec un autre, facilitant leur propre construction de pensée. Certains préfèreront partir d’un mouvement général, au risque du flou, d’autres de briques bien définies, au risque de la rigidité.
UTILISATION DU CONCEPT
Ainsi le concept doit être reconnaissable. Par sa définition, mais surtout par son utilisation. Il doit permettre par exemple de résoudre un problème, de répondre à une question. Il doit surtout pouvoir établir des liens ; c’est là sa principale opération. Le concept de verre lie tous les verres entre eux, en dépit de leurs nombreuses différences. Il doit aussi lier deux termes d’ordre différent entre eux. Ainsi le concept de verre relie le boire à l’eau, en tant que moyen par exemple. Cette idée de rapport correspond à un raisonnement tout à fait ordinaire. Mais une bonne part du travail de l’enseignement philosophique est de rendre l’élève conscient de l’ordinaire, le rendant spécial, lui donnant du sens au-delà de l’évidence. C’est ce qui caractérise le concept et la conceptualisation. Quel est le lien entre verre et eau ? Le verre contient l’eau. Au-delà de la réponse intuitive, il s’agit de réaliser que l’on a fait intervenir un nouveau concept : contenir. Entre les différents verres, il s’agit d’un autre rôle, d’un autre type de lien : la généralité, ou l’abstraction, la catégorisation qui regroupe les entités de qualités semblables, plutôt que l’opération de relation, causale ou autre. Peut-être avons-nous là une autre possibilité de distinction entre l’idée, plus proche de la catégorie, et le concept. Toutefois, il s’agit aussi d’une opération, mais plus qualitative que fonctionnelle. Cette deuxième opération représente un autre type de difficulté. Le “Qu’est-ce qui fait que deux choses sont semblables ou non ?” se distingue du “Quelle est l’action qui relie deux objets ou deux idées ?” À partir de cela, un certain nombre d’exercices deviennent visibles. Qu’y a-t-il de commun entre… Quel rapport y a-t-il entre… Quels sont les concepts utilisés, qui donnent sens à telle ou telle phrase ? Nous apercevrons que créer du lien est difficile. La tendance naturelle est de faire que chaque idée reste dans son coin, dans son isolation intellectuelle, dans sa singularité empirique ou idéelle. L’expression commune et courante : “Cela n’a rien à voir !” en est une manifestation la plus évidente. Le “C’est autre chose”, qui renvoie la résolution du problème ou l’élaboration de la pensée aux calendes grecques. À l’inverse, symptôme cohérent avec le précédent, les idées seront reliées entre elles sans aucune considération de logique ou de substantialité, sans articuler précisément le lien, sans le mettre à l’épreuve. Sous la forme d’une liste d’épicerie, ou d’idées complètement isolées. La doxa philosophique tombe facilement dans le même travers, par un souci extrême de précision lié à la déformation de la définition, souci qui prend souvent le pas sur tout autre considération. La difficulté est de concevoir que le concept n’est qu’un outil. Qui apparaîtra explicitement ou n’apparaîtra pas dans le produit fini. Et quoi qu’il en soit, pouvoir l’identifier et en clarifier le sens dans le but d’en expliquer l’utilisation. Si le concept apparaît dans une phrase, il s’agit simplement de reconnaître le mot clé autour duquel s’articule la proposition en question. D’en peser le sens et les conséquences. De voir la nouveauté qu’il amène et de se demander à quoi il répond. S’il affirme, s’il répond à quelque chose, il est nécessairement une forme ou une autre de négation. Demandons-nous alors ce qu’il nie, ce qu’il refuse, ce qu’il prétend rectifier. Pour cela il est intéressant d’utiliser le principe des contraires. Que se passerait-il si ce concept n’était pas là ? Quelle en est la négation ? Que refuse-t-il ? Il s’agit dès lors de soulever les enjeux liés à ce concept précis. Ce qui permet à la fois de mieux comprendre ce qui est dit, et de changer le concept si en le mettant à l’épreuve de son sens il paraît soudain inadéquat. Le concept peut aussi ne pas apparaître dans la proposition. Il s’agit alors de l’exprimer pour qualifier cette dernière. Quitte à ajouter, si l’on en voit le besoin, l’articulation de ce concept dans une proposition complémentaire. Ou à se servir de son articulation pour formuler une nouvelle problématique. Pour formuler le concept non dit, le principe des contraires est également utile. À quoi répond cette proposition ? Quel est l’enjeu entre cette proposition et ce à quoi elle répond ? Comment s’opposent leurs qualifications respectives ? Invariablement, comme on opère ici au méta-niveau de la pensée, on devrait retrouver les grandes antinomies de la philosophie : singulier/universel, subjectif/objectif, fini/infini, noumène/phénomène, etc. Une des difficultés courantes dans ce type d’exercice – due sans doute aux tendances relativistes et consensualistes de notre époque – est le refus permanent de saisir des oppositions. Dans un rapport entre deux propositions, on voit du “autre chose”, du “complémentaire”, de la “précision”, mais plus difficilement de l’opposition. Face à l’antinomie entre singulier et universel, qui servira à distinguer une proposition générale d’un cas concret et spécifique, beaucoup hésiteront à parler d’opposition et préfèreront employer les termes mentionnés. Ce qui ne serait pas un problème si ce n’était que les enjeux ne sont plus exprimés, les conséquences de la proposition gommées. Une voie moyenne par laquelle l’élève tentera d’échapper à l’opposition est le “plus et moins”. Ainsi il dira qu’une première proposition est concrète et la deuxième moins concrète. Mais il se refusera à réellement qualifier la seconde. Pourtant, le sens du concept “concret” qu’il utilise diffèrera selon qu’il utilise comme opposé “universel”, “abstrait” ou “général”. Il s’agit donc de refuser l’utilisation du “plus et moins” pour qualifier de manière plus spécifique. La table carrée n’est pas moins ronde que la table ronde : elle est carrée. Il s’agit ici de comprendre que l’utilisation des contraires, dans le choix de leur couple spécifique, permet de préciser la pensée et de la mettre à l’épreuve. Un tel exercice aide à sortir un concept donné de son statut d’évidence, en le mettant en relief grâce à son contraire. Prenons un exemple : une élève suggère de qualifier une proposition générale comme “universelle”, et après diverses hésitations, qualifie celle qui s’oppose, plus concrète, de “naturelle”. Questionnée, elle propose comme opposé de “naturel” : “artificiel”. L’universel est-il donc artificiel ? Elle refuse ces conséquences et remplace alors “naturel” par “particulier”. Elle aurait pu aussi assumer une nouvelle antinomie, comme “naturel et artificiel”, dans la mesure où elle aurait pu en rendre compte. Ainsi, grâce au principe des contraires, la connotation est articulée, permettant de clarifier le concept et d’avancer posément dans la réflexion, voire de poser de nouvelles problématiques. Dans cet exemple précis, l’élève formulera une proposition dite “universelle” et une “particulière”, établissant un lien entre les deux, ce qui permet aussi la possibilité d’une mise à l’épreuve de la proposition “universelle”. Tout cela de manière consciente et explicite, plutôt que vague, intuitive et implicite. Un autre obstacle fréquent dans ce genre d’exercice est le refus de travailler dans l’intensif. L’extensif semble généralement plus confortable et moins anxiogène. Plutôt que d’analyser une proposition donnée, l’élève préfèrera ajouter des mots. Prétendument pour expliquer la première. Mais soit l’idée suivante est une autre idée et donc n’explique pas vraiment la première, soit elle répète en d’autres mots ce qui a déjà été affirmé. Parfois, presque par chance, l’idée est réellement expliquée, mais ce sera plus en abordant les conséquences de l’idée qu’en affrontant l’idée elle-même. La raison en est simple : les idées que nous formulons nous paraissent tellement évidentes qu’il ne semble pas nécessaire de s’appesantir sur leur statut, sur leur sens. Nous préférons “avancer”. Le surplace est trop pénible, nous préférons courir. Pourtant il permettrait de mieux problématiser notre propre pensée, mais un tel désir n’est pas toujours au rendez-vous. L’esprit trouve plus facile de rajouter des idées que de travailler sur le concept et la justification conceptuelle.
COURS OU MIRACLE ?
La pratique que nous venons de décrire se doit d’être un objet de cours, sans quoi il ne faut pas s’attendre à ce que l’élève se livre seul, miraculeusement, à une conceptualisation de sa propre pensée. Pour cela il faut être prêt à rendre compte de tels processus, et ne pas laisser croire que c’est le génie propre et irremplaçable de l’enseignant, ou accessoirement de l’élève, qui produit du concept. Il s’agit d’être prêt à identifier les ficelles et à en rendre compte. Peut-être certains élèves, et l’enseignant lui-même, ont naturellement accès à la conceptualisation, mais il serait absurde de croire que c’est le cas pour la majorité d’entre eux. Et même s’il y a intuition, il y a tout à gagner à conceptualiser la conceptualisation. Si Mozart n’a sans doute pas eu besoin de beaucoup de cours de solfège ou de composition, il n’en va pas ainsi du commun des mortels. Il serait donc présomptueux de penser que nos élèves et nous-même pouvons nous en dispenser. Et si le concept se limite aux concepts établis, dans la prétendue objectivité ou universalité fournie par le génie de leur auteur, ne nous étonnons pas que les élèves offrent pour toute dissertation un collage entre des citations plus ou moins comprises et des opinions toutes faites. Le cœur d’une réflexion, et le véritable critère de correction, reste quand même la conceptualisation et l’articulation d’une pensée singulière. Alors autant en enseigner la pratique, plutôt que de se contenter de visiter les musées
Pour tout jeu, pour toute pratique, comme pour tout exercice, des règles sont à installer, des règles qui impliquent des exigences et des contraintes spécifiques, règles qui pour cela font appel à des compétences spécifiques. Un jeu n’est pas un simple défoulement : il met au défi au travers de règles. Règles qu’il s’agit d’articuler, de proposer, de définir, de faire comprendre, d’utiliser, d’imposer, sans oublier de les revoir en permanence. En effet, les règles ne valent que ce qu’elles valent, n’accomplissent que ce qu’elles accomplissent, et rien d’autre. Ainsi, selon les circonstances, selon les individus, selon les exigences du moment, selon l’usure et bien d’autres paramètres, les règles seront préférablement revues, renouvelées, adaptées, rectifiées, assouplies, abandonnées, etc. En outre, les règles peuvent – ou doivent – faire partie intégrante de la discussion : elles feront périodiquement l’objet d’un débat, débat sur le débat, élément essentiel de la perspective réflexive et dialectique que nous privilégions ici. Car non seulement le règles varient, mais d’un « animateur » à l’autre, qu’il soit enseignant ou élève, des règles semblables prennent une toute autre tournure, de par la rigueur de leur application, de par l’emphase donnée à certains aspects plutôt qu’à d’autres.
N’oublions pas que les règles ont un contenu : elles orientent le fonctionnement de l’élève et sa pensée dans un sens plutôt que dans un autre, elles tentent de pallier une difficulté plutôt qu’une autre. Ainsi, si des élèves ont du mal à s’exprimer, par timidité, à cause d’un contexte de classe difficile ou par un quelconque handicap langagier, l’accent sera plus naturellement porté sur la simple opération d’articuler des idées que sur la capacité d’abstraction ou d’explication. L’affirmation sera privilégiée par rapport au questionnement, et de fait l’enseignant se réservera par défaut le rôle de l’interrogation. De même pour la conceptualisation ou la problématisation : l’enseignant sera, selon les situations, obligé de réaliser lui-même, au degré qu’il jugera bon, le travail de valorisation de la parole singulière. Parfois, il se verra obligé de travailler principalement sur le vocabulaire, ou sur l’agencement logique de la phrase, car les mots et les phrases utilisés souffriront de lacunes trop importantes dans leur utilisation ou dans leur compréhension. De temps à autre, la mise en place des principes élémentaires de comportement, tel que parler à son tour, constituera l’essentiel du travail, surtout en début d’année, avec les classes de maternelle ou de cycle 1. Mais comme il s’agit de prendre les enfants là où ils sont, comme ils sont, cela ne pose guère de problème en soi, à moins de vouloir trop rapidement accélérer la manœuvre, pour des raisons d’attendus personnels ou administratifs, attendus qui parasitent facilement le fonctionnement de l’atelier.
Cependant, n’oublions pas que ces règles de base, plutôt que d’être perçues comme une corvée et un pur formalisme disciplinaire, peuvent très bien être présentées comme un jeu et gagnent à l’être. Si au début ces exigences de forme rencontrent une certaine résistance, celle-ci s’atténue progressivement, proportionnellement à la capacité d’assimilation et de mise en pratique des obligations, selon l’aptitude à prendre plaisir de jouer avec ces contraintes. Pour la majorité des enfants, une telle contrainte ne présente jamais un gros problème en soi, quand bien même ces règles représentent un certain défi : plus que les adultes, ils sont animés par l’instinct du jeu, ils ne croient pas encore trop à ce qu’ils font, leur fonctionnement n’est pas encore trop surinvesti par un désir d’apparence et diverses craintes existentielles : ils savent encore faire confiance. Ce qui poserait toutefois un réel problème serait un ensemble de règles inappropriées, qui visant des compétences trop étrangères aux élèves concernés. Il s’agit donc de maintenir une tension permanente entre l’exigence et l’impossibilité : se placer un pas en avant, et non un pas trop loin. En ce sens, la fabrication et l’utilisation des règles de fonctionnement comme outil primordial d’enseignement sont déjà un art en soi, auquel l’enseignant ne sera pas nécessairement préparé, initié ou même disposé. Art qui ne se résume jamais à des recettes, mais résulte nécessairement de la continuité d’une pratique.
Pour faciliter cette appropriation des règles de fonctionnement, il est important d’insister sur leur dimension ludique et discutable. Elles sont ludiques dans le sens où elles ne constituent pas une sorte de vérité ou de bien absolu. Elles représentent uniquement un moyen de jouer. Elles sont discutables dans le sens où elles ont une raison d’être, et autant de raisons de ne pas être, c’est-à-dire d’être supprimées ou remplacées par d’autres règles, ce dont il est possible de débattre en toute sérénité. C’est dans cette perspective que l’on peut parler de connaître et de comprendre les règles. Car elles ne sont plus uniquement le produit d’un pouvoir régalien, celui d’un maître au pouvoir mystérieux, mais le produit de la raison, d’une raison ou d’un agencement contractuel et contestable. Dès lors elles peuvent faire l’objet d’une réflexion, plutôt que de solliciter uniquement l’adhésion ou de provoquer le refus. Qu’est-ce qu’un jeu ? Un exercice collectif (ou individuel) qui permet à chacun de se confronter aux autres et à soi-même, à travers une procédure quelconque mettant en œuvre des compétences particulières. La loi n’est alors plus une fin en soi, elle n’est plus la dura lex sed lex qui de sa dureté tire sa substance et son légitimité, mais un simple moyen d’exister, parce qu’elle offre à l’être une possibilité de faire et d’être. Une telle perspective invite à la générosité, plutôt qu’à l’âpreté punitive de la simple discipline.
Jouer le jeu renvoie à un autre enjeu : la construction du savoir. En effet, si le savoir n’est pas constitué a priori, d’où provient-il ? Comment émerge-t-il ? Jouer le jeu implique déjà que la connaissance est une pratique, un savoir-faire, et non un ensemble de connaissances théoriques établies a priori, qu’il s’agit de reproduire. Les connaissances résultent d’un savoir-faire, plutôt que d’être perçues comme le préalable de ce savoir-faire. On oublie trop vite que la connaissance naît de la pensée. Certes, toute mise en œuvre présuppose un certain savoir, ne serait-ce que celui d’un langage minimum dans l’exercice qui nous concerne, mais plutôt que de se soucier de faire acquérir formellement ces préalables aux élèves – ce qui peut au demeurant s’effectuer en d’autres moments -, lançons-les dans l’exercice. Ce pari de la dynamique permettra à tous, enseignants et élèves, en premier temps d’évaluer les compétences et faiblesses de chacun, et de déterminer ensuite ce qu’il convient de faire.
Car c’est d’un cheminement dont il est question ici. Les procédures requises invitent le groupe à convoquer ce qu’ils savent, à utiliser ce savoir, à en percevoir les limites, à identifier les besoins, et selon les cas, à résoudre les problèmes et obstacles qui se présentent en mobilisant de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Quand bien même le participant en resterait à la simple perception du problème, le travail est accompli, qui consiste à susciter un besoin pour la connaissance, à créer un appel d’air pour la pensée. Cet état d’esprit induira une motivation supplémentaire et procurera des éclairages porteurs pour l’enseignant, qui pourra, par la suite, expliquer quelque principe important en se fondant sur une expérience concrète. Cette genèse de la connaissance, une connaissance affirmant et démontrant de manière substantielle sa nécessité, devrait d’une part aider ces élèves qui vivent le travail en classe et l’apprentissage comme un immense pensum où l’on doit ingurgiter d’étranges choses, mais aussi aider ceux qui réussissent précisément parce qu’ils ont compris le système et savent reproduire ce qui leur est inculqué, au détriment parfois d’une pensée vive et authentique. Jouer, sans exclure la rigueur, car ce ne serait plus un jeu mais la récréation, c’est rendre opératoire et dynamique la pensée, c’est lui rendre son souffle.
2- Le maître du jeu
Si dans l’idéalité de l’absolu, la fonction de maîtrise ne nécessite guère d’être incarnée par une personne particulière, le groupe pouvant se suffire à lui-même dès que la responsabilité est prise en charge par chacun, il n’en va pas de même avec la réalité du quotidien. En particulier si le groupe est large, et si le jeu présente quelques enjeux importants ou difficultés particulières. Toutefois, avouons-le, plus le rôle du maître pourra être minimisé, plus le jeu pourra être pensé comme un succès. Sans toutefois succomber pour des raisons pratiques – douce facilité – à la tentation d’un jeu minimal, bien que là encore, il soit possible de s’orienter vers d’autres options de fonctionnement, du moment que l’on clarifie la nature, les implications et les conséquences de ces options.
Tout banquet, comme tout navire, a besoin d’un capitaine, nous recommande Platon. Si la navigation, tâche complexe, s’effectue à plusieurs, il s’agit tout de même de nommer une personne qui de manière ultime, au gré des événements, prendra les décisions finales lui semblant justes, au risque de l’erreur et de l’injustice. Sachant qu’il ne s’agit pas là d’un pouvoir de droit divin, mais uniquement d’un accord tacite établi pour des raisons pratiques. Ce rôle pourra donc être imparti à diverses personnes, à tour de rôle. Rôle politique qui, à nouveau selon Platon, consiste à tisser la diversité en une œuvre unique. Et si l’enseignant, plus au fait de la pratique qu’il tente d’introduire, assume initialement cette fonction, il lui est recommandé de la déléguer périodiquement à des élèves, selon l’opportunité des circonstances. Les difficultés qui se poseront alors feront partie intégrante de l’exercice, les deux écueils de la pratique philosophique étant l’autoritarisme et la démagogie.
Quel est ici le rôle du maître, puisqu’il n’est plus celui qui est chargé de “ dire la vérité ” ? Tout d’abord il est un législateur : il établit la loi, l’énonce, en rappelle périodiquement les termes, voire en modifie les articles. Comme nous l’avons déjà exprimé, les règles sont soumises au débat, mais il s’agit de délimiter le lieu de ce débat, d’en spécifier le moment approprié, et de décider lorsqu’il doit s’interrompre, afin que l’exercice ne soit pas un permanent débat sur le débat, chausse-trappe dans lequel il est facile de tomber. Quitte à demander au groupe, en fin de jeu, ou au démarrage, si un quitus est accordé à la personne en question. Il est différentes manières de mettre en place un tel processus, mais ce qui nous paraît le plus efficace est d’accorder durant le jeu les pleins pouvoirs à celui qui est désigné, puis de réserver à la fin de la partie un espace de discussion afin d’effectuer le bilan du travail accompli.
Le maître du jeu est aussi un arbitre, fonction judiciaire, dans la mesure où il doit assurer que les règles en question, qu’elles soient les siennes propres où celles établies au préalable, sont respectées. Toutefois, il semble préférable de renvoyer au groupe toute décision, par le biais d’un vote à main levée par exemple. Son rôle d’arbitre consistera alors à soulever ce qui lui paraît un problème, à solliciter les avis de quelques personnes, puis à produire une décision, directe ou indirecte. L’arbitrage ne doit pas ici être conçu comme une activité annexe, mais comme faisant partie intrinsèque de l’exercice, puisque l’élaboration du jugement, la formulation d’arguments, se niche au cœur même de l’activité philosophique. Souvent, les questions les plus intéressantes au cours d’une discussion naîtront en ces débats d’arbitrage, souvent délicats, ce qui n’est pas étonnant puisqu’ils exigent de penser la forme, celle de la logique et des rapports de sens, autrement dit de réfléchir au niveau de la métadiscussion, et non pas à celui du simple échange d’opinion. Il s’agit donc de dépasser le niveau des accords ou désaccords de contenu qui renvoient principalement à la subjectivité, aussi argumentée soit-elle. Penser la conformité aux règles, c’est travailler l’exigence de la vérité, qui n’est jamais que la conformité à quelque chose, aussi arbitraire que soit cette chose : une autre idée, un principe, la logique, l’efficacité, etc.
Le maître du jeu a pour troisième casquette d’être un animateur, ou fonction exécutive. Bien souvent, le rôle de l’exécutif est perçu uniquement à travers son pouvoir discrétionnaire, comme une prérogative dont on abuse sans scrupule, ce qui avant tout autre sentiment installe la méfiance, au lieu de son contraire, la confiance, sans laquelle pourtant aucun groupe ne peut fonctionner de manière paisible et sereine. De surcroît, son autorité relève de l’arbitraire, puisque nul ne sollicite l’avis de tous, ou bien il compte si peu que l’apport personnel du commun est considéré quantité négligeable. Dans notre exercice, il s’agit d’établir un rapport de confiance mutuelle, entre l’animateur du moment, qu’il soit l’enseignant, un autre adulte ou un élève, et ceux qui participent au jeu. Car si le jeu ne peut s’effectuer sans lui, il ne peut présider la séance sans les autres, sans chacun d’entre les participants. Non pour des raisons uniquement formelles, mais parce que si le moindre participant se met en tête d’interrompre par un comportement intempestif le jeu, il le peut. Tout comme le moindre participant qui avance une idée porteuse, permet à tout le groupe d’avancer. N’oublions pas que ce n’est pas l’animateur qui fournit les idées, mais les participants, ce qui place celui-ci dans un rapport de dépendance, assez déstabilisant d’ailleurs pour certains enseignants, qui ont du mal à faire confiance à leurs élèves.
Ainsi le pouvoir ne doit plus être un mauvais mot, pas plus qu’il ne doit être incontestable. Il est un art et une responsabilité, une pratique à laquelle on s’exerce comme n’importe quelle autre. Cette pratique renvoie au fonctionnement de la cité, à la séparation des tâches. Elle apprend à faire confiance aux autres, tout comme à soi-même, et de ce fait revalorise l’individu à travers ce pacte entre pairs. Elle apprend aussi à accepter la dimension d’arbitraire de la vie en société, et de l’existence en général, non comme un facteur subi, induisant la passivité et le ressentiment, mais comme un des aspects constitutifs de l’établissement d’un groupe, qu’il s’agit de prendre avec distance, et de régler dans le temps dans la mesure où l’on reste conscient du problème général qu’il présente. Cette capacité d’accepter l’arbitraire nécessite une conscience en éveil, implique une distanciation avec soi-même, une capacité de minimisation de soi-même en faveur du groupe, et l’apprentissage du deuil quant à ses propres prétentions et désirs. Un tel fonctionnement comporte une indéniable prise de risque, surtout pour celui qui en temps habituel détient le pouvoir a priori, mais aussi pour ceux qui doivent l’exercer momentanément. L’alternance de la présidence et les moments réservés au débat sur le débat, où chacun évalue son propre fonctionnement et celui des autres, forgent la solidité du pacte, précisément parce qu’il est critiquable et révocable. À tout moment, certes, même s’il est généralement convenu de laisser le président de séance aller jusqu’au bout de son mandat, sauf difficulté majeure. L’exercice de la citoyenneté passe également par la protection de ce qui institue le jeu. Cela signifie, entre autres, garantir que puisse travailler en toute sérénité celui qui doit assurer le bon déroulement du jeu. Pour certains participants, chez qui la méfiance et la réactivité sont une manière d’être, une telle perspective implique un retournement psychologique et identitaire assez phénoménal, mais néanmoins soulageant.
3- Demander la parole
La plupart des élèves connaissent la règle qui consiste à demander la parole en levant la main au préalable, mais il n’est pas sûr qu’ils la mettent en pratique et surtout qu’ils en saisissent le sens. En général, les deux conceptions les plus courantes, relativement inconscientes, sont d’une part celle qui octroie au maître ou à la maîtresse le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser la parole, d’autre part celle qui conçoit cet acte comme un rituel – plus ou moins obligatoire – qui accorde automatiquement la parole, comme le geste de politesse qui garantirait la satisfaction d’une demande ou légitimerait un geste, à l’instar de “ s’il vous plaît ” ou de “ pardon ”. Le premier cas de figure se trouve plus rarement à l’école primaire, il s’instaure plus tardivement, le second est respecté à des degrés très divers : on voit dans de nombreuses classes des élèves qui commencent à parler dès qu’ils lèvent la main.
À nouveau, nous souhaitons insister sur l’idée de la compréhension des règles, sur leur nature discutable, compréhension et discussion qui n’excluent ni la possibilité d’imposer ces règles, ni d’envisager leur aspect arbitraire. Le problème qui se pose ici est celui du “ Pourquoi parle-t-on ? ”. Est-ce parce que la parole se bouscule en nous et doit sortir coûte que coûte, autrement dit est-ce pour s’exprimer comme l’on exprime le jus d’un citron ? Certaines discussions peuvent jouer ce rôle, qui instaurent en classe le lieu d’une parole libre et sans contrainte. Mais s’il s’agit de philosopher, c’est-à-dire de “ penser la pensée ”, alors d’autres déterminations interviennent. À commencer, et ce n’est pas le moindre des critères, pas l’écoute. En effet, à quoi sert de parler dans le brouhaha, tandis que d’autres parlent ou que personne n’écoute ? Pour l’élève, l’idée est de parler lorsque l’on s’est assuré d’une écoute maximale afin de maximiser l’impact de ses paroles et garantir le meilleur retour possible. Mais en va-t-il autant du maître ? Quel exemple donne-t-il ? A-t-il, par lassitude, par découragement ou par surdité, pris l’habitude de parler dans le vide ou le chaos ? Ou bien considère-t-il normal – non peut-être par son discours mais par son comportement – que si sa parole d’autorité exige le silence, celle de l’élève peut tant bien que mal surgir dans le bruit ?
Présentons quelques enjeux de l’affaire. Premièrement, comme nous l’avons dit, lever la main avant de parler revient à s’assurer que l’écoute est active avant de prononcer quoi que ce soit, plutôt que de lâcher des mots par simple défoulement. Deuxièmement, il en va du statut de l’élève et du respect mutuel qui contribue activement à la définition de ce statut. Pas plus que l’on ne devrait couper la parole au maître, on ne devrait davantage interrompre un élève qui élabore sa pensée, quand bien même elle nous paraîtrait lente à émerger, incongrue ou incompréhensible : l’erreur ou l’incompréhension font partie intégrante du processus d’apprentissage, elles ne peuvent être un vecteur de dévalorisation de l’individu. D’autant plus que l’élève peut au cours de son intervention rectifier peu à peu son propos. Demander à un élève d’écouter son voisin, c’est lui garantir en retour qu’il sera lui aussi écouté. En n’oubliant pas de surcroît que si le maître peut encore suivre le fil de ses idées lorsqu’il est interrompu par un élève, ce dernier aura plus de mal à garder sa concentration. Cela est d’autant plus le cas pour l’élève timide ou brouillon. D’ailleurs, afin d’assurer une écoute plus grande ainsi que la manifestation de cette écoute, il est préférable de demander aux élèves de ne pas lever la main pendant qu’un camarade parle : cela équivaut à lui demander de s’activer ou se taire. De toute façon, on n’écoute pas mieux le bras levé dans les airs…
Troisièmement : habituer l’élève à articuler sa pensée propre, en percevoir les limites et prendre ainsi conscience de ses difficultés. Il est à ce propos une pratique courante de l’enseignant, au potentiel néfaste, qui consiste à régulièrement terminer lui-même les phrases de l’élève ou à reformuler ses propos de manière abusive. Certes il n’est pas toujours possible, selon le contexte, de prendre le temps de laisser chacun s’exprimer, à tel point que le réflexe naturel consiste à parler pour l’élève, à la place de l’élève, mais on percevra aisément les limites de ce type de comportement. Aussi est-il important de réserver certains moments de la vie de classe à cette “ perte de temps ”, moments que nous nommons discussion philosophique car nous accordons à l’élève le temps de penser sa propre pensée, défaillances, erreurs et incompréhensions comprises, puisqu’elles sont la réalité de sa pensée, réalité qu’il serait inopportun de gommer. D’autant plus que l’élève prend l’habitude de ce secours artificiel et non sollicité. Ce qui n’empêche nullement, comme nous le verrons plus tard, d’aider activement un élève en lui proposant des idées qu’il n’arrive pas à articuler, mais il sera préférable que d’autres élèves jouent ce rôle.
Quatrièmement, l’intérêt de ce rituel du lever de main porte sur la capacité de l’élève à se distancier de lui-même, à se décaler dans le temps, à ne pas être dans l’impulsion et l’automatisme. Bien souvent, l’élève qui lâche des mots dès qu’il les “ ressent ”, ne prend pas le temps de construire son discours, et souvent ne retient pas ce qu’il vient de dire : il suffira de lui demander de se répéter pour s’en apercevoir. Si ce n’est qu’il n’osera pas, par crainte, par honte ou par timidité, assumer à nouveau cette parole aux oreilles de tous. Qui n’a jamais fait en classe l’expérience de l’élève qui, dans le brouhaha de la classe lance des idées, idées qu’il n’osera pas répéter une fois que tous écoutent attentivement ce qu’il a à dire. Ce qui nous amène au cinquième point : la singularisation de la parole. Oser parler de manière singulière en tant qu’individu qui s’adresse à ses pairs, à l’ensemble de la cité, avec toute la dimension de la prise de risque que cela implique. Il y a là une pratique qui n’est pas naturelle chez chacun, et qui exige un certain travail, une certaine expérience que l’enseignant se doit de favoriser. Au travers des formes, il ne s’agit de rien de moins que d’apprendre à assumer une singularité explicite et articulée, assumer la prise de pouvoir temporaire qu’elle représente, en prenant le risque de l’écoute, du regard des autres et de l’image de nous-même qu’ils nous renvoient. C’est prendre le risque d’exister ouvertement et pleinement face au monde.
La forme la plus simple de la demande de parole est celle couramment utilisée de la main ou du doigt levé. Mais il existe d’autres techniques pour inviter l’élève à se distancier de sa propre parole, pour lui apprendre à surseoir et temporiser, à retarder son geste en attendant une occasion favorable, à façonner au mieux son idée avant de l’exprimer, à sortir de l’immédiat et se décentrer pour prendre en compte le groupe tout en se séparant de lui. On peut utiliser un bâton de parole, voire un micro, qui circule dans le groupe, et nul ne peut parler sans le détenir. Ou bien celui qui vient de parler invite quelqu’un d’autre à prendre la parole. L’important, comme nous l’avons dit, est de redonner du sens au geste, comme moyen d’établir un rapport à la collectivité, pour lui rendre sa valeur symbolique, et extraire la règle de sa gangue réduite de simple autorité, afin de lui faire jouer pleinement son rôle éducatif.
4- Rester sur une idée
Cette règle est sans doute sur le plan cognitif une des plus fondamentales, qui exige de porter en permanence le regard sur un sujet donné, de rester et de se concentrer sur une idée donnée, afin d’en discuter, de l’approfondir, de l’analyser, afin de l’illustrer et de la problématiser. Clef de tout exercice intellectuel, à la fois son fil d’Ariane et sa substance, le sujet, comme objet de réflexion, doit en permanence être présent à l’esprit de chacun. Ceci n’est pas toujours évident, dans la mesure où toute discussion, où toute réflexion, attirera notre regard sur des pistes annexes, vers des connexions associatives, digressions plus ou moins légitimes et utiles, voire sur des enjeux de métaréflexion qu’il s’agit d’évaluer sans pour autant abandonner le sujet premier. Tâche d’autant plus ardue que nos exercices de discussion se réalisent à voix multiples et croisées, multiplicité et croisement dont l’entrelacs provoque d’innombrables occasions de dériver et de se perdre en voies parallèles, chemins broussailleux et impasses sans retour. L’écoute des autres, quand bien même nous la recommandons ou l’imposons comme règle, nous offre la permanente tentation d’oublier le sujet à traiter, pour ne plus que réagir et rebondir aux diverses paroles que nous entendons. Pour caractériser le problème général posé ici à la pensée, reprenons l’idée de Platon, qui nous enjoint de saisir simultanément le tout et la partie, chacune de ces perspectives, prise isolément, pouvant piéger la pensée dans une partialité inadéquate. Suivre un sujet implique donc des actes et des fonctionnalités parfois contradictoires. Voyons-en quelques-unes, avant de voir par la suite dans quelle mesure cette diversité conflictuelle participe à la construction de la pensée.
Tout d’abord, il s’agit de pouvoir contempler une idée, avant de tenter d’établir son utilité, et surtout avant de se demander si l’on est d’accord ou pas avec elle. Cette dernière réaction en particulier, souvent assimilable à un simple réflexe, incarne l’obstacle premier à la compréhension de bien des paroles et bien des textes. La prise de position, ou réaction, précédant généralement en rapidité opératoire la compréhension, cette dernière se trouve souvent faussée par la première. Suivre un sujet, c’est donc en tout premier lieu, selon l’injonction cartésienne, suspendre son jugement, retenir son approbation ou son refus, maintenir à l’écart la subjectivité, afin d’accueillir l’idée avec un esprit relativement ouvert. Aussi s’agit-il d’inviter les participants à la discussion à éviter en un premier temps toute déclaration du type “ Je suis d’accord avec cette phrase ” ou “ Cette idée est fausse ” ou encore “ Cette idée ne me plaît pas ”. Car il s’agit avant tout de soupeser l’idée, de l’examiner, de la comprendre.
S’il s’agit d’une question, il est crucial de l’apprécier initialement en tant que question, sans la parasiter par l’automatisme d’une réponse. Gardons-nous de ce réflexe qui, comme tout autre réflexe de la pensée, relie deux concepts ou idées, les déplace ou les greffe l’un sur l’autre, voire les télescope, sans prendre le temps de les appréhender séparément et observer ce qu’ils contiennent en eux-mêmes. Répondre à une question, c’est la réduire à presque rien, c’est lui enlever son potentiel interrogatif, c’est en fixer l’acception en un aboutissement unique, plutôt que d’envisager l’ampleur du problème posé et envisager le potentiel interrogatif de cette question Puisqu’une question pose par définition un problème, puisqu’elle est un problème, pourquoi ne pas inviter le participant à contempler le problème, pour lui-même ? Moment esthétique, comme au musée, lorsqu’on se laisse interpeller par une œuvre, au lieu de se précipiter au pas de course sur la suivante, au lieu de regarder sa montre et se demander ce qu’il reste à voir pour terminer la visite.
Ce n’est pas qu’il soit interdit de répondre à la question, bien au contraire, et comme nous le verrons par la suite, pas plus qu’il n’est interdit d’objecter ou d’être d’accord avec une idée donnée, mais il nous paraît simplement utile de décomposer artificiellement le mouvement, afin d’en saisir les moments et de leur ôter leur caractère enchaînant, compulsif et systématique. Les compétences sont diverses, et puisqu’il s’agit d’un jeu, justifions cette exigence en expliquant que sa dynamique s’installe et se structure en des moments où les actions, les rôles et les fonctions diffèrent. La plupart des sports relèvent ainsi de stratégies diverses, et l’entraînement consiste pour partie à travailler séparément les dextérités, les subtilités et les techniques qui leur sont attachées.
Il nous est conseillé de prendre le temps, de contempler les idées, puisque les idées sont à la fois l’objet et la finalité de notre exercice. Rappelons qu’à une certaine époque, avant que s’instaure le règne de l’utilité et de la subjectivité, il était hautement recommandé, en Grèce antique par exemple, de contempler les idées, en particulier celles qui nous semblaient en valoir la peine, celles qui justement édifiaient l’architecture de la pensée elle-même, par exemple les grands transcendantaux, tels le vrai, le beau, et le bien. Le concept de transcendantal, comme Kant nous l’explique, renvoyant à ce qui conditionne et permet à la pensée de se constituer.
Mais la règle qui consiste à exiger de contempler les idées est difficile à mettre en place. Car si l’esprit des élèves est quelque peu rebelle à ce ralentissement du mouvement de l’esprit, qu’en est-il de l’enseignant ? Y arrive-t-il lui-même ? N’est-il pas habitué à vouloir faire avancer coûte que coûte la discussion ? Par souci d’efficacité. Par crainte d’ennuyer ou de brimer les élèves. Par incertitude quant à la valeur des idées en question. Parce qu’il attend des idées spécifiques qui seules l’intéressent. Par phobie du vide. Par simple impatience ou manière d’être. Poser la pensée, respirer, interrompre le processus qui se met en place, installer artificiellement des interstices dans la discussion, autant d’obstacles courants et compréhensibles qui retiennent l’enseignant. Pourtant, si l’on pense à tous ces enfants, et adultes, qui vivent dans la fébrilité du monde, dans le zapping permanent et le souci de gagner du temps, si ce n’est à l’école que l’on apprend à prendre le temps de penser, à rendre leur valeur aux idées en soi, quand et par quel heureux ou miraculeux hasard l’apprendra-t-on ?
De manière plus active, rester sur une idée, c’est l’expliquer, sans commentaires annexes, c’est la reformuler, c’est demander de la rappeler en l’énonçant. Ainsi, si un participant veut questionner une idée ou lui adresser une objection, demandons-lui d’abord de réitérer l’idée à laquelle il veut faire subir un sort. Si un participant veut répondre à une question, demandons-lui de redire la question à laquelle il prétend répondre. Surtout lorsqu’il a déjà répondu, et que l’on s’aperçoit au travers de sa réponse, que visiblement, il ne se souvient guère de ladite question. Si un auditeur croit avoir compris l’idée d’un camarade, demandons-lui de vérifier ce qu’il comprend auprès de l’auteur de l’idée, quitte à ce que celui-ci ne sache pas s’il s’est mal exprimé ou s’il n’a pas été écouté. Autrement dit, avant d’aller plus loin, vérifier si le point de départ et d’ancrage est clair et présent. Ces simples demandes constituent souvent, en elles-mêmes, un exercice en soi, qui amène chacun à prendre conscience des mauvaises habitudes que nous entretenons dans notre hygiène de pensée : nous voulons dire quelque chose, mais nous ignorons de quoi nous parlons, à quoi nous répondons.
N’oublions pas néanmoins que si le jeu consiste parfois à rester sur une idée pour prendre le temps de l’apprécier, il est aussi mouvement, puisqu’il invite le participant à traverser diverses étapes. Et c’est la capacité de suivre ces étapes, de répondre aux diverses exigences et de savoir changer de rôle, un rôle qui dès lors est mis à l’épreuve.
5- Réhabiliter le problème
Nous avons déjà évoqué le concept de problème, mais il nous semble devoir le reprendre comme un principe en soi, constitutif de l’exercice philosophique. Aussi parce qu’il s’agit de réhabiliter le problème, et le considérer comme partie intégrante de l’enseignement, plutôt que comme un obstacle, regrettable entrave qu’il s’agirait d’éliminer coûte que coûte quand ce n’est pas de l’occulter. La difficulté repose sur la mauvaise presse que s’attire le problème lui-même : le problème en tant que problème. “ Il n’y a pas de problèmes ” dit l’enseignant par ses paroles, par ses actions, par ses silences. Il a sa conscience pour lui. Pour l’élève, il y en a un. Parfois le pire des problèmes : lorsque l’élève ne comprend pas et ne sait pas même exprimer la nature du problème. S’il le savait, le problème commencerait déjà à disparaître. Pour l’instant, il ne fait que ressentir une douleur et dire “ je n’aime pas cette matière ”, quand ce n’est pas “ je n’aime pas ce professeur ”. Réflexe on ne peut plus approprié, défense de l’intégrité territoriale de l’être : l’autre nous inflige une douleur, il est normal qu’il soit perçu comme un ennemi. Moins l’élève est capable d’exprimer le problème, plus grande est la douleur, plus sera vive la réaction, que ce soit par la confrontation ou par l’absence.
Face à cela, à quoi sert-il de parler ? Parler sert avant tout à problématiser. Problématiser ne revient pas uniquement à inventer un problème, c’est aussi articuler un problème bien présent, articulation qui ne permet pas nécessairement de résoudre le problème, mais au moins de l’identifier et de le traiter. Un problème n’a pas à être nécessairement résolu, bien qu’il puisse l’être. Un problème a surtout à être aperçu, à être vu, à être manipulé, à devenir substantiel. En tant que pratique, la peinture sera toujours un problème pour le peintre, comme les mathématiques pour un mathématicien, comme la philosophie pour un philosophe. L’illusion la plus catastrophique est celle qui laisse croire qu’il n’en est rien, celle laissant croire que l’enseignant est un magicien, au sens traditionnel du terme, qu’il a des pouvoirs particuliers, plutôt que de montrer qu’il est un illusionniste, quelqu’un sachant simplement tirer les ficelles car il voit comment celles-ci qui s’entrelacent et s’organisent.
Mais pour ce faire, il s’agit avant tout de réhabiliter le concept de problème. “ Il n’y a pas de problème ! ”, “ Je n’ai pas de problème ! ”, la fierté ou le souci de la tranquillité nous obligent à renier l’idée même de problème. Le problème est ce qui nous empêche d’agir, il est un obstacle, un frein, un ralentisseur de vitesse. Et si justement en cet effet apparemment pervers se trouvaient sa substance et son intérêt ! Car ne sommes-nous pas toujours tentés de réduire une matière et son apprentissage à un ensemble de données, à quelques opérations diverses, autant d’éléments pédagogiques quantifiables, vérifiables et notables ? Néanmoins, qu’en est-il de l’esprit, entre autres celui de la matière enseignée ? Certes l’esprit filtre à travers les diverses activités proposées, mais pourquoi faudrait-il l’abandonner à son triste sort, celui de facteur aléatoire, accidentel et secondaire, qui n’est guère une préoccupation en soi ? D’autant plus que cette connaissance intuitive n’est pas donnée à tous les élèves. Si certains sont préparés à la recevoir pour des raisons et des circonstances qui ne sont guère du ressort de l’enseignant, les autres, ceux qui buttent sur l’étrangeté de la démarche, entrent justement dans son champ d’action. Pour cela faut-il encore que la matière soit pour l’enseignant un problème, qu’elle ne soit pas rangée soigneusement au rayon des articles ménagers. Rangement que l’élève en difficulté viendrait déranger.
Les difficultés de l’élève servent un but bien précis : repenser la matière enseignée, sa nature, son efficacité, sa vérité et son intérêt. Si tout cela va de soi, les difficultés deviennent une simple entrave dont il faut se débarrasser au plus vite afin d’avancer. Le programme devient alors l’alibi par excellence, le refuge de la crainte et de l’insécurité. Nous avons toutes ces choses à apprendre, qu’avons-nous le temps d’étudier l’esprit ? Nous avons à nous concentrer sur la matière. Nous oublions un peu vite la leçon des Anciens, et nous nous retrouvons avec une matière sans âme, réduite à des apprentissages et des performances. Utiles certes, mais tellement réducteurs.
Aussi s’agit-il, en tout premier lieu de pouvoir dire : “ J’ai un problème ”, “ Cette tâche spécifique me pose problème ”, ce qui peut aussi s’articuler sous la forme de “ Je ne sais pas ”, “ Je ne peux pas répondre ”, ou simplement “ Je ne comprends pas ”. Ces mots, qui par leur absence relative de contenu ou de réponse peuvent paraître ne rien signifier et ne rien apporter à la discussion, ce simple aveu d’une difficulté, qui peut le laisser assimiler à un échappatoire ou à un rituel de politesse, sont au contraire lourds de conséquence. Déjà, ces mots posent de manière ouverte l’existence du problème, ce qui ouvre la porte à la suite des événements. En lui reconnaissant ce statut productif, on extrait le problème de sa gangue de culpabilité et de mauvaise conscience, qui en général interdit de parole celui qui souffre de l’opacité d’une connaissance ou d’une pratique. Ce dernier devient au contraire agent de réflexion. Car le problème de l’un devient le problème de tous, en premier lieu pour une bonne raison : il est évoqué. Ensuite, parce qu’il se peut fort bien que ce problème soit aussi celui d’autres personnes, qui, elles, n’ont pas su ou pas pu l’avouer ou le reconnaître. Mais il est aussi le problème de ceux qui pensent ne pas avoir de difficulté avec le problème en question, qui vont devoir vérifier publiquement leur capacité de le traiter. Car une fois que le problème de l’un devient le problème de tous, chacun est invité à s’en occuper par une phrase apparemment anodine prononcée par l’auteur du problème : “ Je ne comprends pas et je demande de l’aide ”. De là, ceux qui pensent être capables de traiter le problème s’en expliqueront, à tour de rôle ou par une quelconque procédure de sélection. Jusqu’à ce que celui qui avait exprimé une difficulté s’en satisfasse, ou en concluant après quelques essais infructueux à une impossibilité temporaire de résolution.
Certes ce processus est lent, qui oblige à piétiner sur un aspect spécifique et réduit du cheminement, peut-être même un aspect annexe, mais il n’est pas question de faire “ comme si ”, de passer outre comme si de rien n’était. Et si on laisse le moindrement filtrer ou s’exprimer l’impression que le problème à traiter empêche la procédure “ d’avancer ”, autrement dit laisser entendre qu’il y a mieux à faire, alors tout le travail de réhabilitation du problème et de l’aveu d’ignorance sera réduit à néant. Ce qui ne signifie pas qu’il faille non plus s’embourber pendant toute une séance dans une seule et unique difficulté ; une procédure “ garde-fou ”, telle celle qui propose de limiter toute tentative de résolution d’un problème à trois essais consécutifs, permet de s’extraire d’une affaire épineuse sans l’avoir pour autant ignorée.
Ainsi il n’y aurait pas les problèmes dignes de ce nom, bien intellectualisés, baptisés du pompeux nom de problématique, et les autres, les “ bêtes ” problèmes, ceux qui émanent du manque, de l’ignorance et de l’incompréhension. Une telle distinction encouragerait la négation de la dimension réelle, profonde et existentielle du problème, inavouable, pour ne plus exprimer que les problèmes qui résulteraient des élucubrations des esprits subtils. L’enseignant lui-même n’oserait plus avoir de problèmes, même inavoués, et pourquoi se lancerait-il alors dans des procédures risquées, dont il ne peut prévoir ni les embûches, ni l’aboutissement de l’exercice ? Un exercice comme celui de la réflexion en commun, pris dans toute sa rigueur, impose à chacun une certaine humilité minimale, et en tout cas une capacité d’admettre ouvertement la difficulté et l’erreur, un refus de la toute-puissance, et une acceptation de la dépendance sur autrui.
6 – Articuler des choix
Comme nous l’avons en partie expliqué, l’atelier démarre d’emblée par une prise de risque, de la part de l’élève et de la part de l’animateur, prise de risque du choix et du jugement, qui se prolonge tout au long de l’exercice. En réfléchissant sur ses choix, en les articulant, tout en sachant qu’il devra les argumenter, voire les justifier, afin d’en approfondir la teneur et d’en vérifier le contenu, l’élève prend un risque qu’il ne faut pas sous-estimer. Périodiquement, certains n’y arriveront d’ailleurs pas. Risque d’exprimer ce qu’il pense, risque de parler devant les camarades, risque de parler devant l’enseignant, risque de ne pas pouvoir justifier ses choix, crainte de “mal faire”, etc. Pour l’enseignant, la prise de risque est d’entendre des choix et des arguments qui pourront lui sembler aberrants, inquiétants, voire faux. Sans pour autant manifester sa désapprobation ou son inquiétude. Tout en continuant la procédure de questionnement, à cet élève ou à un autre. Certains enseignants avouent en outre leur impatience face à ce genre de situation, révélatrice d’une certaine inquiétude.
En général, l’atelier commence par une question. Une question ouverte, et non fermée, car elle ne fait pas appel à des connaissances spécifiques qui autoriseraient une autorité quelconque à valider ou invalider la réponse comme étant bonne ou mauvaise, vraie ou fausse. Car il s’agit de produire une pensée, et non de fournir la bonne ou la vraie réponse. Exigence qui peut surprendre l’élève, peu habitué à ce type de demande. Car si l’exigence de vérité n’est pas au rendez-vous, il en est d’autres qui ne sont pas moins exigeantes. La réponse répond-elle à la question ? L’esquive-t-elle ? Répond-elle à une autre question ? La réponse est-elle claire ? Est-elle un minimum justifiée par un argument ? Déjà, il s’agit nécessairement de produire des phrases, plutôt que de manifester un simple assentiment ou articuler un mot isolé. Il s’agit de construire la pensée, et non de vérifier l’apprentissage d’une leçon.
L’incertitude face à l’absence de validation immédiate et assurée gênera d’ailleurs souvent les élèves les plus “ scolaires ”. Ils auront l’impression d’être livrés au néant. Ils demanderont et redemanderont ce qu’il faut faire, incrédules, ayant du mal à croire qu’on réclame d’eux uniquement de penser, sans attendus de réponses spécifiques, validées d’avance. Lorsqu’il s’agit d’une discussion avec l’ensemble de la classe, ces élèves appliqués et studieux se sentiront abandonnés par le maître, trahison les privant d’une présence sécurisante, de la garantie habituelle et réconfortante d’un jugement certifié conforme. Même les “ cancres ” seront inquiétés par ce type de procédure, qui les soustrait eux aussi à la spécificité de leur statut, volontaire ou non, dans lequel ils se sont installés. Car c’est au jugement de l’ensemble de la classe que doit se mesurer chaque élève, un jugement mouvant et inattendu, imprévisible et déstabilisant, auquel il est demandé de se confronter. Confrontation autrement plus périlleuse que celle de la quasi-incontestable autorité du maître, même si la parole revêt une apparence plus libre et spontanée. Ainsi, ce qui pouvait paraître apparemment trop facile s’avère au contraire ardu, très ardu pour certains.
Toutefois, comme nous l’avons déjà dit, afin de dédramatiser la prise de risque auprès des élèves, l’exercice est souvent présenté comme un jeu, comparable à un autre, et l’aspect ludique doit être périodiquement rappelé, en alternance avec des moments plus sérieux. Pour les enfants qui ont du mal à exprimer leur opinion, il s’agit d’être patient, de recourir à eux de temps à autre afin qu’ils ne se sentent pas exclus, quand bien même ils ne réussissent pas à verbaliser aisément, ou même très peu, et à rassurer les timides en leur proposant de parler plus tard s’ils se sentent coincés. L’enseignant devrait ainsi veiller à ce que tous puissent s’exprimer un minimum, en s’assurant que les plus loquaces n’écrasent pas les autres, danger récurrent de toute discussion. D’autant plus que ceux qui produisent de l’oral de manière plus laborieuse ne sont pas nécessairement les moins intéressants et les moins profonds.
Répondre à des questions de connaissance présuppose un apprentissage spécifique : une leçon apprise, des éléments d’information retenus. Articuler une pensée implique la totalité de l’être. C’est en ce sens que le discours ne renvoie plus à de simples enjeux de savoir théorique et formel, mais à un savoir-faire, voire à un savoir être. Car c’est la pensée tout entière qui est convoquée lorsqu’il s’agit de faire un choix. De là l’intérêt de se risquer à l’articulation d’un choix, conçu comme acte inaugural de la pensée. Reste ensuite à justifier la proposition initiale en mobilisant les connaissances acquises, en élaborant les arguments et les raisonnements possibles, en tentant de répondre en un second temps aux questions et aux objections. Quitte à revenir sur son jugement initial, décision on ne peut plus fondamentale, car elle manifeste une certaine liberté de pensée et un rapport honnête et courageux aux autres, ainsi qu’à ce que l’on peut nommer une quête ou un souci de vérité.
Dernier point important au sujet du jugement : il correspond à une réalité existentielle dans la mesure où les connaissances sont généralement ce qui nous permet d’effectuer des choix, jour après jour. Une telle pratique permet donc de rendre sa réalité usuelle à l’enseignement, puisqu’il ne renvoie plus uniquement à la classe, aux bonnes et mauvaises notes et à la succession prévisible des années, mais à ce qui constitue le rapport entre un sujet et le monde qui l’entoure, le monde qu’il habite. Il s’agit donc de travailler au corps la tendance schizophrénique de la double vie, du double langage, entre l’école et la rue, entre les livres et la maison, entre la classe et la cour de récréation, hiatus qui affaiblit énormément – quand il ne mine pas carrément – le travail de l’enseignant et le processus d’éducation auquel est censé participer l’enfant. Ainsi, au cours de l’exercice philosophique, l’élève sera amené à effectuer des choix pour répondre aux questions, à analyser ses propres choix et ceux de ses camarades, à justifier ces choix, à déterminer le degré de validité des arguments invoqués, et même à poser des jugements sur les comportements qui président aux discours, aux réactions et aux réponses de chacun. Autant de décisions cruciales, qui se doivent d’être lentement construites et examinées, car non seulement elles ne sont pas annexes au fonctionnement quotidien, mais elles en forment la substance et le creuset. Et s’il s’agit de réfléchir, discuter et travailler plus directement la matière spécifiquement scolaire, l’appropriation de cette matière en sera facilitée, puisque l’élève sera invité à la mettre en œuvre, à la rendre opératoire, à prendre position par rapport à elle, pratique qui interdit une sorte d’extériorité formelle au travail de classe. Nul ne peut dès lors se cantonner à une position extérieure, puisque la règle du jeu pose comme préalable de se situer par rapport à la matière étudiée. La vie est rendue à la matière, la matière est rendue à la vie.
7 – Questionner,argumenter,approfondir
S’il est un principe fondamental qu’il s’agit d’inculquer dans notre affaire, c’est le réflexe du questionnement, questionner l’autre et questionner soi-même, questionner tout ce qui est énoncé. Or il est un accès privilégié au questionnement : le « pourquoi ? », élément dynamique et déclencheur, fondateur de la pensée et du discours, qui procurera à la pensée et au discours sa substance, en lui demandant de s’étayer et de s’approfondir. Le « pourquoi ? », auquel fait écho un « parce que », répond à divers types de demande : « Qu’est-ce qui nous fait dire cela ? », « De quel droit dit-on cela ? », « Comment expliquer qu’il en soit ainsi ? », « Dans quel but dit-on cela ? », « Que signifie ce que l’on dit ? », « Qu’implique ce que l’on dit ? ». Sont questionnés à la fois le sens des paroles, la raison d’être de leur objet, la légitimité de leur auteur. Ce processus multiforme déclenché par un puissant adverbe interrogatif, invite à extraire le discours de sa plate et immédiate évidence, afin d’en démêler les arcanes, d’en éclairer la genèse, d’en entrevoir les implications et les conséquences. « Mot magique » dirons-nous avec les plus jeunes, afin de leur laisser entrevoir la force et les innombrables possibilités du questionnement contenu au sein du « pourquoi ? ». S’il est un terme qui permet de montrer le pouvoir des mots, c’est celui-là, qui, lancé à un interlocuteur, le laisse souvent embarrassé, alors que l’auteur du discours doit simplement rendre compte un minimum de ses propres paroles.
Les élèves saisissent bien la portée du « pourquoi ? », car une fois initiés à ce terme, lorsqu’ils doivent poser une question, ils s’empressent de l’utiliser à répétition, si ce n’est à tort et à travers, comme solution de facilité : « Pourquoi as-tu dit ça ? ». Car si « Combien ? », « Quand ? », « Comment ? », « Où ? », « Qui ? », « Quel ? », « Que ? » ou « Est-ce que ? » requièrent pour leur utilisation la compréhension de circonstances spécifiques et l’élaboration d’une phrase appropriée, le « Pourquoi ? » peut toujours être casé de manière simple, sans gros effort de l’imagination. À tel point qu’il sera parfois utile d’en suspendre momentanément l’utilisation, dans le cas d’une systématisation abusive qui semble gêner la progression du travail. Car si la question est facile à poser, il est d’autant plus difficile d’y répondre ; or celui qui questionne se doit aussi de réaliser un véritable travail, permettant de faire émerger de nouvelles idées, en posant des problèmes spécifiques à l’interlocuteur, et non en trouvant un « truc » qui peut être casé à tout propos.
Le questionnement impose donc à l’élève de justifier ses propos, de fournir des arguments, des preuves, des raisonnements, autant de nouvelles propositions qui en principe devraient à la fois soutenir la proposition ou les propositions initiales, et en approfondir la teneur. Dans cette perspective, sont tenus en échec un certain nombre de type d’arguments classiques qui, s’ils ne sont pas prononcés ouvertement, font pourtant office de loi, surtout en classe : l’argument d’autorité par exemple. Car dans l’exercice philosophique, il n’est plus question de se référer au maître, aux parents ou à un livre quelconque pour établir la valeur d’une idée. Non pas que ces sources « premières » de la connaissance soient invalidées d’office, loin de là – il serait d’ailleurs difficile et vain de prétendre s’en abstraire -, mais elles trouveront leur place uniquement dans le cadre d’une construction intellectuelle, c’est-à-dire en un agencement de propositions établies par l’élève. En ce sens, il devient l’auteur de son propre discours, même si l’empreinte d’une quelconque influencepeut se faire sentir de manière appuyée.
Le processus dans lequel est engagé chaque participant à travers ce questionnement est nommé, chez Platon, principe anagogique. Il s’agit de retracer en amont l’origine d’une pensée particulière, afin d’en vérifier la teneur, car c’est en cette origine que se retrouve le véritable sens d’une idée, et non en son apparente évidence. De plus, le processus de remontée dans l’être de l’idée rend à la pensée sa vigueur, ce qui permet de passer du stade de l’opinion à celui de l’idée. En effet, la distinction entre l’opinion et l’idée se résume au travail qui l’engendre et l’entoure. Une même proposition peut donc être considérée opinion ou idée selon le mode de lecture ou d’analyse utilisé, selon le degré d’intensité de l’interprétation. Enfin, cette enquête sur la causalité d’une idée fournit aussi dans le temps un certain nombre d’idées annexes, corrélats de l’idée initiale, qui éclairent cette dernière. Certaines contradictions ou incohérences émergent, qui s’offrent à l’étude et à la critique. Cette confrontation entre les différentes idées devient ainsi l’occasion, à travers un effort de cohérence que l’on peut assimiler à un souci de vérité, d’identifier et de retravailler divers postulats jusque-là restés inconscients dans l’esprit de leur auteur. Confronté à une multiplicité de propositions, l’intellect se doit d’en découvrir l’unité fondatrice et causale.
Ainsi, le travail qui consistait en premier temps à fournir des arguments pour répondre à des questions quant à la justification d’un propos initial, se transforme rapidement en un travail d’approfondissement. L’argumentation pouvant pratiquement se réduire à un simple prétexte, celui d’une exploration ou d’un examen plus fouillé. Ce qui nous autorise à évaluer la légitimité d’une idée nonpar quelque canon établi a priori, ou par appartenance à un texte officiel, mais grâce au rapport qu’une idée spécifique entretient avec son environnement intellectuel. Mais pour réaliser un tel projet, il est nécessaire d’apprendre à poser des questions, exercice qui constitue un art en soi. Car si certaines questions, percutantes, facilitent le travail et donnent lieu à un approfondissement, d’autres au contraire trouvent porte close ou n’invitent nullement à la production de concepts.
Le travail du questionnement oscille entre deux écueils. D’une part la question qui ressemble à un cours, difficile à comprendre, avec un long préambule qui souvent contient déjà les réponses attendues : celles qui laissent l’interlocuteur sur le carreau, soit par incompréhension, soit parce qu’il sent bien que l’on n’attend de lui rien d’autre qu’un acquiescement. D’autre part la question vague qui ne demande rien de spécifique : le « Dis-m’en plus » peu inspirant qui n’invite à rien. Sur cet aspect du travail, davantage encore que sur d’autres aspects, l’enseignant apprendra des élèves, c’est-à-dire de la multiplicité, car il est difficile de prévoir quel genre de question opèrera plus qu’une autre dans un cas particulier : c’est uniquement grâce à l’expérience, « sur le tas », que cette pratique s’améliorera. Car s’il est plus facilement possible pour l’enseignant d’entrevoir un point aveugle ou une contradiction dans une parole donnée, ce n’est pas pour autant qu’il trouvera les mots qui feront mouche chez l’interlocuteur, lui faisant prendre conscience du problème interne que couve son discours. C’est pourquoi toute la classe est invitée à se pencher sur les propositions d’un « auteur », car chacun doit réaliser que ce n’est pas tant de donner « sa » réponse qui représente le véritable travail, que de forger les questions appropriées. D’autant plus qu’une vraie question exige de ne pas mettre de l’avant ses propres idées, ce qui implique un redoublement du travail : prendre conscience des idées que l’on véhicule, et réussir à taire ses propres concepts et convictions, les mettre de côté pour s’adresser à quelqu’un afin de savoir ce qu’il pense, sans chercher à lui communiquer la « bonne pensée » ou à induire un contenu. Critique interne, nous dit Hegel, qui interroge de l’intérieur une thèse, à distinguer de la critique externe, qui consiste à avancer arguments et concepts servant à objecter. Questionner, c’est faire accoucher, ce qui signifie que les idées doivent émerger chez celui qui est interrogé, et non être fournies clé en main par le questionneur. Questionner, c’est créer un interstice de respiration et non boucher un trou
8 – Singularité du discours
La singularité du discours présuppose une sorte d’originalité de ce discours, originalité qui en constituerait la spécificité. Pourtant, on pourrait difficilement affirmer que tout ce que l’on entend dans une discussion de classe possède une telle caractéristique d’originalité. Aussi sans exclure le côté parfois inattendu de certaines réponses, pour le moins surprenantes, proposons l’hypothèse que la forme première de la singularité est plutôt celle de l’engagement. S’engager sur une idée, prendre des options sur une idée, c’est la rendre singulière, ou personnelle, par un phénomène d’appropriation. Ainsi, régulièrement, au cours de l’exercice, l’élève devra prendre parti, que ce soit par la production d’une idée ou par son rapport aux idées des autres. Pas uniquement sur le fait d’être d’accord ou non, mais aussi sur la nature même du discours proposé, sa cohérence, sa logique ou sa justesse, le sien ou celui d’un autre. Parti pris qui, comme on l’a vu, devra dans la mesure du possible pouvoir être expliqué, argumenté, justifié, etc.
L’idée de déterminer sa position par rapport à une question donnée, quel qu’en soit le degré d’abstraction, implique un acte de réflexion, une prise de conscience, qui demande aux élèves un effort, à certains plus qu’à d’autres. Car il devient nécessaire de se poser consciemment la question du choix personnel, ce qui dans les petites classes n’est pas nécessairement un acquis. Pour que cet acte s’effectue, il s’agit tout d’abord ne pas tomber dans un premier piège : le réflexe de la répétition, très courant en ces âges. Dire comme les autres, fussent-ils les élèves ou le maître, c’est la tentation et la solution de facilité, le réflexe fusionnel si commun chez les enfants. Fusion avec le groupe, parce que cela fait moins peur, parce qu’on se sent moins seul ou parce qu’il faut faire comme les autres. Fusion avec le maître, parce qu’il est un adulte, parce qu’il est celui qui sait, parce qu’il doit avoir raison.
Pour cette raison, au cours de notre exercice, il est crucial que l’enseignant ne manifeste ni accord ni désaccord, tout au moins sur le contenu, et même sur la forme, ce qui ne l’empêchera nullement de revenir en d’autres moments sur un problème soulevé qu’il lui semble devoir traiter lui-même. Quant au rapport entre camarades, afin d’assurer qu’il n’y ait pas de répétition mécanique, une des règles du jeu consiste à interdire de redire ce qui a déjà été dit par quelqu’un d’autre, ou par soi-même, au risque d’un symbolique “mauvais point” ou d’une élimination momentanée. On observera parfois certains élèves qui tentent d’articuler différentes formulations d’une même réponse afin de reprendre l’idée et ne pas pour autant être sanctionnés par la règle du jeu, ce qui en soi est un mécanisme intéressant. Car il s’agira pour tous de se demander si cette « nouvelle » réponse est identique ou non à la précédente, ou si elle a produit une quelconque nouveauté conceptuelle. L’animateur pourra à tout moment demander à la classe : “Est-ce que quelqu’un a déjà dit cela ?”. Et pour que la proposition puisse être refusée, il faudra pour commencer qu’au moins un élève reconnaisse qu’il s’agit d’une réponse identique à celle de quelqu’un d’autre : il devra expliquer en quoi ces réponses sont semblables et de préférence nommer l’auteur de la réponse initiale. En cas de doute ou de dissension, l’animateur pourra proposer une discussion et provoquer un vote sur la question, vote au cours duquel chacun devra trancher le litige.
Ne pas répéter. Assurer qu’une réponse répond à la question. Déterminer si la question est une question, si elle porte bien sur l’objet qu’elle est censée questionner. Déceler les incohérences d’une proposition. Diverses règles parmi d’autres, autant d’exigences diverses qui invitent chacun à arbitrer la discussion en usant de son jugement. Un tel fonctionnement présente l’avantage suivant : il oblige déjà chacun à écouter et à se rappeler ce que disent les autres, puisque à tout moment l’élève peut être sollicité afin d’évaluer la légitimité de ce qui a été dit. Toute analyse, toute lecture particulière et personnelle des idées évoquées pourra infléchir la discussion dans un sens ou dans un autre, puisque les discours s’élaborent en réciprocité et ne sont pas imperméables les uns des autres : ils se valident ou s’invalident mutuellement, ils s’approfondissent ou se problématisent entre eux. Ce qui nous conduit à un autre aspect de la singularisation : le principe de responsabilité, sous-jacent à l’exercice.
Certes, toute discussion implique un certain sens de responsabilité, ne serait-ce que par rapport aux idées que l’on émet soi-même. Mais dans la mesure où nous interdisons de sauter du coq à l’âne, où nous empêchons de passer d’une idée à une autre au gré des inspirations individuelles sans établir de lien, du fait que le groupe entier reste sur une idée donnée avant de passer à une autre, afin de la travailler, chacun devient implicitement responsable des idées des autres. Que ce soit en la questionnant, afin de lui faire dire ce qu’elle n’a pas encore dit, en posant sur elle des jugements de forme, ou en provoquant des problèmes de fond, on prend une lourde responsabilité, vis-à-vis de l’auteur de l’idée et de la classe tout entière. Le fait de se décentrer, afin de s’occuper en priorité des idées du voisin, offre de manière paradoxale un degré accru de singularisation, au travers de la prise de responsabilité. Se distancier de soi-même signifie en effet devenir responsable, puisque l’on est plus que jamais à l’écoute des autres, puisque l’on répond aux autres.
Autre aspect crucial du caractère singulier de l’idée : la justification ou l’explication. Car si une idée donnée peut avoir un sens commun et obvie, voire une signification apparemment objective, elle peut aussi trouver dans l’esprit et les mots de son auteur ou de son interprète un contenu très particulier. Aussi incongru soit ce contenu, il ne sera pas question de l’écarter d’un simple revers de main. D’autant plus que certaines propositions apparemment absurdes, ou dotées de tournures étranges, prendront réellement corps de manière inopinée après quelque explication ou modification. Des mots spécifiques connaîtront aussi une telle dérive, utilisés en des acceptions étranges, quand ils ne s’installeront pas, à l’occasion, carrément dans le contresens par rapport à leur définition classique. Dans ces divers cas de figure, que ce soit paralogisme, incompréhension ou inadéquation, le rôle de l’enseignant ne sera pas de « rectifier » des propos qui ne lui appartiennent pas, mais de faire confiance à l’auteur et au groupe, quitte à attirer l’attention de tous et solliciter leur avis sur un point particulier ou un autre, en évitant, bien sûr, de projeter une quelconque « bonne » pensée téléguidée. Il fera confiance au groupe, et il s’apercevra que bon nombre « d’erreurs de tir » se rectifieront d’elles-mêmes, procédure plus gratifiante, pédagogique et cohérente que s’il corrigeait lui-même, bien que nettement plus lente.
D’ailleurs nul ne peut sans son accord le moindrement modifier la proposition d’un participant. Déjà parce que toute proposition ou idée inscrite au tableau est signée, ce qui singularise d’office la pensée. Le « on » n’a pas ici droit de cité. Toute suggestion de modification ou d’explication par un camarade devra donc être acceptée par l’auteur pour pouvoir être inscrite au tableau. Mais le groupe peut sanctionner globalement par le biais d’un vote majoritaire une proposition qui lui paraît inadéquate : par exemple une proposition qui est hors sujet. C’est d’ailleurs le seul rôle imparti au groupe en tant que groupe : faire office de jury, afin d’approuver ou de sanctionner une hypothèse ou une analyse, puisque l’animateur de la discussion n’a pas ce droit. Il sera toutefois utile de spécifier que cette fonction d’arbitrage est d’ordre purement pragmatique, en expliquant que le groupe peut tout à fait se tromper, dans la mesure où une personne seule peut avoir raison contre tous. Mais avouons qu’en classe, en général, le groupe reste, dans ses jugements, relativement pertinent, suffisamment en tout cas pour permettre de l’utiliser comme référent, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Restons toutefois ouvert à des revirements de situation significatifs, et pour cela il est conseillé de barrer les propositions refusées plutôt que de les effacer.
9 – Le lien substantiel
Nous reprenons à notre compte cette expression de Leibniz, car elle spécifie pour nous de manière précise ce qui distingue la discussion « ordinaire » de la discussion philosophique. Pour cet auteur, la réalité ou substance des choses ne réside pas tant dans leur être distinct, que dans leur rapport à ce qu’elles ne sont pas. Ce qui distingue une entité fait plutôt appel à définition, analyse relativement statique d’un objet figé et isolé, tandis que saisir une entité dans son rapport à une ou plusieurs autres invite à la problématisation, posture intellectuelle plus vivante et dynamique. Non que la définition soit exclue, mais parce qu’elle se voit subordonnée à un ensemble de situations dont le caractère mouvant modifie et travaille au corps le sens qui ne peut plus être défini a priori. Le travail de la pensée consiste dès lors à éprouver la résistance d’une idée ou d’un concept en les frottant à ce qui leur paraît en un premier temps étranger, révélant ainsi les limites constitutives de leur être. Pour être cohérent avec nous-même, proposons le principe que le rapport entre discussion « ordinaire » et discussion « philosophique » consiste justement en l’explicitation du rapport, rapport constitutif et déterminant, car l’explicitation du rapport modifie en les éclairant et donc en les modifiant les éléments mêmes du rapport.
Pour être plus concret et visible, prenons le premier degré de ce rapport, tel que nous l’intégrons à notre pratique : la reformulation, utilisée comme outil de vérification de l’écoute. Comment pourrions-nous prétendre mener une quelconque discussion, et a fortiori une discussion philosophique, si les interlocuteurs ne s’écoutent guère ? D’autant plus qu’une des caractéristiques de l’échange philosophique pourrait consister en la contiguïté et le rapprochement entre les arguments afin de faire émerger les éléments essentiels de l’architectonique. « Enlève ta chemise, et viens pour le corps à corps ! » enjoint Platon. Non pas un corps à corps destiné à savoir qui l’emportera, mais dans le but de mettre à l’épreuve les idées et les rapports qu’elles entretiennent en elles-mêmes et entre elles. Ce ne sont jamais la présence des mots ou leur existence que l’on peut contester, mais uniquement leur utilisation ou leur fonction, c’est-à-dire le lien occasionnel qu’ils conservent avec d’autres mots, et la finalité à laquelle ils sont théoriquement assujettis.
La reformulation, qui renvoie à l’agrément des parties en présence quant à l’objet de leur discussion ou à la nature de leurs différences, condition d’une discussion réelle, paraît ainsi représenter la première étape du « lien » que nous tentons d’établir comme principe. Lien à la fois intellectuel, comme nous venons de le définir, mais aussi lien psychologique : instaurer un minimum d’empathie avec l’interlocuteur. En effet, reformuler posément, en sollicitant l’accord du partenaire sur le résumé de ses propos, exige de ne pas interpréter de manière réductionniste, empêche de caricaturer, et oblige surtout à bien distinguer la compréhension des arguments entendus et les diverses nuances, rectifications ou objections qui surgissent et que l’on s’apprête à avancer en réaction à ce qui a été entendu. Quant à celui qui entend sa parole reformulée, un tel exercice le contraint à entendre ce qui est entendu par son auditeur, expérience qui en soi n’est pas évidente, car entendre nos propres idées ou mots prononcés par une bouche autre que la nôtre peut représenter en soi une expérience assez douloureuse. Ne serait-ce que parce que cela nous force à repenser nos propos, de manière plus distante, avec toute la dimension critique que ce dédoublement infère. Bien souvent nous ressentirons une certaine irritation envers celui qui fait ainsi office de miroir, qui avive ainsi notre anxiété. D’autre part, notre auditeur n’est pas une machine à enregistrer : il traduit avec les mots qui lui sont propres, il résume comme il peut. Il nous faut alors savoir distinguer l’essentiel de l’accessoire, faire le deuil de « l’ampleur » de notre pensée et de tout ce que nous voudrions dire ou ajouter, pour être capable d’admettre que ces paroles étrangères correspondent bien aux nôtres. Un tel jugement est délicat, qui doit évaluer l’adéquation entre deux formulations : sans une certaine liberté de pensée accompagnée de rigueur, elle devient impossible. Si l’on joue le jeu, la reformulation permettra toutefois de mieux entrevoir ce que contiennent nos idées, d’en percevoir les faiblesses et les limites.
Le lien substantiel, nous le voyons déjà, est aussi l’unité d’un discours, unité transcendante, pas nécessairement exprimée, qui contient de manière condensée le contenu, abrégé ou intention de notre pensée, proposition réduite dont la forme et le fond souvent nous échappent. Une fois formulée, cette unité sous-jacente peut même nous surprendre ou nous insupporter. Elle est le principe unificateur ou générateur de nos exemples, cause antécédente du fameux « c’est comme quand… » si populaire chez les enfants, et les adultes. L’établissement explicite de ce lien requiert de réquisitionner des mots clefs, ou concepts, termes choisis qui rendent opératoire le discours en extrayant l’intimité du sens. Pour ce faire, il devient nécessaire de travailler l’art de la bréviloquence. Ainsi il pourra être demandé à un orateur de forger une proposition simple, phrase unique qui lui semble capturer l’essentiel de ce qu’il tente de signifier à travers une multiplicité de phrases dont l’enchevêtrement a souvent pour rôle premier d’obscurcir le sens plutôt que de le rendre manifeste. C’est cette phrase qui sera notée au tableau, pour servir de témoin exclusif d’une pensée donnée. Néanmoins ne soyons pas étonnés si un élève ne réussit pas à relever ce défi, et s’il lui faut solliciter l’aide de ses camarades accomplir sa tâche. Périodiquement, il sera nécessaire de transformer quelques aspects cruciaux de la parole initiale pour réussir ce pari : à partir du moment où notre discours s’explicite, nous nous voyons souvent obligés d’en modifier les termes.
Le lien substantiel est donc l’unité d’un discours, mais il est aussi l’unité de deux ou plusieurs discours. Bien entendu, dans la mesure où des paroles proviennent d’origines différentes, on peut s’attendre à ce qu’elles comportent une dimension contradictoire ou conflictuelle. Contrairement à une parole unique qui doit s’astreindre à un souci de cohérence, la multiplicité des auteurs n’oblige en rien à un quelconque consensus. Toutefois, l’exigence de la discussion implique tout de même une unité : celle de l’objet. Il s’agit donc en premier lieu d’identifier, en dépit de la variété des formes d’expression, des angles d’attaques du propos ou de la diversité des perspectives, quelque communauté de sens sans laquelle nous nous retrouvons engoncés dans l’absurdité, le solipsisme et le dialogue de sourds. En même temps que cette communauté d’objet, et grâce à elle, nous découvrirons les différences conceptuelles, accompagnées des visions du monde qui les sous-tendent, différences qui nous permettront d’estimer et prononcer les enjeux de la discussion. « Dialectique du même et de l’autre », propose Platon : en quoi l’objet de la discussion est-il même et autre ? La phrase simple, proposition unique qui nous semble toujours si nécessaire prendra naturellement la forme d’une problématique. Proposition qui pose un problème sous la forme d’une question, d’une contradiction ou d’un paradoxe. Nous retrouvons ici la même demande : l’art de la bréviloquence. Mais souvent, afin de placer en regard deux propositions, il nous faut découvrir une ou des antinomies dont les termes ne sont nullement exprimés, de manière consciente, dans les propositions initiales. De la même manière où nous devions creuser un discours unique pour en saisir le sens et l’intention, en produisant de nouveaux concepts et une proposition simple, un certain travail d’approfondissement doit être effectué pour capturer et montrer de manière visible ce qui oppose deux discours. De manière surprenante, nous découvrirons alors périodiquement que des propos qui se veulent contradictoires ne le sont guère, qui se paraphrasent allègrement, arguant exclusivement sur quelque point de sémantique ou autre subtilité peu substantielle, tandis que ceux qui prétendent « aller dans le même sens » entretiennent une illusion fusionnelle dépourvue de toute justification.
10- Penser la pensée
Dans la Critique de la raison pure, Kant distingue deux types de concepts : les concepts empiriques, tirés de l’expérience, et les concepts purs, produits dérivés de la raison. Ainsi le concept « homme » provient pour bonne partie de l’expérience, mais celui de « contradiction » est engendré par la raison. Car si je peux percevoir par les organes des sens des hommes concrets, je ne peux pas percevoir de contradictions par ces mêmes organes, ce dernier concept renvoyant uniquement à un problème d’intelligible et non de sensible, donc à un travail d’analyse et de synthèse. Or il nous semble que le travail philosophique doit tendre à la production de concepts, certes empiriques, mais aussi purs concepts de raison. Processus d’abstraction que nous avons déjà traité. Mais nous souhaitons revenir sur la production de ces concepts purs à travers lesquelsse forge une pensée consciente d’elle-même et de son fonctionnement. Une pensée qui peut et doit périodiquement s’abstraire d’elle-même pour s’engager dans un processus de métaréflexion.
L’aspect le plus évident de ce processus existe très tôt sur le plan intuitif, en ce que nous nommerons intuition logique. Car si l’enfance se caractérise par une vision magique du monde, un monde où tout peut arriver sans que cela ne surprenne, petit à petit l’esprit s’initie à « l’ordre des choses ». Par un processus associatif, prélude au cheminement de la raison, des objets, des êtres et des phénomènes sont reliés ensemble. Divers liens sont établis, qui lentement deviendront la structuration de l’espace, du temps, de la causalité, de la logique, du langage, de l’existence, avec toutes les lourdeurs et les rigidités que cette vision figée du monde implique, certes, mais qui s’avèrent aussi la condition nécessaire à l’avènement de la raison. Raisonner consiste à connaître ou reconnaître la réalité des choses, à la comprendre et donc à prévoir, car si rien n’est prévisible, si rien n’est reconnaissable, notre raison devient caduque. Ce qui explique notre étonnement, lorsque qu’un événement dépasse les frontières de notre raison et de ses attendus. La transformation dont nous parlons est celle d’un esprit pour lequel tout est possible, qui peu à peu distingue le possible et l’impossible, ainsi que le compossible : ce qui est possible par rapport à une condition donnée, fondement même de la pensée logique : « si ceci, alors cela », ou bien « si d’une part ceci et d’autre part ceci, alors cela » base du très classique syllogisme.
L’exercice philosophique, par le biais de la discussion ou autre, consiste donc à inviter la raison à effectuer un double travail sur elle-même. D’une part, aller « au bout » de ses interrogations, de ses problèmes, de ses analyses. D’autre part, se voir fonctionner, repérer les mécanismes, à la fois ceux qui opèrent et produisent de la pensée, et ceux qui freinent, dévient ou interrompent le processus de réflexion. Ces deux aspects du travail se nourrissant mutuellement, puisque la perception des limites permet de saisir la nature précise d’un processus, et l’identification d’un processus permet de retravailler ou dépasser les limites. Ainsi le travail de métaréflexion permet à la pensée de progresser. Or c’est précisément le problème qui est soulevé par les enseignants qui nous disent « Je ne sais pas quoi répondre aux questions des élèves » ou bien « Ça tourne en rond, je ne vois pas comment faire avancer la discussion » : comment faire progresser la pensée. La solution n’est ni de fournir des réponses toutes faites sur lesquelles les élèves se précipiteront, ni de simplement proposer une piste qui « sortira d’affaire » le groupe, mais d’inviter les uns et les autres à observer leur propre fonctionnement, leurs idées, leurs contradictions, leurs glissements de sens, etc., tout simplement par quelques petites règles méthodologiques qui spécifient le rôle et la finalité de chaque moment de réflexion.
Le premier aspect de ce processus consiste à être conscient de la nature de nos propos, comme de nos actes, et pour cela savoir catégoriser ces propos, savoir nommer la forme ou la finalité de notre parole. Sommes-nous en train de poser une question, de proposer une nouvelle idée, de répondre à une objection ou d’en fournir une, de démontrer ou de prouver une idée, d’argumenter ou de problématiser, de donner un exemple ou de conceptualiser une illustration, de rapporter des faits ou de les interpréter ? Il s’agit ici d’émerger du « Je veux dire quelque chose… Ça me fait penser à… Je voudrais ajouter… ». Autant de souhaits exprimés de « commenter », « nuancer », « compléter », « rebondir », ou « préciser » qui, vérification faite, ne signifient pas grand-chose, sont très vagues ou restent très éloignés de ce qu’ils disent. Ce type d’analyse renvoie en premier à l’intention de la prise de parole, car pour son auteur, elle est souvent vécue et perçue exclusivement comme une « pulsion de parole », quelque chose qui nous vient à l’esprit et demande à sortir, le plus vite possible, opinions d’origine principalement associative, dont nous ignorons la nature et le rôle. Ignorance qui explique un certain nombre de difficultés d’articulation, de balbutiements, de ratures et de contradictions. Prendre conscience de ce que l’on veut dire, signifie aussi travailler et lisser cette parole en fonction d’une finalité ordonnatrice permettant de mieux structurer la pensée. Bien que lors des premières tentatives, le fait de catégoriser ou définir semble rendre notre parole plus confuse encore. Faire et se voir faire, comme action simultanée, peut être pensé et subi initialement comme un facteur dédoublant, alourdissant la tâche, mais plus ou moins rapidement, au fur et à mesure que se développe la capacité d’être à la fois « dedans » et « dehors », ce processus facilite le travail de la pensée et de l’expression en clarifiant la compréhension.
Dire les mots, c’est penser, nous dit Hegel, affirmant qu’il serait illusoire de croire penser sans forger par des concepts cette pensée. L’intention, le ressenti, l’impression, l’intuition, autant de formes inadéquates, insuffisantes et trompeuses de la pensée, une pensée non consciente d’elle-même. Certes ce présupposé, comme tout présupposé, connaît ses limites, mais il connaît aussi son utilité. Savoir ce que l’on dit, c’est dire ce que l’on dit, c’est annoncer son intention, c’est définir la forme, c’est articuler la relation à ce qui a déjà été dit. Toutefois, comme pour l’ensemble de l’exercice, il ne s’agit pas ici de faire un travail de vocabulaire, sur les termes « hypothèse », « objection », « abstrait », « essentiel » ou autres, bien que cela ne soit guère exclu, en un autre temps. Non pas savoir, mais savoir-faire ; non pas connaître, mais utiliser. Notre affaire est surtout que l’élève s’entraîne à penser sa pensée, c’est-à-dire à tenter de spécifier la nature de son discours. En un sens, peu importent les mots qu’il utilise, ceux qui seront les siens en un premier temps, approximatifs et inhabituels, ou ceux qu’il acquerra au cours de la pratique, plus précis ou plus conventionnels. L’important est surtout de desceller l’immédiateté qui le lie à sa parole, de creuser un interstice, d’installer une respiration, pour passer de l’implicite à l’explicite, afin que le sujet se détache de lui-même et que la pensée devienne un objet pour elle-même. Nos opinions sont des vérités, nous indique Pascal, à condition d’entendre ce qu’elles disent, et la vérité de nos opinions n’est pas toujours là où nous le pensons. Tentons alors de nous en rapprocher.
Le concept de pratique est en général étranger au philosophe d’aujourd’hui, presque exclusivement un théoricien. Le mot même le dérange. En tant que professeur, son enseignement porte principalement sur un certain nombre de textes écrits, dont il doit transmettre la connaissance et la compréhension à ses élèves. Son principal centre d’intérêt sera l’histoire des idées, et son activité favorite l’art de l’interprétation. Une faible minorité d’enseignants ou de spécialistes s’engagera dans la spéculation philosophique écrite. Dans ce contexte, de manière récente, quelque peu en rupture avec la tradition, de nouvelles pratiques émergent, ouvertes au grand public, qui s’intitulent pratiques philosophiques, consultations philosophiques, philosophie pour enfants ou autres, pratiques qui se voient contestées vigoureusement ou ignorées par l’institution philosophique. Cette situation pose les deux questions suivantes, que nous traiterons dans cet ordre. La philosophie est-elle seulement un discours ou peut-elle avoir une pratique ? Qu’est-ce qui constitue une démarche philosophique ?
Bien entendu, nous admettrons ici la partialité de notre engagement philosophique en distinguant au sein de l’activité philosophique quatre différentes modalités, souvent considérées de manière indistincte. Ainsi nous distinguerons l’attitude philosophique, le champ philosophique, les compétences philosophiques et la culture philosophique. Bien que ces différents aspects ne puissent être radicalement séparés, disons simplement pour l’instant que la culture, ou connaissance de la parole d’autorité, tend de manière générale dans l’approche occidentale moderne à prendre le pas sur les autres fonctions philosophiques, tandis que nous privilégierons à la fois l’attitude philosophique et les compétences philosophiques, sur lesquelles nous tenterons brièvement de donner un aperçu. Nous terminerons notre propos par quelques éléments sur l’idée d’atelier philosophique.
I – La matérialité comme altérité
Une pratique peut être définie comme une activité qui confronte une théorie donnée à une matérialité, c’est-à-dire à une altérité. La matière étant ce qui offre une résistance à nos volontés et à nos actions. Premièrement, la matérialité la plus évidente du philosopher est la totalité du monde, incluant l’existence humaine, à travers les multiples représentations que nous en avons. Un monde que nous connaissons sous la forme du mythe (mythos), narration des événements quotidiens, ou sous la forme d’informations culturelles, scientifiques et techniques éparses, de nature factuelle ou explicative (logos). Deuxièmement, la matérialité est pour chacun d’entre nous “l’autre”, notre semblable, avec qui nous pouvons entrer en dialogue et en confrontation. Troisièmement, la matérialité est la cohérence, l’unité présupposée de notre discours, dont les failles et l’incomplétude nous obligent à nous confronter à des ordres plus élevés et plus complets d’architecture mentale. Avec ces principes en tête, inspirés par Platon, il devient possible de concevoir une pratique qui consiste en des exercices mettant à l’œuvre la pensée individuelle, dans des situations de groupe ou singulières, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Le fonctionnement de base, à travers le dialogue, consiste d’abord à identifier les présupposés à partir desquels fonctionne notre propre pensée, ensuite à en effectuer une analyse critique, puis à formuler des concepts afin d’exprimer l’idée globale ainsi enrichie. Dans ce processus, chacun cherche à devenir conscient de sa propre appréhension du monde et de lui-même, à délibérer sur les possibilités d’autres schémas de pensée, et à s’engager sur un chemin anagogique où il dépassera sa propre opinion, transgression qui est au cœur du philosopher. Dans cette pratique, la connaissance des auteurs classiques est très utile, mais ne constitue pas un pré-requis absolu. Quels que soient les outils utilisés, le défi principal reste l’activité constitutive de l’esprit singulier.
a – L’altérité comme mythos et logos
Comment vérifier des idées données sur tous les petits mythos de la vie quotidienne, sur les morceaux plus ou moins éclatés de logos qui constituent notre pensée ? Le problème avec la philosophie, comparée à d’autres types de spéculation, est que le sujet pensant ne mesure pas réellement sa propre efficience sur une véritable altérité, mais sur lui-même. Bien que l’on puisse objecter que le physicien, le chimiste, ou encore plus le mathématicien, sont enclins à camoufler leur subjectivité, déguisée en constatation objective. Mais admettons que ce problème s’aggrave dans la pratique philosophique, puisque l’idée particulière qu’il doit mettre à l’épreuve en la confrontant à ses mythos et logos personnels, est elle-même engendrée par ces mythos et logos personnels, ou intimement entrelacée à eux. De plus, comme pour la science “dure” qui parfois change la réalité, soit en agissant sur elle à travers des hypothèses innovantes et efficaces, soit en transformant simplement la perception, la “nouvelle” idée particulière du philosophe peut altérer le mythos ou le logos qui occupent son esprit. Le problème posé par ces deux processus, est qu’il existe une tendance naturelle de l’esprit humain à se déformer afin de réconcilier une idée spécifique avec le contexte général dans laquelle elle intervient, soit en minimisant cette idée spécifique, soit en minimisant l’ensemble du mythos et du logos établis, soit encore en créant une barrière entre eux pour éviter le conflit. Cette dernière option est la plus commune, car elle permet d’éviter, en apparence, le travail de la confrontation ; phénomène qui explique le côté “marqueterie mal jointe” de l’esprit humain, selon l’expression de Montaigne. Heureusement, ou malheureusement, la douleur provoquée par l’absence de cohérence ou d’harmonie de l’esprit (similaire à la douleur provoquée par la maladie qui exprime les dissonances du corps) nous oblige à travailler cette dissension, ou à porter une armure pour nous protéger, pour oublier le problème afin de minimiser ou occulter le désagrément. Cet oubli a toute l’efficacité d’un analgésique, mais aussi les inconvénients d’une drogue. La maladie est encore là, se renforçant puisque nous ne la traitons pas.
b – L’altérité comme “l’autre”
Passons au second type d’altérité : “l’autre” sous la forme d’un autre esprit singulier. Ce dernier a un premier avantage sur nous : il est le spectateur, plutôt que l’acteur que nous sommes ; les ruptures et divergences de notre propre système de pensée ne lui causent pas a priori de douleur. Contrairement à nous, il ne souffre pas de nos incohérences, en tout cas pas de manière directe, sauf à travers une sorte d’empathie. Pour cette raison, il est mieux placé que nous pour identifier les conflits et contradictions qui nous minent. Bien qu’il ne soit pas un pur esprit : ses réponses et analyses seront affectées par ses propres bogues et virus, par ses propres insuffisances. En dépit de cela, étant moins impliqué que nous dans notre affaire, il pourra poser un œil plus distant sur notre processus de pensée, avantage certain pour nous examiner de manière critique et non défensive, bien que l’on doive se garder d’attribuer une quelconque toute-puissance à cette situation ; toute perspective particulière souffrant nécessairement de faiblesses et d’aveuglements. Ce peut être par manque de compréhension de la pensée de l’autre, ou bien par crainte de l’autre, ou encore à cause de la complaisance induite par le manque d’intérêt pour l’autre, et même l’empathie s’avère ici dangereuse, qui menace d’engluer deux êtres l’un dans l’autre.
c – L’altérité comme unité
La troisième forme d’altérité est l’unité du discours, l’unité du raisonnement. Nous postulons ici la présence d’un “anhypothétique”, selon Platon, l’affirmation d’une hypothèse aussi incontournable qu’inexprimable, unité transcendante et intérieure dont nous ignorons totalement la nature propre, bien que sa présence s’impose à travers ses effets sur nos sens et notre compréhension. L’unité ne nous apparaît pas en tant que telle, comme une entité évidente, mais à travers une simple intuition, désireuse de cohérence et de logique. Point de fuite niché au sein d’une multiplicité d’apparences, qui cependant guide notre pensée et reste une source permanente d’expériences cruciales, pour notre esprit et celui des autres, sauvant nos esprits de l’abîme obscur et chaotique, de la multiplicité indéfinie et du tohu-bohu, pénible chaos qui trop souvent caractérise les processus de pensée, les nôtres et ceux de nos semblables. Les opinions, les associations de pensées, les simples impressions et sentiments, chacun d’entre eux régnant sur son petit monde immédiat, rapidement oubliés lorsqu’ils traversent les frontières étroites d’espace et de temps qui les attachent à un territoire microscopique. Pauvres et pathétiques éphémères, qui aussi réels soient-ils, tentent de se maintenir, faibles et impuissants, dans le brouhaha de processus mentaux déconnectés, essayant en vain d’être entendus, tandis que l’écho reste silencieux et désespérément muet. À moins de résonner sur fond de cette mystérieuse, généreuse et substantielle unité, toute idée particulière sera condamnée à une fin prématurée et soudaine, révélant à toute conscience le vide de son existence. Le seul problème, ici, est précisément que cette conscience est tragiquement absente, car sa présence, liée à l’unité en question, aurait déjà radicalement transformé la mise en scène. L’unité de notre discours est donc ce mur intérieur, à la fois rempart, appui et butée, dont nous ignorons toujours la nature essentielle. Elle est l’autre en nous, l’autre qui, d’une certaine manière, est en nous plus nous que nous-même.
II – Qu’est-ce que philosopher ?
En résumé, l’activité pratique philosophique implique de confronter la théorie à l’altérité, une vision à une autre. Elle implique la pensée sous le mode du dédoublement, sous le mode du dialogue, avec soi, avec l’autre, avec le monde, avec la vérité. Nous avons défini ici trois modes à cette confrontation : les représentations que nous avons du monde, sous forme narrative ou conceptuelle, “l’autre” comme celui avec qui je peux m’engager dans le dialogue, l’unité de pensée, comme logique, dialectique ou cohérence du discours. Dès lors, qu’est-ce que la philosophie, lorsque cruellement et arbitrairement nous lui enlevons son costume pompeux, frivole ou décoratif ? Que reste-t-il une fois que nous l’avons déshabillée de son soi souvent autoritaire, hypertrophié et de son trop de sérieux ? Autrement dit, au-delà du contenu culturel et spécifique qui en est l’apparence, généreuse et parfois trompeuse – si tant est que nous pouvons faire l’économie de cette apparence – que reste-t-il à la philosophie ?
En guise de réponse, nous proposerons la formulation suivante, définie de manière assez lapidaire, qui pourra paraître comme une paraphrase triste et appauvrie de Hegel, dans le but de se concentrer uniquement sur l’opérativité de la philosophie en tant que productrice de concepts, plutôt que sur sa complexité. Nous définirons l’activité philosophique comme une activité constitutive du soi déterminée par trois opérations : l’identification, la critique et la conceptualisation. Si nous acceptons ces trois termes, au moins temporairement, le temps d’en éprouver la solidité, voyons ce que ce processus philosophique signifie, et comment il implique et nécessite l’altérité, pour se constituer en pratique.
a – Identifier
Comment le moi que je suis peut-il devenir conscient de lui-même, à moins de se voir confronté à l’autre ? Moi et l’autre, mien et tien, se définissent mutuellement. Je dois connaître la poire pour connaître la pomme, cette poire qui se définit comme une non-pomme, cette poire qui définit donc la pomme. De là l’utilité de nommer, afin de distinguer. Nom propre qui singularise, nom commun qui universalise. Pour identifier, il faut postuler et connaître la différence, postuler et distinguer la communauté. Dialectique du même et de l’autre : tout est même et autre qu’autre chose. Rien ne se pense ni n’existe sans un rapport à l’autre.
b – Critiquer
Tout objet de pensée, nécessairement engoncé dans des choix et des partis pris, est de droit assujetti à une activité de critique. Sous la forme du soupçon, de la négation, de l’interrogation ou de la comparaison, diverses formes d’une problématique. Mais pour soumettre mon idée à une telle activité, je dois devenir autre que moi-même. Cette aliénation ou contorsion du sujet pensant en montre la difficulté initiale, qui en un second temps peut d’ailleurs devenir une nouvelle nature. Pour identifier, je pense l’autre, pour critiquer, je pense à travers l’autre, je pense comme l’autre ; que cet autre soit le voisin, le monde ou l’unité. Ce n’est plus l’objet qui change, mais le sujet. Le dédoublement est plus radical, il devient réflexif. Ce qui n’implique pas de “ tomber ” dans l’autre. Il est nécessaire de maintenir la tension de cette dualité, par exemple à travers la formulation d’une problématique. Et tout en tentant de penser l’impensable, je dois garder à l’esprit mon incapacité fondamentale de m’échapper véritablement de moi-même.
c – Conceptualiser
Si identifier signifie penser l’autre à partir de moi, si critiquer signifie me penser à partir de l’autre, conceptualiser signifie penser dans la simultanéité de moi et de l’autre. Néanmoins, cette perspective éminemment dialectique doit se méfier d’elle-même, car aussi toute-puissante se veuille-t-elle, elle est également et nécessairement cantonnée à des prémisses spécifiques et des définitions particulières. Tout concept entend des présupposés, une construction particulière, un contexte. Un concept doit donc contenir en lui-même l’énonciation d’une problématique au moins, problématique dont il devient à la fois l’outil et la manifestation. Il traite un problème donné sous un angle nouveau. En ce sens, il est ce qui permet d’interroger, de critiquer et de distinguer, ce qui permet d’éclairer et de construire la pensée. Et si le concept apparaît ici comme l’étape finale du processus de problématisation, affirmons tout de même qu’il inaugure le discours plutôt qu’il ne le termine. Ainsi le concept de “ conscience ” répond à la question “ Un savoir peut-il se savoir lui-même ? ” , et à partir de ce “ nommer ”, il devient la possibilité de l’émergence d’un nouveau discours.
III – L’atelier de philosophie
Deux notions sont indissociables du concept d’atelier : l’exercice ou pratique, et la production. Un troisième, qui sans être obligatoire, a aussi son importance : le collectif. En cela l’atelier philosophique se distingue de deux autres types d’activités philosophiques. D’une part le cours ou la conférence, dans lequel un maître dispense son savoir à des auditeurs ou à des élèves, et la discussion, sur le modèle du débat citoyen ou du café-philo, où les interventions se succèdent tous azimuts au gré des participants et des animateurs. Comme pour toute tentative de schématisation, de telles catégories ne servent que de points de repère, car selon les lieux et les individus, les appellations et les fonctionnements varieront selon toute une gamme de nuances procédant de la continuité plutôt que du discret. Il est en effet des cours ou des cafés-philo qui ressemblent à des ateliers, et vice-versa. Il est aussi des animateurs qui ressemblent à des professeurs et des professeurs qui ressemblent à des animateurs. Risquons-nous toutefois à élaborer quelque peu cette spécificité théorique de l’atelier.
Comme dans un atelier de peinture, dans l’atelier philosophique tout participant se doit de travailler, ou tout au moins est fortement encouragé à s’engager. Le principe d’observateur ou d’auditeur n’est guère de mise. En cela il se distingue du cours et de la discussion, où pour des raisons différentes nul n’est tenu à une participation active. Par exemple, si le nombre s’y prête, un tour de table se tiendra sur un problème donné. Ou bien tout participant pourra en interpeller un autre ou le questionner sans que ce dernier ne se rebiffe, quitte à avouer son incapacité ou sa difficulté à répondre, ce qui fait partie intégrante – voire importante – de l’exercice. C’est en ce sens que cette activité se définit comme une pratique ou un exercice. Chacun vient sur le terrain pour jouer ou accomplir sa part de l’ouvrage, non pour regarder les autres. Bien entendu, l’animateur, responsable de cet engagement effectif, devra en cela agir de manière suffisamment subtile pour ne pas effrayer ceux qui éprouvent encore une certaine réticence à approcher le ballon.
Comme dans l’atelier de peinture, il s’agit de produire. Produire, dans le sens où l’on se confronte à une matérialité, dans le but d’un résultat. Mais la matérialité de l’activité philosophique n’est pas la couleur et sa texture. Elle est la pensée individuelle, à travers sa représentation orale ou écrite. Chacun se confronte d’abord à ses propres représentations du monde, ensuite à celle de l’autre, et enfin à l’idée d’unité ou de cohérence. De cette confrontation jaillissent de nouvelles représentations, sous forme conceptuelle ou analogique. Ces représentations émergeantes se doivent d’être articulées, soulignées, comprises par tous, travaillées et retravaillées. En cela, à nouveau, l’atelier se distingue du cours et de la discussion. Car dans le cours, les concepts sont préparés à l’avance : ils sont souvent codifiés, estampillés en référence à des auteurs et à l’histoire de la philosophie. Et dans la discussion, le mouvement de la pensée glisse, n’insiste pas, ne cherche pas en permanence à revenir sur lui-même, à moins que cela se produise arbitrairement. Sur cette dernière distinction repose sans doute le rôle plus appuyé, voire plus contraignant de l’animateur dans le cadre d’un atelier. Ainsi l’atelier s’insère plus naturellement dans l’activité de classe – entre autres le cours de philosophie – que la simple discussion, plus libre et informelle, aux enjeux didactiques moins explicites. Nous l’aurons compris : l’atelier philosophique tend à avoir des règles de fonctionnement plus spécifiques et formalisées que celles de la discussion. Ces règles doivent être explicitées, puisqu’elles concernent le fonctionnement d’un groupe, et non pas celui d’un individu seul, comme lors d’une conférence. Les règles du jeu peuvent être innombrables, et sont de fait très variées. Il n’existe donc pas d’exemple type, d’autant plus que dans le domaine de la philosophie, très théorique malgré tout, chacun trouve toujours à redire sur le travail du voisin. Mais à titre d’exemple, décrivons brièvement quelques mises en scène utilisées comme modus operandi d’un atelier philosophique.
a – Questionnement mutuel.
Une question d’ordre général est posée. Une première hypothèse de réponse, relativement courte, est offerte par un participant. Puis, avant de passer à une autre, ses collègues sont invités à le questionner, afin d’éclaircir les points obscurs et résoudre les contradictions. Mais les interventions sont surveillées par l’ensemble du groupe, qui doit déterminer si les questions sont véritablement des questions, ou des affirmations plus ou moins déguisées ; toute question déclarée “fausse” à la majorité du groupe sera refusée. Car tout nouveau concept doit émaner du porteur d’hypothèse et non pas des questionneurs. Chaque participant est ainsi obligé d’entrer dans le schéma du voisin, en laissant de côté, temporairement, ses propres opinions. Principe qui permet de développer en commun l’hypothèse initiale, dont l’initiateur est le garant. C’est lui qui, pressé par les questions reçues, développera son hypothèse, la reformulera, ou même l’abandonnera si au fur et à mesure de la discussion si elle vient à lui paraître intenable. Puis une nouvelle hypothèse est proposée par un autre participant, et le processus recommence. Le résultat final est de problématiser la question initiale, en comparant ces diverses lectures, en mettant au jour leurs enjeux et leurs concepts forts, réalisant ainsi ce que l’on pourrait nommer une dissertation collective.
b – Exercice de la narration.
Une question d’ordre général est posée. Mais au lieu de la traiter par des considérations abstraites, les participants sont invités à présenter une narration courte, fictive ou réelle, inventée ou tirée d’une œuvre quelconque, qui pourrait servir de cas d’école afin d’étudier la question posée. Plusieurs histoires – cas d’école – sont proposées, qui sont comparées par les participants, en argumentant leur intérêt respectif pour traiter le sujet. Puis un vote du groupe choisit une seule de ces histoires, qui sera analysée plus en profondeur. Le narrateur est alors questionné par ses collègues. D’abord sur les données factuelles de la narration, afin de travailler l’objectivité du contenu. Puis sur l’analyse conceptuelle qu’il en donne, dont l’énoncé devrait permettre de traiter la question initiale. Les autres participants peuvent ensuite soumettre une nouvelle lecture de cette narration, en précisant les enjeux philosophiques comparatifs de leur propre lecture. Le produit final de cet exercice est à nouveau une problématisation de la question initiale, grâce à un certain nombre de concepts et d’idées qui ont émergé au fil de la discussion.
c – Travail sur texte.
Un texte est distribué aux participants, court extrait d’une œuvre philosophique, littéraire ou autre. Une lecture à haute voix est effectuée par un volontaire. Tous sont ensuite invités à exposer une analyse du texte, qui devra se conclure par une phrase courte censée capturer l’intention principale de l’auteur. La première interprétation sera discutée par l’ensemble des participants avant de passer à une autre. Des questions seront posées, portant à la fois sur le sens de cette interprétation et sur son accord avec le texte. Des citations précises pourront être exigées afin d’en légitimer l’articulation. De nouvelles interprétations seront développées, qui subiront un semblable traitement. En un second temps, des critiques du texte pourront aussi être formulées. Les enjeux philosophiques de ces différentes lectures devront alors être précisés, afin d’analyser les présupposés de chacune d’entre elles, permettant de mieux saisir les différences conceptuelles, souvent importantes. Le produit final est la problématisation d’un texte initial, au moyen des différentes interprétations offertes et travaillées. Précisons qu’un travail semblable peut être réalisé autour d’un texte écrit par un des participants.
Tous philosophes ?
Identifier ce qui est nôtre. Se rendre capable d’une analyse critique de cette identité. Dégager de nouveaux concepts afin de prendre en charge la tension contradictoire qui émerge de la critique. De manière assez abrupte, qu’il reste à développer en d’autres lieux, disons que ces trois outils nous permettront de confronter l’altérité qui constitue la matière philosophique, matière sans laquelle il ne serait pas possible de parler de pratique philosophique. Une pratique qui consiste à s’engager dans un dialogue avec tout ce qui est, avec tout ce qui apparaît. À partir de cette matrice, il n’est de catégorie d’êtres humains qui ne puisse tenter à différents degrés de philosopher, de s’engager dans une pratique philosophique.
http://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2017/10/LOGO12-300x90.png00ced95vinhttp://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2017/10/LOGO12-300x90.pngced95vin2017-11-17 11:26:222018-03-26 21:45:25Principes de la pratique philosophique
« La vérité est bien dans leurs opinions, mais non pas au point où ils se figurent.«
Pascal, Pensées.
Il est un obstacle récurrent qui empêche de comprendre la nature et les enjeux de l’exercice philosophique, lorsqu’il prend la forme d’une discussion. Celui qui consiste à penser que philosopher revient à s’exprimer, à communiquer, ou à défendre une thèse. S’il est possible de mener un échange philosophique sous bien des formes, y compris celles que nous venons de mentionner, nous souhaitons ici travailler l’idée d’un discours philosophique comme un discours qui se saisit lui-même, qui se voit lui-même, qui s’élabore de manière consciente et déterminée. Nous partons du principe que philosopher ne consiste pas uniquement à penser, mais somme de penser la pensée, de penser sa pensée. C’est donc convoquer des idées, tout en étant conscient, ou en tentant de prendre conscience, de la nature, des implications et des conséquences des idées que nous exprimons. Les nôtres, et celles de nos interlocuteurs, bien entendu. Le principe auquel nous faisons appel ici ne prétend pas diminuer le rôle de l’intuition, de la parole spontanée, voire même de la compréhension approximative qui préside à bien des discussions, mais nous souhaitons simplement arrêter un instant le regard du lecteur sur les limites visibles de certains types d’échanges, qui par complaisance ou par ignorance restent en deçà d’eux-mêmes. De manière générale, disons que le problème est celui de ce que l’on peut nommer la pensée associative. Elle fonctionne sur le schéma général du « ça me fait penser à quelque chose », sur le modèle du « je voudrais rebondir » si populaire dans les débats télévisés, ou encore sur celui du « je voudrais compléter », ou du « je voudrais apporter une nuance ». Autant d’expressions qui au fond ne signifient pas grand-chose, disent souvent ce qu’elles ne disent pas ou veulent dire quelque chose qu’elles n’évoquent nullement.
En classe, cette tendance se manifeste par une nette tendance de l’enseignant à faire primer l’expression d’idées, aussi vagues soient-elles, sur toute autre considération : l’élève s’est exprimé, c’est bien ! Ce souci est poussé à un tel point que ledit enseignant est prêt à finir les phrases de l’élève, à lui mettre des mots dans la bouche sous prétexte de reformuler, uniquement pour pouvoir dire : il a dit quelque chose, il a parlé. Or si un tel souci ou un tel comportement peut se comprendre dans certains types d’exercices de langage, il peut poser problème pour le travail philosophique. Pour étayer notre hypothèse, nous décrirons quelques compétences particulières, liées à la discussion, qui nous semblent essentielles au travail philosophique. Certains nous objecteront d’emblée que l’exigence de « parler au bon moment » n’est qu’une préoccupation superficielle, dénuée de substance réelle. Ceci pour deux raisons possibles. Soit parce que cette règle est conçue comme un simple acte de politesse : par exemple ne pas couper la parole à un interlocuteur. Soit parce qu’elle est animée par un simple but pratique : parler en même temps que quelqu’un d’autre empêche d’entendre et de comprendre. Mais de telles perspectives oublient l’intérêt premier du philosopher : le rapport à sa propre parole. Déjà, le simple fait de pouvoir solliciter ou mobiliser de manière délibérée sa pensée et sa parole, non pas par quelque enchaînement fortuit et incontrôlé, mais par un acte voulu, conscient de lui-même, modifie en profondeur le rapport entre soi-même et sa pensée. Ensuite, si l’idée en question ne devient pas l’objet d’un dialogue avec soi-même, il est à craindre que cette idée, tout comme elle surgira inopinément, ne sera pas vraiment comprise, ni même entendue par son auteur. Pour vérifier cela, il n’est qu’à demander à un enfant ou à un adulte dont la parole a jailli trop spontanément, de répéter ce qu’il vient de dire, pour apercevoir le problème : bien souvent il ne saura pas le faire. Il est une raison importante à cet oubli : l’aspect gauche et maladroit du comportement renvoie à une dévalorisation de soi. « Mes propres idées n’ont aucune espèce importance, pourquoi les exprimerai-je ? Pourquoi en soignerai-je la forme et l’apparence ? Pourquoi parlerai-je pour être entendu ? D’ailleurs, comment puis-je choisir le moment approprié pour les prononcer ? C’est malgré moi que ma parole sort, voire en dépit de moi : elle ne m’appartient pas ». Ainsi, lorsqu’on demande à cet individu de parler au « bon moment », c’est un effort important qu’on exige de lui, mais un effort on ne peut plus nécessaire. Il implique un travail en profondeur de soi sur soi, qui, s’il n’est pas toujours facile, est absolument vital. Le problème est identique quand on impose de lever la main pour parler, quand bien même cela paraît ardu, en particulier avec les jeunes enfants. Pourquoi d’ailleurs ne pas faire de cette exigence un exercice en soi ? Si ce n’est qu’il est un peu frustrant pour l’enseignant, qui avant tout veut montrer aux autres et à lui-même que « ses » enfants ont des idées. Pourtant, peut-être répètent-ils simplement ce qu’ils ont entendu à la maison ou à l’école, mais cela fait tellement plaisir à entendre… Tandis que le fait de prononcer une parole au bon moment, montre au contraire que l’enfant sait faire ce qu’il a à faire, et qu’un débat intérieur non accidentel s’est engagé. Et à quelques nuances près, il en va de même pour l’adulte. Se distancier de soi, en découplant sa parole et son être, comme acte constitutif de l’être.
Comme nous l’avons évoqué, il est si tentant de finir les phrases de son interlocuteur, enfant ou adulte ! Mais si nous y réfléchissons bien, qu’est-ce qui nous anime, sinon une sorte d’impatience déguisée sous les oripeaux d’une empathie superficielle et complaisante. Si l’enfant tombe, faut-il nécessairement se précipiter sur lui pour le relever, ou bien lui laisser la chance de se ressaisir, s’il pleure, et lui donner l’occasion d’apprendre à se relever tout seul ? D’autant plus que les mots ou bouts de phrases qui nous sont obligeamment fournis par l’enseignant ou par le voisin, sont peut-être très éloignés ou très en deçà de ce que nous étions sur le point d’articuler. Mais tout comme celui qui se noie se précipite sur l’objet qu’on lui lance, sans même réfléchir, alors que l’objet lancé ne lui est peut-être d’aucune utilité, celui qui cherche ses mots s’empare souvent instinctivement de ce qui lui est dit sans même en analyser le contenu, sans prendre le temps et la peine d’en vérifier l’efficacité ou la justesse. Immanquablement, en prétendant aider l’autre, nous cherchons surtout à nous faire plaisir, nous cédons sans vergogne à nos impulsions. Alors que celui qui peine à terminer son œuvre effectue pourtant un travail important sur lui-même et sa pensée. Ce qui ne signifie pas qu’il doive peiner sans aucune assistance, mais la première assistance qui lui est due est celle qui consiste à lui laisser du temps, à lui permettre de se retrouver lui-même sans subir la pression du groupe ou de l’autorité en place qui le bouscule sous prétexte de le secourir. Quitte à installer des procédures qui lui permettront de sortir de l’impasse, si impasse il y a. Par exemple, en apprenant à dire : « Je n’y arrive pas », « Je suis coincé », ou bien en demandant « Est-ce que quelqu’un d’autre peut m’aider ? ». Car dès cet instant, le problème est articulé, il est signalé, et en ce sens le sujet reste libre et autonome, puisqu’il est conscient du problème et réussit à l’articuler avec des mots. Leibniz avance la téméraire hypothèse que ce n’est pas dans la chose en soi, mais dans le lien que se trouve la substance vive. Profitant de cette intuition, nous avancerons le principe que ce qui distingue la pensée philosophique par rapport à la pensée en général, est précisément le lien, c’est-à-dire le rapport articulé entre les idées. Une idée n’est en soi jamais qu’une idée, un mot n’est jamais qu’un mot, mais dans l’articulation grammaticale, syntaxique et logique, le mot accède au statut de concept, puisqu’il devient opératoire, et l’idée participe à l’élaboration de la pensée, puisqu’en s’associant à d’autres elle permet d’échafauder et construire.
Pour ce faire, ce n’est pas tant des idées que nous cherchons, aussi futées et brillantes soient-elles, car la discussion ressemblerait ainsi à une vague liste d’épicerie, à un vulgaire débat d’opinions, produisant une pensée globale inchoative et désordonnée. Ce sont des liens, des rapports, qui impliquent la maîtrise de ces connecteurs généralement si mal compris et utilisés, à commencer par le « mais » qui procède du « oui, mais… », et une compréhension accrue des relations et corrélations entre les propositions. Combien de dialogues échangent des propos conflictuels sans en relever le moindrement la nature contradictoire, sans en évaluer le potentiel problématique ! Combien de propos affirment un désaccord sans préciser ou percevoir le caractère spécifique de ce désaccord, tandis que les propositions en question ne portent pas sur le même objet, ou affirment la même idée en changeant simplement les mots !
Aussi, plutôt que de se précipiter sur d’autres idées, ou plutôt d’autres intuitions, avant d’empiler plus de mots, pourquoi ne pas prendre le temps de déterminer et d’évaluer le rapport entre les concepts et les idées, afin de prendre conscience de la nature et de la portée de nos propos. Mais là encore, l’impatience règne : ce travail est laborieux, il est apparemment moins glorieux et plus frustrant, et pourtant, n’est-il pas plus conséquent ?
Aussi, exercice très simple, demandons à celui qui va parler d’annoncer en premier lieu le but de sa parole, d’articuler le lien entre son intention et ce qui a déjà été dit, de qualifier son discours. S’il n’y arrive pas, qu’il le reconnaisse, et qu’il tente de réaliser ce travail une fois que sa parole a été prononcée. S’il n’y arrive toujours pas, il peut alors demander aux autres de se donner la peine de l’aider. Mais pour réaliser cela, il s’agit de s’intéresser à la parole déjà prononcée, et ne pas uniquement penser à ce que l’on a envie de dire, même si ailleurs l’herbe est plus verte. Il s’agit de se fixer un but, s’y atteler et se concentrer, et ne pas se laisser déborder par le bouillonnement intérieur, lorsque les idées se bousculent au portillon comme pour une sortie de métro à l’heure de pointe. Schwarmereï, dirait Hegel, vrombissement d’un essaim de guêpes où plus rien ne se distingue.
Le tout n’est pas de dire, mais de déterminer de manière délibérée ce que l’on veut dire, de dire effectivement ce que l’on veut dire, et de savoir ce que l’on dit. Sans cela, la discussion peut s’avérer tout à fait sympathique et conviviale, mais est-ce bien philosophique ?
http://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2017/10/LOGO12-300x90.png00ced95vinhttp://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2017/10/LOGO12-300x90.pngced95vin2017-11-17 11:25:312018-03-31 00:21:49Philosopher, c’est savoir ce que l’on dit
La philosophie avec les enfants, comme toutes les activités humaines, souffre d’un certain nombre de tics et de tares. Tout d’abord, on peut se demander pourquoi un adulte préfèrerait travailler avec des enfants plutôt qu’avec des adultes. Bien sûr, ce peut être par vocation ou par nécessité, et il y a toutes sortes de raisons, bonnes, généreuses ou nobles, qui justifient et expliquent de tels choix professionnels, mais comme toujours dans une analyse philosophique, il semble nécessaire d’envisager les pathologies naturelles qui sont non seulement la cause mais aussi le résultat de ces choix précis. En guise d’exemple, puisque le questionnement semble être au cœur du philosopher, tentons d’analyser en particulier comment les adultes traitent les questions posées par les enfants. Nous ne prétendons pas proposer ici une étude vaste et exhaustive de la question, mais seulement lancer quelques pistes qui nous impliquent des conséquences sur le philosopher lui-même.
Adultes enfants
Intuitivement ou consciemment, une personne qui rencontre des difficultés pour établir une relation fonctionnelle avec des adultes, pourra se tourner vers les enfants. Premièrement, parce que dans bien des cas ces derniers ne contestent pas l’identité de l’adulte, tandis que ce dernier se sent grand et fort en leur présence. Deuxièmement, parce que l’autorité et le pouvoir sont a priori accordés à l’adulte sur les enfants. Troisièmement, parce que l’adulte a l’impression d’en savoir beaucoup, comparé aux enfants. Quatrièmement, parce que l’adulte peut revivre son enfance et pour cela, certains se sentirons bien avec leurs petits compagnons. Néanmoins, bien sûr, rien de tout cela n’est totalement clair et net, ni particulièrement conscient. Comme Frédéric Schiller l’identifia, il réside toujours une certaine ambiguïté dans la relation entre l’adulte et l’enfant. Quand une grande personne voit trébucher un bambin qui apprend à marcher, il se sent certainement très compétent, fort et puissant comparé à lui, mais au même moment il ressent une petite touche de jalousie, à l’idée que ce jeune être a encore toutes ses possibilités, qu’il a toute la vie devant lui : toutes les options lui sont encore ouvertes, ce qui a pour conséquence d’induire quelques regrets dans l’esprit de l’adulte par rapport à un passé déjà révolu et déterminé. Toutefois, les bonnes âmes protesteront énergiquement que jamais semblable jalousie envers un pauvre enfant innocent et sans défense ne leur soit jamais venue à l’esprit.
Les enfants sont naturellement philosophes au sens où les questions leur viennent facilement à l’esprit. À un âge où ils ont tant à découvrir sur le monde et sur eux-mêmes, l’étonnement, l’émerveillement et la stupéfaction, caractéristiques importantes d’un esprit philosophe, jouent encore assez pleinement. Bien que l’on puisse objecter qu’il ne soit pas totalement conscient du contenu des questions qu’il formule: prenons comme exemple le pourquoi qui peut être articulé de manière très mécanique sas aucun souci réel de la réponse. Néanmoins, comme pour tout ce qui a trait à la nature humaine, cette tendance peut être maîtrisée ou encouragée, interrompue ou développée. Ainsi, dès l’âge de sept ou huit ans, nous observons comment un certain principe de réalité, que nous pouvons nommer également principe de certitude, aussi légitime soit-il, envahit l’esprit de l’enfant, ce qui a pour effet d’étouffer l’interrogation métaphysique qui jusque-là constituait la majeure partie de sa vie intellectuelle. Il entre dans un âge « scientifique », qui comprend lui aussi son propre domaine de questions et de réponses, de nature bien établie, un domaine qui tend cependant à restreindre son activité au champ du physique, à la contrainte du probable et de la certitude sensible, plus communément acceptables que la pure possibilité et la veine poétique. Notre propos souhaite mettre en exergue ici un certain conditionnement de l’esprit, au demeurant tout à fait attendu et acceptable, puisque ce processus constitue la majeure partie de l’apprentissage de la vie en société, qui implique de se conformer à la connaissance et au comportement acquis socialement, processus qui simultanément entraîne une contrainte et une diminution importante des compétences intellectuelles de l’enfant. Maintenant, bien sûr, la nature et les modalités de cette transformations dépendront largement du contexte culturel et familial qui entoure l’enfant. Dans notre perspective, l’enseignement philosophique consiste à entretenir, instaurer ou restaurer le questionnement illimité qui autorise l’enfant, et l’adulte plus tard, à penser l’impensable. Tentons de montrer maintenant comment est inhibé lentement ou brutalement ce potentiel de mise en abyme de l’esprit singulier.
Trop occupés
Il nous semble avoir identifié trois dysfonctionnements importants par lesquels le questionnement des enfants et leur étonnement se sont refroidis ou éteints. Nous les présenterons dans un ordre de subtilité et de sophistication croissant, bien que le processus ne soit pas aussi mécanique que nous le présentons, et qu’opère souvent un certain mélange hétérogènes de comportements parentaux ou adultes. Le premier obstacle, le plus commun et le plus sommaire, est l’inattention pure et simple au questionnement et à l’étonnement. Cela prend la forme légère et indirecte de ne pas écouter, ou l’injonction plus brutale de garder le silence ou d’aller voir ailleurs. Il nous semble important de classer ces deux types de réaction dans la même catégorie, même si l’une semble conserver une apparence plus souple et plus civilisée ; à long terme cela produira exactement le même effet. Combien de parents, qui ne privent jamais ou rarement leur enfant du droit de parler, et qui seraient même horrifiés à une telle idée, continuent pourtant avec la meilleure conscience du monde à mener leurs petites affaires, peu importe leur utilité ou leur nécessité, que ce soit le travail, les courses, regarder la télévision, ou aller ici et là, sans réellement prendre le temps d’écouter leur enfant. En agissant de cette façon, le parent établit une hiérarchie précise dans l’esprit de sa progéniture, déterminant pour lui au présent et dans le futur, ce qui est primaire et ce qui est secondaire. La nécessité immédiate définitivement prime sur la gratuité de l’examen intellectuel et la beauté de la contemplation. S’il en est ainsi, l’adulte ne devrait pas s’écrier, à ce moment-là ou plus tard, que son enfant ne réfléchit pas avant d’agir et suit principalement ses impulsions premières.
Réponses toutes faites
La seconde manière d’occulter le questionnement de l’enfant est en répondant directement à ses questions, peu importe le degré de complexité, l’opportunité et la qualité des réponses. Quoique le temps imparti et la manière dont les réponses s’articuleront feront manifestement une différence. Ce qui motive notre critique de la réponse parentale ou enseignante est d’abord qu’une telle systématisation induit une relation faussée à l’idée même de question. Ce comportement encourage une tendance à compter sur une autorité extérieure, développant l’hétéronomie plutôt que l’autonomie. Ce que nous qualifions de « faussé », est le fait que les questions ne sont pas appréciées pour elles-mêmes, comme un cadeau précieux que notre propre esprit nous offre, mais se voient transformées en de simples envies qui demandent à être satisfaites, un manque qui demande à être comblé, situation déplaisante que le parent « bienveillant » veut obstinément corriger en fournissant des réponses toutes faites. Pourtant, ces réponses de valeur aléatoire seront souvent moins innovatrices et créatrices que la question elle-même. L’idée que nous avançons ici consiste à affirmer qu’une question a de la valeur en elle-même. Elle représente une ouverture sur le monde et sur l’être, qui nécessairement produit un concept ou une idée, sous une forme négative qui n’a pas moins de valeur que son image miroir : la réponse. Une question a une valeur esthétique, sa forme provoque l’esprit, identique en son aspect à une peinture ou une sculpture que le spectateur contemple sans arrière-pensées et préoccupations urgentes, quant à l’utilité, la vérité ou la solution du problème offert à ses sens et à sa raison. Cette perspective n’interdit nullement une tentative de réponse, mais dans notre perspective, la réponse est quelque peu dévalorisée, retirée de son piédestal, elle perd son statut de but final et ultime du processus intellectuel, de l’activité de l’esprit.
On ne peut pas répondre aux questions importantes, aux questions profondes, on ne doit pas y répondre. Elles peuvent être seulement problématisées, ce qui signifie pour nous analyser initialement leur contenu, les apprécier pour ce qu’elles apportent, et en un second temps peut-être, suggérer quelques idées susceptibles d’éclairer différents aspects pouvant fournir matière à une discussion. Le questionnement est une expérience de l’esprit, un outil permettant d’explorer les limites de la connaissance et de la compréhension. Au demeurant, pour cette raison, il reste crucial que l’adulte, parent ou enseignant, avoue parfois à l’enfant ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, soit parce qu’il ne connaît pas la réponse, soit parce qu’il postule et explique qu’aucune réponse précise ne conviendrait pleinement, et que dans ces cas la question doit se satisfaire à elle-même, ne serait-ce que temporairement, comme une garantie de la vie de l’esprit. Il est indéniable qu’une telle vision pourra engendrer une certaine crainte ou anxiété dans l’esprit de l’enfant – et de l’adulte – qui a besoin de valeurs dans lesquelles il peut ancrer son existence et sa vie spirituelle, de la même manière qu’il a besoin de nourriture pour satisfaire les besoins de sa vie biologique. Ajoutons simplement que, heureusement, un enfant ne mange pas dès qu’il le désire, qu’on lui apprend à retarder la satisfaction de ses besoins, de façon à le libérer de la satisfaction immédiate de ses propres impulsions. Le désir, l’état de manque, est en soi sain et productif, dans la mesure où on lui permet de jouer son rôle dans le temps, dans la durée, si l’on s’abstient de « résoudre » instantanément l’équivocité et le doute qu’il engendre dans le soi. Après tout, autant s’y habituer, puisque le déséquilibre, l’irrégularité et l’inconfort représentent des caractéristiques fondamentales et constitutrices de la vie.
Autonomie
Revenons à l’autonomie : comme pour n’importe quelle autre activité dans laquelle l’enfant est impliqué, il est utile et indispensable qu’il apprenne à se débrouiller lui-même. Ce type d’enseignement présuppose que l’adulte retienne sa tendance naturelle à « materner » qui nous incite instinctivement à « donner la becquée », de façon à inviter l’enfant à se confronter à lui-même et à développer ses propres capacités. Apprendre à pêcher à un homme, plutôt que de lui donner des poissons, dit un proverbe chinois, signifie bien que fournir des poissons est un obstacle à l’apprentissage de la pêche, aussi nourrissants que soient ces poissons. Mais bien sûr, et cela constitue la réalité de ce problème, il est plus pratique de fournir des poissons frais, petits objets pouvant être tenus facilement en main, car l’apprentissage de la pêche implique une procédure plus lente et plus subtile, où l’enseignant doit consciencieusement approfondir la compréhension de son propre art et en même temps être plus perspicace quant au fonctionnement global de l’enfant. Le chemin long, dit Platon, plutôt que le chemin court où le maître fournit des réponses toutes faites à son élève. L’enfant doit apprendre à travailler par lui-même, sinon il cherchera éternellement ses réponses chez les autorités établies – signe de respect sans doute – au lieu de chercher en lui-même. L’apprentissage de l’autonomie doit cependant commencer très tôt, et ce n’est pas par des injonctions immédiates ou tardives d’autodétermination forcée que le jeune adulte s’initiera à cet aspect crucial de son existence – comme beaucoup de parents le croient, lorsqu’ils font soudain face, dans l’urgence d’un problème spécifique, à ce qu’ils considèrent comme une influence négative et perverse du monde extérieur sur leur enfant. Le processus qu’il s’agit d’engager est d’encourager l’enfant à faire confiance à ses propres capacités à penser, à produire des idées, à délibérer et à juger par ses propres moyens, par lui-même, et cela s’accomplira uniquement par une lente initiation, par le biais d’une pratique constante qui démarre dès le plus jeune âge.
Nous rencontrerons deux objections courantes à une telle attitude pédagogique, étroitement liées entre elles. La première est l’argument de valeur, la seconde est l’argument du doute, son corollaire. L’argument de valeur affirme que les enfants ont besoin de valeurs pour se construire eux-mêmes, points de repère sans lesquels ils ne peuvent grandir et se constituer eux-mêmes pour devenir des adultes matures et responsables, valeurs sans lesquelles un être humain n’est pas complet. Aussi, les parents, ou les enseignants, dans le but d’éduquer, se doivent de véhiculer un nombre de lignes directrices sur les questions fondamentales : le vrai et le faux, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la beauté et la laideur, l’interdit et l’obligation, les droits et les devoirs, etc. Disons que les adultes, en général, se conçoivent eux-mêmes comme les gardiens de certains principes acquis et hérités, composant une axiologie approximative dont les fondements ne sont pas vraiment clairs, quand ils ne sont pas pétris de contradictions. Néanmoins ils restent convaincus que ces valeurs sont nécessaires aux enfants dont ils sont responsables, pour un mélange de raisons pratiques, idéologiques, ou simplement pour affirmer leur autorité, distinctions majeures, pourtant plus que souvent négligées. Si nous insistons sur le côté arbitraire de ces schémas éducatifs, c’est parce que la raison y joue seulement un rôle mineur, voire absent. Il est évidemment utile et nécessaire d’inculquer à l’enfant un ensemble de « vérités » générales sur la réalité globale et singulière, issu de notre expérience d’adulte, de façon à ce que ses actions et décisions ne soient pas réduites au cas par cas, afin qu’il apprenne à ne pas se limiter à des impulsions purement instinctives ou réactives. Nous ne devons pas oublier que cette entreprise est destinée à fournir du sens au monde et à sa propre existence, un sens dont l’enfant a besoin. Mais, si nous n’allouons pas à cet enfant un espace de liberté pour créer de lui-même une telle vision du monde, il deviendra, comme beaucoup d’êtres humains, le produit d’un conditionnement réducteur, rigide et irréfléchi, à moins qu’il se révolte contre une perspective dogmatique avec une contre-perspective également dogmatique. En ce sens, il doit être initié à la pratique des principes généraux de sagesse, de connaissance et d’utilité, pour des raisons existentielles, morales et intellectuelles, avec un certain degré d’imposition sans lequel ces principes perdraient leur force, mais il doit également apprendre à analyser, comparer, critiquer, questionner et formuler de tels principes généraux de sa propre gouverne. Ce pari éducatif, pari sur la raison et l’autonomie, exige un engagement vaste, généreux et exigeant, devant lequel trop de parents et d’enseignants reculent, pour différentes raisons : manque d’énergie, manque d’éducation, peur, etc. Les mêmes principes seront plus ou moins utilisés pour « l’argument du doute » avec de surcroît l’affirmation que l’incertitude est génératrice d’anxiété : il faut protéger le pauvre petit être. Mais de la même façon que protéger en permanence un enfant de la mise à l’épreuve corporelle ne lui permettra pas de développer sa force physique, il en va de même pour sa force psychique. Si un adulte conçoit sa responsabilité envers l’enfant principalement comme une protection contre lui-même et le monde extérieur, nous ne devrions pas être surpris que cet enfant développe une vision paranoïaque du monde, un monde qui ne ressemblera jamais à ce qu’il devrait être, un monde sur lequel en tant qu’adulte il ne pourra jamais intervenir, puisqu’il n’aura jamais travaillé ses propres capacités, puisqu’il n’aura jamais été initié à sa propre puissance. Comment quelqu’un peut-il être généreux et libre s’il n’a jamais subi l’angoisse du doute, s’il n’a pas appris à le confronter, à l’accepter, à le résoudre et même à l’aimer comme une sorte de déséquilibre qui maintient l’esprit et le garde vivant ? Le symptôme premier d’une société de consommation n’est-il pas le fait que les adultes sont plus soucieux de satisfaire leurs misérables besoins immédiats, privés et quotidiens, que de relever n’importe quel autre grand défi enthousiasmant ? Mais cette dernière attitude exige de développer une certaine confiance en soi, au fil du temps, à travers les nombreux obstacles et difficultés apparentes, et grâce à eux.
Un dernier point que nous désirons soulever sur cette question est que les enfants ont un sens plus aigu de la gratuité que les adultes : ils savent encore comment jouer divers rôles, comment faire « comme si », comment être dans l’instant, ils perçoivent plus aisément la facticité de leur comportement et se sentent pour cela probablement moins menacés que leurs aînés par le libre examen et la vérification de leurs postures et de leurs idées. Du fait de leur âge et de leur ancrage dans l’existence, les adultes ont plus à perdre et à prouver : souvent, ils craignent la mort et l’absurdité, plus qu’ils n’aiment l’authenticité, la vie de l’esprit et la mise à l’épreuve de l’intellect. En cela réside probablement la raison principale pour laquelle ils se sentent obligés de répondre aux questions des enfants, refusent ouvertement d’admettre leur ignorance sur des questions fondamentales, et imposent leur autorité de manière inconsidérée. Tout cela avec la meilleure conscience du monde, et pour le bien suprême des enfants, du moins en apparence.
Complaisance
Le troisième travers important par lequel le questionnement de l’enfant et son étonnement sont anéantis est ce qu’on pourrait qualifier de complaisance ou d’attitude condescendante. Sa manifestation la plus fréquente surgit comme une exclamation, en guise de réponse aux mots de l’enfant, qui ressemble à quelque chose comme : « Oh ! Écoute ça ! C’est trop mignon ! ». Par le mot complaisance, nous entendons à la fois une complaisance à l’égard de l’enfant et à l’égard de l’adulte lui-même, ce dernier pensé à la fois comme témoin des mots enfantins et auteur du commentaire, en son attitude paternaliste et satisfaite. Il s’agit aussi d’une complaisance envers l’enfant puisque, par facilité, nous ne lui permettons pas de s’entendre, nous ne l’encourageons pas à s’écouter réellement, à prolonger son discours, à l’expliciter, à se saisir de ses propres paroles, à en envisager les conséquences et les applications. De manière générale, l’enfant est alors principalement incité à offrir une performance, à être en représentation, à plaire à l’adulte, à être mignon, à éparpiller quelques mots dans l’espoir de quelque succès aisé, un succès qui sera acquis dans la mesure où il obtient une exclamation de satisfaction de la part de l’autorité en place. Quant à l’adulte, il se satisfait de peu puisqu’il ne prend pas la peine de penser jusqu’au bout ce qu’il a entendu. Peut-être le désir de l’enfant était-il d’exprimer quelque chose de profond et de puissant, tentative qui se trouve en un certain sens ridiculisée, en se voyant réduite à la mignardise et à la coquetterie. Quand bien même il serait surpris ou pris au dépourvu par le rire, le sourire ou l’exclamation de l’adulte, en un second temps l’enfant sera content de son succès : la prochaine fois il essaiera de manière délibérée d’obtenir un résultat identique, plutôt que de tenter à nouveau d’exprimer quelque chose de profond, encourageant chez lui un comportement d’histrion. Le travail de l’adulte, le défi qui se pose à lui étaient de creuser, d’approfondir et de mettre au jour l’intention de l’enfant, qui était peut-être une intuition forte comme les petits peuvent en avoir, du type « le roi est nu ! ». Ou encore l’une de ces questions basiques, oubliées depuis si longtemps, si embarrassantes pour nous, du type « Pourquoi sommes-nous là ? ». La responsabilité de l’adulte doit davantage être d’inviter l’enfant à aller plus loin, responsabilité qui nécessite ouverture, réceptivité, vigilance, patience et un minimum de rigueur. Combien d’enseignants négligent trop facilement le discours de l’enfant pour ces manques très spécifiques, alors qu’une écoute attentive leur aurait fourni de précieux éclaircissements sur certaines difficultés pédagogiques, ou aurait permis d’éclairer ou de justifier certaines interprétations inattendues d’objets de connaissance. N’oublions pas que la réaction « C’est mignon ! » est l’équivalent inverse ou l’image miroir de « Tout ça n’est que charabia ! » : le sens profond est oublié dans les deux cas.
La condescendance est une attitude complexe. Pourquoi être vexé lorsque quelqu’un essaie d’être gentil ? Si vous l’accusez de ne manifester aucun respect dans sa façon de s’adresser à vous, il opposera à vos critiques sa gentillesse et ses bonnes intentions envers votre personne. Et que pourrez-vous répondre, sinon quelque chose comme « Mais tu me traites comme un enfant ! ». Les adolescents se rebellent avec colère contre cette attitude, parce qu’ils arrivent difficilement à déceler et à conceptualiser le problème que pose cette attitude, parce que prime alors le sentiment de frustration et que la colère reste le seul mode de rébellion. Mais l’enfant, lui, opère dans un mode relationnel de dépendance : la complaisance peut fort bien ne pas le gêner. Il veut principalement obtenir des manifestations d’amour et d’appréciation, il n’est pas encore trop angoissé au sujet de sa propre autonomie, du moins pas sur la question de la pensée et des idées. Aussi sacrifiera-t-il très facilement un désir d’exprimer des pensées profondes, intelligentes et passionnées, ainsi fera-t-il fi d’une intention qu’il n’est pas sûr de maîtriser, afin de simplement plaire à l’autorité en place. Il se sent davantage valorisé par ces réactions condescendantes que par la demande d’un questionnement supplémentaire ou d’une discussion avec l’adulte, à moins qu’il ne devienne plus conscient de ses capacités de penser et n’apprenne à les apprécier et à leur faire confiance. Observons le sourire permanent que certains adultes arborent comme un signal de bienvenue du discours de l’enfant : ne nous sentirions-nous pas insultés si l’on nous écoutait avec ce même sourire quasi contraint ? Le sourire fréquent, qui pour un nouveau-né comporte un sens fort et important, peut devenir un obstacle quand l’enfant grandit, quand il a besoin d’être pris au sérieux.
Aimer les enfants
Sans aucun doute, les adultes peuvent apprendre en discutant avec les enfants. En raison de leur attitude naïve, pas encore trop conditionnée, ni fermée à l’originaire, moins effrayée par les vérités générales et leurs implications, moins soucieuse de l’approbation de la société, moins calculatrice et cynique, ils peuvent produire ces trésors de sagesse et de vérité que nous, adultes, aimons tant entendre : « La vérité sort de la bouche des enfants » dit-on. Au point que ici et là quelques théoriciens érigeront sans hésitation l’enfant en véritable maître, et comme souvent lorsqu’un maître est posé sur un piédestal et glorifié, les idolâtres capituleront devant leur propre capacité à penser ; dans le cas présent, ils abandonneront leur propre capacité de se confronter à eux-mêmes et à la radicalité de la jeunesse.
Ceux-là oublient trop facilement que l’enfant lui-même ignore son enfance : on doit avoir parcouru un long chemin avant de se connaître soi-même et de connaître son entourage. L’esprit humain est malin : il est suffisamment renseigné sur lui-même pour être capable de nourrir et de flatter ses propres tendances tortueuses. Notre charmant esprit est entraîné depuis son plus jeune âge à interpréter le monde, à lui donner du sens, à adapter son langage et sa vérité afin de se sentir plus à l’aise, afin de se sentir mieux, et d’oublier sa propre faiblesse et sa mortalité. Que ce soit en n’écoutant pas l’enfant, de manière grossière ou subtile, en le faisant taire avec des réponses, en souriant ou en riant à ses mots puérils, en contemplant et en admirant son « petit soi merveilleux », en basculant dans le piège douillet de la nostalgie : un simple quart de tour de cheville sépare l’utilitarisme, le dogmatisme, le cynisme et le romantisme. Dans tous les cas, ces attitudes protègeront notre vieil être usé par l’expérience, des étincelles de génie primitif jaillissants de manière inattendue de l’inconscience de notre progéniture. Il est trop facile d’utiliser ces petits êtres et leurs éjaculations simplement pour offrir à notre soi anxieux et timoré un complément d’âme. Ne ressemblons pas à ces vieux empereurs chinois pitoyables qui avaient pour habitude de se baigner avec des douzaines d’adolescentes dans le but d’obtenir de ce bain de jouvence quelque jeunesse et quelque longévité. Nous pouvons aimer les enfants comme la dame de charité aime ses pauvres. Elle visite les taudis chaque dimanche après-midi, après le déjeuner et avant le thé, apportant quelques vêtements usés et installant deux ou trois rideaux en dentelle aux fenêtres abîmées. Elle se sent bien, tellement bien, et ce sentiment intense de chaleur et de bonne conscience la suivra tout au long de la semaine, tandis qu’elle s’emploie à ses activités mondaines, frivoles et sans intérêt. Les enfants peuvent être des esprits très provocateurs, dans la mesure où nous provoquons leur esprit. L’adulte qui se présente lui-même comme l’ « animateur » d’une discussion philosophique avec les enfants, qui ne les confronte pas à leur propre pensée en général ne se confrontera pas lui-même : s’il ne s’engage pas lui-même dans une activité philosophique, il ne pourra pas s’assurer que les enfants philosophent, ne serait-ce que parce que les enfants ignorent en quoi consiste la philosophie et ses exigences, qu’il s’agit bien de leur enseigner. Si l’adulte ne trouve pas une façon de s’engager lui-même plus profondément dans la réflexion philosophique au cours du travail en classe — un engagement qui ne prendra pas nécessairement une forme identique à celle des enfants — ceux-ci seront moins enclins à s’engager plus avant. Après tout, c’est lui l’enseignant, et si l’enseignant agit comme un spectateur, les enfants feront de même, et participeront seulement de manière formelle à l’exercice.
En général, les adultes sont contents des enfants, comme de n’importe quel autre être ou objet, lorsqu’ils obtiennent d’eux ce qu’ils attendaient. Cette affirmation semblera très dure envers ces adultes « pleins de bonne volonté ». Pourtant, peu importe la nature et la légitimité de la volonté, elle reste une volonté. Et cette volonté est diverse. Le schéma le plus classique est la volonté de voir dans l’enfant ce que nous y mettons – le retour de l’investissement -, et celle d’être satisfait en entendant l’écho de nos propres mots, de notre propre système mental. Que ce soit en l’écoutant avec une sorte de hochement de tête paternaliste, qui signifie « Vas-y petit garçon, vas-y petite fille, participe, exprime-toi, c’est bien de t’entendre parler, même si j’en sais plus que toi et je te le dirai à la première occasion. » Ou que ce soit par l’imposition plus franche et directs d’une axiologie, d’une éthique, qui sans patience aucune ne supporte aucune déviance ou hérésie. Ou encore, ce peut être en ne laissant aucun moment ni interstice pour le questionnement. Le résultat reste le même : l’adulte ne saisit pas l’opportunité de philosopher, de problématiser sa propre pensée, et par conséquent, comment peut-il induire ou encourager un processus philosophique dans l’esprit de l’enfant ? Comme pour commencer à philosopher, l’adulte doit être conscient de ses propres raisons de philosopher, a fortiori s’il veut philosopher avec les enfants. Ainsi ses élèves ne deviendront pas un quelconque refuge pour qu’il se sente mieux. Assez étrangement, devenir conscient de la vraie nature du philosopher avec les enfants passe probablement par l’aveu d’un désir égoïste de la part de l’enseignant, qui peut seulement s’accomplir en confrontant sa propre pensée avec la pensée des enfants, puisqu’ils sont dotés d’un génie naturel, mélangé à une suprême banalité, combinaison que les adultes ne sauraient par eux-mêmes produire Simultanément, nous découvrons de véritables perles, si nous sommes capables de les entendre, car nous nous sentons si puissants avec notre propre connaissance « accomplie » et nos compétences. Mais enfin, pourquoi pas, il y a de pires conditions et chemins pour philosopher !
Cet article est le résultat d’un travail mené par l’auteur, philosophe de formation, avec plusieurs classes de maternelle. Les divers exercices dont il est question ont été déterminés en concertation avec les instituteurs et s’effectuaient en leur présence.
1re partie : Le fonctionnement
1 – Philosopher en maternelle ?
Que vient faire la philosophie à la maternelle ? Que ce soit sous un œil favorable ou critique, la plupart de ceux qui entendent parler d’une telle initiative restent perplexes et se posent la question. En quoi peut consister cette activité avec des enfants de trois à cinq ans, alors que les jeunes de dix-huit ans – chez qui les résultats au baccalauréat en ce domaine ne sont pas particulièrement bons – ont souvent du mal avec cette matière étrange à la réputation plus que douteuse. Ou alors posons-nous la question autrement : à dix-huit ans, n’est-il presque pas trop tard pour philosopher, trop tard pour commencer en tout cas ? Quel professeur ne constate pas périodiquement son impuissance, lorsqu’il tente une année durant d’induire parmi d’autres aptitudes une sorte d’esprit critique chez ses élèves, sans toujours beaucoup de succès ? Ce n’est pas que l’initiation à cette pensée critique produirait nécessairement des miracles et résoudrait tous les problèmes pédagogiques, mais si nous pensons qu’elle est d’une quelconque nécessité, ne pourrait-on pas éviter quelque peu le côté placage artificiel, tardif et parachuté de l’affaire, en accoutumant progressivement les enfants à un tel esprit, au fur et à mesure de leur développement cognitif et émotionnel ? Évidemment, et là réside sans doute le nœud de l’affaire, il faudrait sans doute extraire la philosophie de sa gangue principalement culturelle et érudite, pour la concevoir comme une mise à l’épreuve de l’être singulier, comme la constitution d’une individualité qui s’élabore dès le plus jeune age. En ce renversement copernicien se trouve certainement la véritable difficulté : elle exige de faire basculer un certain nombre de concepts éducatifs. Tentons en premier lieu de cerner en quoi une discussion avec des enfants serait philosophique. Car il ne peut s’agir que de discussion, dans la mesure où l’écrit n’est pas encore au rendez-vous. “Ne s’agirait-il pas uniquement d’une propédeutique à la philosophie, d’une simple préparation au philosopher ?” nous sera-t-il demandé. Mais en fin de compte, dans une certaine tradition socratique, le philosopher n’est-il pas en essence une propédeutique, ne consiste-t-il pas en une préparation jamais achevée ? Sa matière vive ne serait-elle pas un questionnement incessant ? Toute idée particulière n’est-elle pas une simple hypothèse, moment éphémère du processus de la pensée ? Dès lors, philosophe-t-on moins en une ébauche du philosopher qu’au cours d’une théorisation épaisse et complexe ? L’érudit philosophe-t-il plus que ne le fait un enfant en maternelle ? Rien n’est moins sûr ; pire encore, la question est dépourvue de sens. Car si le philosopher est une mise à l’épreuve de l’être singulier, il est nullement certain que l’éveil de l’esprit critique ne représente pas un bouleversement personnel plus fondamental que les analyses savantes de notre routier de la pensée. C’est en ce sens que cette pratique se doit de s’installer très tôt chez l’enfant, à défaut de quoi il est à craindre que la vie de la pensée n’en vienne ultérieurement à se concevoir comme une opération périphérique, extérieure à l’existence, phénomène que l’on observe très souvent dans l’institution philosophique et dans l’enseignement en général. Toutefois, admettons qu’en tentant d’installer une pratique philosophique chez les enfants en bas age, nous prenions le risque de toucher aux limites de la philosophie. N’avons-nous pas simplement versé dans le simple apprentissage du langage, dans toute sa généralité ? Ou dans quelque art minimal de la discussion ? L’ingrédient philosophique n’est-il pas ici tellement diluée que c’est se faire plaisir que d’employer encore un tel mot pour définir cette pratique pédagogique ? Prenons là aussi ce problème sous un autre angle. Demandons-nous si au contraire le fait de rencontrer des situations limites, en mettant à l’épreuve l’idée même du philosopher et sa possibilité, ne nous place pas dans l’obligation de resserrer au maximum la définition de cette activité, d’articuler sous une forme minimale et donc essentielle son unité constitutive et limitative. Autrement dit, l’émergence du philosopher ne serait-il pas par hasard la substance même du philosopher ? Cette question est celle vers laquelle semble pointer du doigt Socrate, qui à tout bout de champ, phénomène incompréhensible pour bien des érudits modernes, fait philosopher le premier venu, y compris les soi-disant ennemis de la philosophie que sont les savants sophistes, afin de nous mettre au défi en nous montrant ce qui peut être accompli. Cette banalisation extrême de la philosophie n’en devient-elle pas le révélateur par excellence, dramatisation de cette activité mystérieuse qui, à l’instar du sentiment amoureux, échappe à celui qui pense en détenir l’objet ?
2 – Aptitudes et compétences du philosopher
En guise de point de départ de notre pratique, déterminons trois aspects de l’exigence philosophique, trois aspects qui serviront à en composer la pratique. Ces trois facettes de l’activité semblent exprimer l’exigence supplémentaire au simple exercice de la parole, comme le pratique déjà n’importe quel instituteur. Il s’agit des dimensions intellectuelles, existentielles et sociales, termes que chacun renommera comme il l’entend. L’ensemble des trois activités se résumant à l’idée de penser par soi-même, être soi-même, et être dans le groupe. Intellectuel – Comprendre – Articuler cette compréhension afin d’être compris – Proposer analyses et des hypothèses – Argumenter – Pratique de l’interrogation – Initiation à la logique – Elaboration du jugement – Utilisation et création de concepts : erreur, mensonge, vérité, “carabistouille” – Reformuler ou modifier sa propre pensée Existentiel – Découvrir et exprimer une identité au travers de ses choix et de ses jugements – Prendre conscience de sa propre pensée – S’interroger, découvrir et reconnaître l’erreur et l’incohérence en soi-même – Contrôler ses réactions Social – Écouter l’autre, lui faire place, le respecter et le comprendre – Se risquer et s’intégrer dans un groupe – Comprendre, accepter et appliquer des règles de fonctionnement – Discuter les règles de fonctionnement
3 – Les ateliers
Trois modes formules différentes de l’exercice sont utilisées, qui fonctionnent à peu près de la même manière. La principale différence portant sur le support à utiliser. Atelier sur un thème général, atelier sur texte, atelier sur film. Dans les trois cas de figure le fonctionnement repose sur le fait que l’enseignant opère en creux et non pas en plein, c’est–à-dire qu’il travaille comme un animateur plutôt que comme un enseignant. Son rôle est avant tout d’interroger les enfants, de mettre en valeur les interventions et leurs enjeux, de mettre en rapport les différentes prises de paroles, de susciter des moments philosophiques, de réguler, dramatiser ou dédramatiser le débat. Atelier sur thème Soit le thème est imposé par l’enseignant, pour des raisons diverses (problèmes existentiels, sociaux, ou plus directement scolaires) : Faut-il être gentil avec son copain ? Doit-on toujours obéir ? Pourquoi allons-nous à l’école ? Préférons-nous la classe ou la récréation ? Ou encore le thème peut être choisi par l’ensemble de la classe, choix et vote qui deviennent alors une partie de l’exercice, voire l’exercice en soi. Puisqu’il s’agira non seulement de choisir collectivement, mais d’argumenter sur son choix et sur ceux des autres. Dans le cas du choix par la classe, selon les niveaux, le thème peut être une phrase, mais elle se réduit souvent à un simple mot : les parents, la télévision, un animal ou un autre, le Père Noël, les voitures, etc. Atelier sur texte Il s’agit généralement d’une histoire, d’un conte, qui au préalable sera raconté aux enfants, de préférence au moins deux ou trois fois, afin qu’ils en retiennent le mieux possible les éléments narratifs. Lors de l’atelier, la trame de base de la discussion portera en gros sur des questions du type : “L’histoire vous a-t-elle plu, et pourquoi ?”, “Quel personnage avez-vous préféré, et pourquoi ?“. Les élèves devront à la fois articuler leurs choix, les argumenter et les comparer à ceux de leurs camarades. Atelier sur film Le principe est identique à celui de l’atelier sur texte, bien que le film ait en général, pour des raisons pratiques, été visionné une seule fois. Il s’agira d’articuler et de comparer différents éléments narratifs, différents rejets ou préférences de personnages, et différentes appréciations ou interprétations du film.
4 – Articuler des choix
Comme nous l’avons en partie expliqué, l’atelier commence d’emblée par une prise de risque, de la part de l’élève et de la part de l’animateur. En réfléchissant sur ses choix, en les articulant, tout en sachant qu’il devra les argumenter, voire les justifier, l’enfant prend un risque qu’il ne faut pas sous-estimer : certains n’y arriveront d’ailleurs pas. Risque d’exprimer ce qu’il pense, risque de parler devant les camarades, risque de parler devant l’enseignant, risque de ne pas pouvoir justifier ses choix, crainte de “mal faire”, etc. Pour l’enseignant, la prise de risque est d’entendre des choix et des arguments qui pourront lui sembler aberrants, inquiétants, voire faux. Sans pour autant manifester sa désapprobation ou son inquiétude. Tout en continuant son questionnement, à cet élève ou à un autre. Certains enseignants avouent leur impatience dans ce genre de situation, révélatrice d’une certaine inquiétude. Pour dédramatiser la prise de risque auprès des élèves, l’exercice est souvent présenté comme un jeu, comparable à un autre, et l’aspect ludique doit être périodiquement rappelé, en alternance avec des moments plus sérieux. Pour les enfants qui ont du mal à exprimer leur opinion, il s’agit d’être patient, de recourir à eux de temps à autre afin qu’ils ne se sentent pas exclus, quand bien même ils ne réussissent pas à verbaliser, et à les rassurer en leur proposant de parler plus tard. L’animateur devrait veiller à ce que tous puissent s’exprimer un minimum.
5 – Ne pas répéter
L’idée d’effectuer un choix personnel constitue en soi un acte de réflexion, une prise de conscience, qui demande aux enfants un effort, à certains plus qu’à d’autres. Car il s’agit déjà de se poser consciemment la question, ce qui en maternelle n’est pas nécessairement un acquis. Pour que cet acte s’effectue, il s’agit tout d’abord ne pas tomber dans un piège : le réflexe de la répétition, très courant à cet âge. Dire comme les autres, fussent-ils les élèves ou le maître, c’est la tentation et la solution de facilité. C’est pour cette raison que dans cet exercice, il est crucial que l’animateur ne manifeste ni accord ni désaccord, tout au moins en cet aspect de la discussion. Quant au rapport avec les camarades, afin d’assurer qu’il n’y ait pas de répétition, une des règles du jeu consiste à interdire de répéter ce que quelqu’un d’autre a déjà dit, au risque d’un symbolique “mauvais point”. On observera d’ailleurs certains élèves qui tentent d’articuler différentes formulations d’une même idée afin de ne pas être sanctionnés par la règle du jeu, ce qui en soi est un mécanisme intéressant. Car il s’agira pour tous de se demander si c’est la même chose ou pas. L’animateur pourra à tout moment demander à la classe : “Est-ce que quelqu’un a déjà dit cela ?”. Et pour que la proposition soit refusée, il faudra qu’au moins un élève reconnaisse qu’il s’agit d’une réponse identique à celle de quelqu’un d’autre, qu’il devra nommer. En cas de doute, l’animateur pourra proposer une discussion et provoquer un vote sur la question. Cet élément a aussi un avantage, c’est qu’il oblige chacun à écouter et à se rappeler ce que disent les autres.
6 – Pourquoi ?
S’il est un principe fondamental qu’il s’agit d’inculquer, c’est le réflexe du pourquoi, car cet élément fondateur de la pensée et du discours donnera à la pensée et au discours sa substance. Si la notion du “pourquoi” est encore difficile en petite section, elle semble être plus ou moins assimilée en moyenne section, et largement en grande section. Le “pourquoi ?” rencontre souvent le “pasque”, un “parce que” qui est à la fois une ébauche et un obstacle à la réponse. Ici l’animateur peut demander à la cantonade si “pasque” suffit comme réponse, afin que tous s’habituent à aller au-delà de ce mot. La justification d’un choix ou d’une préférence doit devenir une habitude, un rituel, un automatisme. Si un enfant a du mal à exprimer le pourquoi de sa réponse, l’animateur pourra en un premier temps lui proposer une raison absurde, afin de provoquer une réponse plus appropriée. Par exemple si l’enfant a aimé un film drôle sans arriver à dire pourquoi, l’enseignant lui demandera si c’est parce que c’est triste et qu’il a pleuré. Cette petite provocation assiste l’enfant, lui fournit un cadre facilitant, tout en lui permettant néanmoins d’articuler sa réponse avec ses propres mots. En cas de grande difficulté, l’enseignant pourra proposer une série de réponses possibles, parmi lesquelles l’enfant en choisira une, mais ce principe du Q. C. M. devra être utilisé en dernier recours, pour éviter l’échec répété, car il fausse quelque peu la partie. Autre piège où s’enlise le pourquoi, plus subtil : “Parce que j’aime bien”, “Parce que c’est bien”, ou autres propositions d’acabit identique. Là encore il s’agira de demander à la classe si cette réponse suffit, et dès la moyenne section, il se trouve toujours un certain nombre d’élèves qui sauront reconnaître l’insuffisance de la réponse, ce qui amène l’élève en question à tenter d’exprimer pourquoi il aime bien, pourquoi c’est bien. Comme exemples de ces raisons, s’il s’agit d’un film ou d’une histoire, on pourra préférer tel ou tel personnage parce qu’il est gentil, parce qu’il est méchant, parce que personne n’est gentil avec lui, parce qu’il est beau, parce qu’il est fort, parce qu’il est courageux, parce qu’il tue les autres, parce qu’il aide les autres, etc. On pourra aussi aimer ou ne pas aimer l’histoire parce que c’est triste, parce que c’est drôle, parce que ça fait peur, parce que c’est joli, etc., autant de réponses qui devront être ensuite comparées et confrontées. Exemple de travail avec un enfant de moyenne section qui a du mal avec le “pourquoi ?”, lors d’une discussion à propos d’un dessert. Il a du mal car il doit imaginer et théoriser une situation dans laquelle il ne se trouve pas dans l’immédiat. Il s’agit donc de l’amener par des questions à effectuer cette démarche. (Notons au passage que le questionnement doit habituer l’élève au mode hypothétique, utilisé ici, ou à la forme négative, éléments cruciaux de la construction et de la flexibilité intellectuelles.) Pourquoi tu veux un dessert ? Je ne sais pas. Est-ce que c’est pour jouer ? Oui. Est-ce que tu joues avec un dessert ? Non. Alors, est-ce que tu veux un dessert parce que tu veux jouer ? Non. Pourquoi veux-tu un dessert ? Je ne sais pas. Est-ce parce que tu as soif ? Oui. Si je te donne de l’eau, est-ce que ça te donne un dessert ? Non. Est-ce que tu veux un dessert parce que tu as soif ? Non. Pourquoi veux-tu un dessert ? Parce que j’ai faim.
7 – Répondre à l’autre
Comme nous l’avons évoqué lors du paragraphe sur la répétition, il s’agit d’écouter et d’entendre ce qui émerge des autres. D’une part afin de ne pas répéter ce qu’ils disent, d’autre part afin de comparer leurs réponses aux nôtres, ensuite afin de leur répondre si l’on n’est pas d’accord. Périodiquement, l’animateur demandera si tout le monde est en agrément avec ce qu’a dit untel ou untel, surtout si la proposition a un contenu original ou provocateur. Ou bien il lancera ou relancera la discussion en demandant quels sont ceux qui ont aimé et quels sont ceux qui n’ont pas aimé ceci ou cela. Ceci permet d’installer une pluralité de perspectives, une prise de conscience des oppositions, permettant (donnant lieu) à l’enfant de se situer par rapport à ses pairs, l’obligeant de fait à se distinguer du groupe ou d’une quelconque autorité, celle du maître ou celle des pairs. L’articulation et le travail sur ces désaccords, désaccords tant sur la récapitulation de faits que sur les appréciations et jugements, incitent et entraînent l’enfant à argumenter et à justifier sa propre parole plutôt que d’en rester au “Oui ! Non ! Si ! Non !”. Cette mise en scène de la parole doit engendrer une situation de réflexion et de décrispation, ce qui offre la possibilité d’utiliser l’autre afin de revoir ses propres pensées et affirmations. En même temps, un travail sur la concentration et la mémoire s’effectue, car chacun est censé se rappeler ce que les uns et les autres ont dit, ce qui périodiquement sera vérifié et demandé par l’animateur, surtout lorsqu’il s’y trouvera un enjeu, comme celui de l’opposition ou de la répétition.
8 – Moments philosophiques
Au cours de la discussion naîtront des situations privilégiées, moments de retournement, moment de prise de conscience, moment de conversion, qui constituent le cœur de la pratique, que nous nommons “moments philosophiques”. C’est en ces moments que la parole ou la pensée ne sont plus simplement des paroles et des pensées, car ils représentent la mise à l’épreuve de l’être, moments à la foi conceptuels, libérateurs et constitutifs du soi singulier. Ils sont générés par deux types de situation. Soit lorsque l’enfant rencontre une idée contraire à la sienne, idée de préférence argumentée qui le fera hésiter ou qu’il acceptera de faire sienne après une hésitation ou une résistance plus ou moins longue et intense. Soit lorsque l’enfant hésite à répondre suite à une question qui l’embarrasse, parce qu’il prend conscience du problème posé par cette question. Peu importe alors qu’il réponde ou pas à la question, du moment qu’il en envisage un minimum les enjeux et les conséquences sur sa propre parole, particulièrement lorsque cela soulève un problème de contradiction interne dans ses propos. Devant l’embarras de l’enfant, l’enseignant lui demande “Avons-nous un problème ?” ou “Vois-tu le problème ?”. Car il s’agit d’apprendre à reconnaître un problème, à l’objectiver, à ne pas nécessairement le voir comme un moment négatif, ce qui représente une percée en soi et une grande part de la résolution. La notion de carabistouille, mot qui amuse beaucoup les enfants, s’est avérée ici porteuse. Elle qualifie une réponse dépourvue de sens, une incohérence, toute parole dont la légitimité est mise en question. La menace permanente de carabistouille invite l’enfant à émettre un jugement sur ses propres propos et celui des autres, en allégeant toutefois la portée du jugement. Ces moments sont qualifiés de philosophique parce qu’ils sont ceux où l’enfant prend conscience d’une notion du vrai et du faux qui n’est pas déterminée extérieurement et arbitrairement, mais de manière indépendante et autonome. Car en ce moment-là il est libre d’accepter ou de refuser l’argument, nullement imposé, et il est libre de reconnaître le problème ou la contradiction posée. Il peut les reconnaître ou ne pas les reconnaître. Mais la reconnaissance de ce moment, composante cruciale du philosopher, prend des formes multiples, que l’enseignant tentera de percevoir au mieux. L’enfant peut par exemple affecter un sourire coquin parce qu’il voit le problème et ne veut pas l’admettre, ou répéter ce qu’il a déjà dit de manière drôle et peu convaincue. Il peut aussi se mettre de manière visible à dandiner sur sa chaise, manifestant ainsi perplexité et embarras. Ce peut être tout le groupe qui éclate soudain de rire en face de la contradiction. L’enfant peut aussi devenir très mécontent, se mettre à bouder, esquisser un geste de colère ou s’entêter dans ses propos initiaux d’une manière qui exprime une mauvaise foi visible. Quoi qu’il en soit, il s’agit de considérer qu’il y a une forme de reconnaissance, admise ouvertement ou non, reconnaissance qu’il faut souligner afin que chacun en profite. On peut solliciter une confirmation de l’enfant en lui demandant : “On a un problème ici, n’est-ce pas ?”. L’enseignant peut dédramatiser la situation en soulignant son aspect comique : “N’est-ce pas rigolo ?” Ou faciliter la reconnaissance en demandant à l’enfant s’il apprécie ce qui a été dit, ou bien s’il aime ce genre de question. Mais un problème reste en permanence, auquel l’enseignant se doit d’être très attentif : l’enfant ne veut-il pas ou ne peut-il pas, pour diverses raisons, effectuer le renversement qui lui est demandé ? La marge entre les deux est parfois très ténue. Exemples : Dans une discussion sur la réalité d’un film à la télévision, un premier enfant affirme qu’un poney est vrai parce qu’il est dans la télévision et qu’il l’a vu. Un autre lui rétorque alors que si le poney était vrai, il aurait cassé la télévision parce qu’il est plus grand qu’elle. Le premier enfant est interloqué par l’argument, et l’enseignant lui demande ce qu’il en pense : l’enfant conclut par un sourire. L’enseignant lui redemande si le poney de la télévision est un vrai poney, et l’enfant répond que non. Dans une discussion à propos d’un film, une élève dit aimer un film parce qu’elle trouve rigolo que la grande sœur tape la petite sœur. L’enseignant la questionne. – Est-ce que tu as une grande sœur ? – Oui. – Trouves-tu rigolo qu’elle te tape ? Silence. Grand sourire de l’élève. Toute la classe éclate de rire.
2e partie : Analyse et critique
1 – Penser par soi-même
Un des résumés possibles de l’activité que nous décrivons en cet article est le principe du “Penser par soi-même”, idée chère à la tradition philosophique, que Platon, Descartes ou Kant articulent comme injonction première et fondamentale. Bien entendu, certains esquisseront un sourire à l’idée du “Penser par soi-même” à la maternelle. Nous traiterons un peu plus tard dans notre travail de ces réticences ; qu’il nous suffise d’affirmer pour l’instant que si l’on poursuit jusqu’au bout ce schéma du soupçon, on n’hésitera pas à affirmer en Terminale quand ce n’est pas à l’université – comme cela est courant – que les élèves n’ont de toute façon rien d’intéressant à dire. Pas étonnant dès lors, qu’ignorance et mépris, de soi et des autres, fassent florès. “Penser par soi-même” signifie avant tout comprendre que la pensée et la connaissance ne tombent pas du ciel, toute armée et casquée, mais qu’elle est produite par des individus, qui ont pour seul mérite de s’être arrêtés sur des idées et de les avoir exprimées. La pensée est donc une pratique, pas une révélation. Or si l’enfant s’habitue dès le plus jeune âge à croire que la pensée et la connaissance se résument à l’apprentissage et à la répétition des idées des adultes, idées toutes faites, ce n’est que fortuitement qu’il apprendra à penser par lui-même. De manière générale, c’est l’hétéronomie plutôt que l’autonomie qui sera encouragée dans son comportement général. Une difficulté reste : comment celui qui se pose en maître, l’enseignant, peut-il inciter ou encourager l’enfant à penser par lui-même ? Il s’agit en premier lieu de croire que la pensée se définit malgré tout comme un acte naturel, dont est doté à divers degré chaque être humain, dès son plus jeune âge. Toutefois un travail important doit s’accomplir, dont parents et enseignants ont la charge. En classe, tout exercice en ce sens consistera d’abord à demander à l’élève d’articuler les pensées plus ou moins conscientes qui surgissent et flottent dans son esprit. Leur articulation constitue la première et cruciale composante de la pratique du “penser par soi-même”. D’une part parce que la verbalisation permet une conscience accrue de ces idées et la pensée qui les génère. D’autre part parce que les difficultés dans l’élaboration de ces idées renvoient assez directement aux difficultés de la pensée elle-même : imprécisions, paralogismes, incohérences, etc. Il ne s’agit donc pas simplement de faire parler l’enfant, de le faire s’exprimer, mais de l’inviter à une plus grande maîtrise de sa pensée et de sa parole. Mentionnons au passage que si la compréhension, l’apprentissage et la récapitulation d’une leçon aident aussi à acquérir cette capacité, ce mode traditionnel de l’enseignement, livré à lui-même, encourage au psittacisme, au formalisme, à la parole désincarnée et surtout au double langage : une rupture radicale entre exprimer ce que l’on pense et tenir le discours que l’autorité attend de nous. Rupture aux conséquences on ne peut plus catastrophiques tant sur le plan intellectuel que social et existentiel. En résumé, “Penser par soi-même” se compose de plusieurs éléments constitutifs. En premier lieu, cela signifie exprimer ce que l’on pense sur tel ou tel sujet, ce qui exige déjà de se le demander, et de préciser cette pensée afin d’être compris. Deuxièmement, cela signifie devenir conscient de ce que l’on pense, prise de conscience qui nous renvoie déjà partiellement aux implications et aux conséquences de ces pensées, d’où ébauche forcée de raisonnement. Troisièmement, cela signifie travailler sur cette pensée et cette parole, afin de satisfaire des exigences de clarté et de cohérence. Quatrièmement, cela signifie se risquer à l’autre, cet autre qui nous interroge, nous contredit, et dont nous devons assumer la pensée et la parole en revoyant et en ré-articulant la nôtre. Or il n’est aucune leçon formelle qui pourra jamais remplacer cette pratique, pas plus que les discours sur la natation ne remplaceront jamais le saut dans le bain et les mouvements dans l’eau.
2 – Penser ensemble
Une bonne partie de l’exercice de la discussion philosophique se résume à la mise en rapport de l’enfant avec le monde qu’il habite, ce que l’on pourrait appeler un processus de socialisation. Là encore on pourrait déclarer que ce processus spécifique ne distingue en rien l’exercice que nous décrivons, puisque toute activité scolaire en groupe implique une dimension ou une autre de socialisation. D’autre part, on peut s’interroger sur le rapport entre cette socialisation et la philosophie. Proposons l’idée que la dramatisation accrue du rapport à l’autre, rapport qui est central au fonctionnement de notre exercice, permet de créer une situation où ce rapport devient un objet pour lui-même. Il est plusieurs angles sous lesquels nous pouvons expliquer cela. Premièrement les règles énoncées exigent pour chacun de se distinguer des autres. Deuxièmement, elles impliquent de connaître l’autre : savoir ce qu’il a dit. Troisièmement, elles impliquent d’entrer dans un dialogue, voire une confrontation avec l’autre. Quatrièmement, elles impliquent de pouvoir changer l’autre et de pouvoir être changé par lui. Cinquièmement, elles impliquent de verbaliser ces relations, d’ériger en partie de la discussion ce qui habituellement reste dans l’obscurité du non-dit ou à la rigueur se cantonne à la simple alternance entre réprimande et récompense. Il serait ici possible de comparer notre activité à celle du sport d’équipe, facteur important de socialisation chez l’enfant, qui aussi implique de connaître l’autre, de savoir ce qu’il fait, d’agir sur lui et de se confronter à lui. Ce type d’activité se distingue de l’activité intellectuelle classique, qui en général s’effectue seul, même lorsque l’on est en groupe. Tendance intellectuelle individualiste que l’école encourage naturellement, souvent sans que les enseignants en soient pleinement conscients, tendance qui tend à s’exacerber au fil des années, avec les nombreux problèmes que cela pose et posera, en amplifiant le côté “gagnant et perdant” de l’affaire. L’atelier que nous décrivons ici encourage au contraire la dimension du “penser ensemble”. Il tente d’introduire l’idée que l’on pense non pas contre l’autre ou pour se défendre de l’autre, parce qu’il nous effraie ou parce que nous sommes en concurrence avec lui, mais grâce à l’autre, au travers de l’autre. D’une part parce que la réflexion générale évolue au fur et à mesure des contributions des élèves à la discussion. L’enseignant devra d’ailleurs périodiquement, au cours de l’atelier, récapituler les diverses contributions importantes qui donnent cadre et forment à la discussion. D’autre part parce que l’on apprend à profiter de l’autre, en discutant avec lui, en changeant d’avis, en le faisant changer d’avis, plutôt que de se cramponner frileusement, quand ce n’est pas rageusement, à son frileux quant à soi. Là encore, le fait que les difficultés de prise en charge des problèmes posés par un camarade ou par l’enseignant fassent partie de la discussion, aide à dédramatiser la crispation individuelle et encourage l’enfant à raisonner plutôt qu’à avoir raison. Mentionnons au passage que ce genre de crainte, non traitée, engendre des difficultés majeures, de plus en plus visibles au cours des années d’école, sans parler des répercussions chez l’adulte. Si dès les premières années l’enfant s’habitue à penser en commun, il apprend à la fois à assumer une pensée singulière, à l’exprimer, à la mettre à l’épreuve de celle des autres, à profiter de la pensée des autres et à faire profiter les autres de la sienne. La dimension philosophique consiste donc à faire que l’enfant prenne conscience des processus de pensée individuels et collectifs, des obstacles épistémologiques qui réfrènent la pensée et son expression, en verbalisant ces freins et ces obstacles, en les érigeant en sujet de discussion. Un dernier argument en faveur de ce processus accru de socialisation de la pensée est que l’inégalité des chances entre les enfants apparaît très tôt, dès la maternelle, où il est visible que certains enfants n’ont pas du tout l’habitude de la discussion. Indépendamment de la relative facilité ou difficulté individuelle de discuter, l’enseignant s’aperçoit qu’il est des enfants qui ne sont pas fondamentalement surpris que l’on veuille discuter avec eux, alors que d’autres semblent ne pas comprendre du tout ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils sont invités à parler, comportements renvoyant sans doute au contexte familial. Pour ces raisons, la parole, qui devrait être source d’intégration et de socialisation, devient source de ségrégation et d’exclusion.
3 – Difficultés, critiques et commentaires
Il est difficile de distinguer difficultés de l’exercice et critiques de l’exercice, pour des raisons qui apparaîtront au cours de l’analyse. Commençons par la remarque suivante. Après diverses interventions en maternelle, ponctuelles ou régulières, deux constats s’imposent. Premièrement, la majorité des enseignants rencontrés ne s’intéressent pas tellement à ce genre de pratique, en tout cas pas suffisamment pour souhaiter en comprendre ou en observer au moins ponctuellement le fonctionnement. Ceci pour des raisons très diverses sur lesquelles nous ne spéculerons pas ici. Deuxièmement, la majorité des instituteurs ayant assisté à l’atelier ne souhaitent pas se risquer eux-mêmes à ce genre d’exercice. Non pas qu’ils ne considèrent pas utile, voire constructif ou nécessaire ce type de pratique, mais simplement parce qu’ils ne se sentent pas à même de la mener, ce que plusieurs avouent très naturellement. Ayant plus de données sur ce deuxième cas de figure, nous nous risquerons à une analyse. Les premières objections des enseignants, les plus formelles, portent sur les qualifications spécifiques de l’animateur qui démontre l’exercice, qu’ils déclarent différentes des leurs : “Nous ne sommes pas philosophes”. Ils expliquent cette différence de capacité par un problème de formation : “Nous n’avons pas été formés à cela”. Ou par un décalage de compétence : “Le philosophe est habitué à aller jusqu’au bout des choses, à creuser plus profondément”. “Je n’approfondirai pas : c’est le danger de notre métier”. “C’est votre seconde nature de répondre à des questions par des questions. Cette gymnastique vous est propre. Ce n’est pas le cas pour tout le monde.” “Vous trouvez du sens partout, je ne sais pas si j’y arriverai.” Un deuxième type d’argument porte sur la rupture, sur la contradiction entre le travail habituel de l’instituteur et ce type d’exercice, sur le changement dans le rapport entre enseignant et élève. “D’habitude je dois mettre ma casquette de gendarme et là je dois leur demander ce qu’ils pensent de ceci ou de cela”. “Il me semble difficile de faire ce que vous faites, car il n’ont pas le même comportement avec vous qu’avec moi. Vous insistez, et avec vous ils n’osent pas se plaindre.” “L’enseignant doit construire une discipline, qui exige un travail quotidien.” Or accepter que les élèves expriment librement ce qu’ils pensent sur des sujets sensibles est perçu comme une atteinte, au moins potentielle, à cette discipline. L’atelier exige un renversement que l’enseignant croit parfois dangereux ou inutile, ou encore qu’il ne se sent pas prêt à effectuer. Un troisième type d’argument, qui surprendra peut-être à la maternelle, est celui du temps, dans son rapport au programme scolaire. “Nous avons déjà beaucoup d’activités à mener à bien.” Ou encore, plus spécifiquement, les critiques portent sur la lenteur de l’exercice proposé. “Des fois ça n’avance pas, c’est trop lent”. L’enseignant n’entrevoit pas toujours l’exercice dans sa dimension de pratique ; il considère l’échange sous l’angle de la connaissance formelle : savoir ou ne pas savoir, plutôt que comme activité de réflexion, avec ses bégaiements, ses ratures et ses manques. Un quatrième type d’argument porte sur la difficulté que pose l’exercice aux enfants. “Certains enfants n’aiment pas cet exercice. Dès qu’on l’annonce en classe, ils se mettent à pleurer.” Signalons au passage que parfois les classes ont été scindées, sur la base d’une participation volontaire, ce qui en général représente une division approximative de moitié. Et même parmi les volontaires, il se trouve toujours certains enfants qui refusent de participer à la discussion. De plus, l’exercice est parfois laborieux, lorsqu’un groupe est à une occasion plus apathique, à une autre plus dissipée, l’humeur et la concentration restant très aléatoires, particulièrement en petite et moyenne section. “La discussion n’avance pas.” La tentation est alors pour l’enseignant de recourir à la méthode courte, la voie directe où il explique ex-cathedra et donne lui-même les réponses. Que ce soit parce qu’il a l’impression que les enfants connaissent la réponse et ne la disent pas, ou parce qu’il pense qu’il est impossible pour eux de répondre. L’embarras de l’élève gêne quelque peu l’enseignant, qui de temps à autre ne pourra pas s’empêcher d’intervenir : “C’était trop pénible. J’ai voulu venir en aide à mon élève.” “Si c’était moi, je risquerais de donner la solution.” Un soupçon pèse ici: celui du facteur traumatisant de l’exercice. Ce même soupçon qui portera l’enseignant à éviter par exemple les contes avec une certaine portée dramatique et existentielle, pour favoriser le “gentillet”, alors que les premiers portent plus naturellement à la réflexion que les seconds. Un cinquième type d’objection est celui de la vérité : que fait-on du critère du vrai et du faux ? Cette objection recoupe la première : celle du “changement de casquette”. Car l’enseignant peut se sentir floué par le relativisme au moins apparent qui s’installe dans de telles discussions : que faire de réponses fausses qui perdurent au travers de la discussion, par un effet de mimétisme ou de psittacisme, fréquent chez les petits ? L’imagination débordante ou le désir de faire le pitre peut l’emporter facilement sur la mémoire et le souci de véracité. Ainsi lors de la discussion à propos d’un film ou d’une histoire, lorsqu’un enfant raconte un passage ou importe un personnage qui n’a rien à voir avec le sujet traité, et que d’autres, amusés, continuent sur la lancée. Mais c’est précisément là que l’animateur doit jouer son rôle, et au travers de ses multiples questions inviter les élèves à distinguer l’imagination et le raisonnement, la mémoire et l’envie de s’amuser. C’est là que se trouve l’enjeu de l’exercice, et non pas dans l’obtention d’une bonne réponse. Or la prise de conscience passe par l’articulation de l’erreur, une erreur qu’il s’agit de ne pas craindre car elle est porteuse de sens. L’erreur est productive car elle manifeste les difficultés de l’élève et montre son fonctionnement, ce qui permet à l’enseignant d’évaluer mieux la situation. D’autre part elle laisse une marge de manœuvre à l’autonomie de l’élève, considération trop souvent oubliée, aux conséquences ultérieures dramatiques. Il n’est qu’à observer comment bon nombre d’élèves de lycée ne se posent plus la question de leur rapport à la matière enseignée, ayant gommé la part de subjectivité dans l’apprentissage. Sixième objection, reliée à la précédente : celle des principes à inculquer, le dilemme de la morale imposée. Que faire lorsqu’un jugement ou une idée qui nous paraît inadmissible emporte clairement le soutien de la majorité des élèves ? Problème d’autant plus crucial que les premières années d’école constituent justement le moment et le lieu où se posent les premières bases de l’éducation et de la vie en société. Que faire lorsqu’une opinion sur un sujet donné s’installe, contraire aux principes que l’enseignant essaie d’inculquer ? Prenons comme exemple le cas d’une discussion sur le fait de rapporter ou pas les mauvaises actions des autres. Après quelques avis contradictoires, les enfants semblent se rallier au moins temporairement à l’idée qu’il ne faut pas rapporter. Commentaire de l’enseignant “J’avais vraiment envie de bondir. Si vous n’aviez pas été là je l’aurais fait. Vous vous rendez compte des conséquences dans la cour de l’école, avec ce qui s’y passe !”. Le problème est ici de savoir si la morale s’impose ou si elle doit se fonder en raison, avec le côté aléatoire de celle-ci. Certes certains principes ou règlements peuvent être considérés non négociables. Mais il ne faut pas occulter le danger du double discours : le discours de la classe, destiné à faire plaisir aux autorités, superposé artificiellement à celui de l’extérieur, plus sincère mais inavouable. Ce hiatus, tout à fait courant, pose de nombreux problèmes, tant sur le plan social qu’intellectuel. Solution de facilité qui privilégie l’immédiat au détriment de l’éducation à long terme. Ne serait-ce que parce que le rapport à l’autorité s’installe comme un rapport factice et mensonger. Pourtant, ce type d’atelier n’exclut pas la parole du maître. D’une part parce qu’il questionne, ce qui n’est pas dénué d’importance. D’autre part, rien n’empêche en un deuxième temps de revenir sur la discussion et de traiter en profondeur et en connaissance de cause les arguments invoqués par les élèves.
4 – Comparaison des sections
L’école maternelle regroupe trois âges dont les fonctionnements diffèrent de manière importante. Il est clair qu’entre les trois sections nous ne sommes plus dans les mêmes cas de figure. Dans notre expérience en petite section, il s’est avéré pratiquement impossible d’installer des discussions avec une classe entière ou même en demi-classe. Les élèves ne se sentent pas directement concernés, n’osent pas répondre, ou disent la première chose qui leur traverse la tête, ce que les voisins s’empressent de reprendre en chœur. Toutefois, un exercice plus poussé de discussion sera réalisable et trouvera son sens en petits groupes de trois ou quatre élèves, avec bien entendu les restrictions pratiques que cela pose. Une discussion relativement argumentée peut dès lors s’installer, où les élèves s’écoutent et se répondent. Néanmoins, étude que nous n’avons pas eu le temps de mener à bien, il est possible que seule une minorité puisse à cet age mener d’emblée ce genre d’activité. Or c’est sans doute sur cette disparité à la base qu’il s’agirait de travailler. Cependant, si l’on veut mener à bien des exercices en groupes plus nombreux, il en est un qui fonctionne à peu près. Il consiste à choisir au travers du groupe le sujet à débattre (un mot), le personnage préféré d’un film ou d’une histoire, etc. Les enfants font eux-mêmes des propositions, argumentent plus ou moins, et le tout se termine par un vote. La notion de carabistouille, mot qui amuse beaucoup les enfants, s’est avérée intéressante. Elle qualifie une réponse dépourvue de sens, une incohérence, toute parole dont la légitimité est mise en question. La menace permanente de carabistouille invite l’enfant à émettre un jugement sur ses propres propos et celui des autres, en allégeant toutefois la portée du jugement. En moyenne section, le problème du fonctionnement de groupe se pose déjà nettement moins, néanmoins le demi-groupe s’impose (une douzaine d’élèves). Les règles de base fonctionnent assez bien : demander la parole en levant le doigt et attendre son tour, répondre aux questions de manière appropriée, émettre des hypothèses et des jugements, se souvenir de la parole des autres et y répondre, etc. Toutefois, certaines séquences restent totalement improductives car l’humeur n’y est pas, par passivité ou par dissipation, situations où il semble très difficile de redresser la barre. D’autre part, une proportion encore conséquente d’élèves se refusent à parler ou ne tentent pas de répondre aux questions. Peut-être faudrait-il les prendre à part, séparés de ceux qui manient déjà assez bien l’exercice. En grande section, il semble adéquat d’affirmer que tout élève devrait pouvoir participer à la discussion, bien que la demi-classe semble encore s’imposer. Toutefois certains éléments se démarquent très nettement par la qualité de leurs interventions. L’idée du “pourquoi ?” et de l’argumentation, indispensable à l’exercice, est globalement bien intégrée. Les élèves comprennent en gros leurs arguments mutuels et se rappellent à peu près de qui a dit quoi. Il est assez enthousiasmant d’observer le fonctionnement d’un groupe d’enfants de cet âge qui pendant quarante-cinq minutes débattent d’un sujet donné, s’écoutent et se répondent tout en acceptant d’admettre que l’autre a peut-être raison. Bien des adultes pourraient profiter d’un tel spectacle.
5 – Les parents
Les parents expriment des réactions assez diverses face à un tel projet. Certains d’entre eux n’apprécient pas tellement l’idée car ils partent du principe que l’enfant est un enfant, qu’il est donc trop petit pour être impliqué dans ce genre de pratique. D’autres sont carrément méfiants. Leur inquiétude est en partie liée à la crainte de ce que l’enfant pourra dire, car on le fera parler sur des sujets “personnels” : que dira-t-il de ses parents ? D’autres, plutôt enthousiastes, sont très demandeurs de retours sur le comportement de leur enfant dans ces discussions. D’autant plus que certains voient dans cet exercice une possibilité d’évaluation, ce dont ils se plaignent de manquer. Quant aux effets rapportés par eux, ils sont assez éclairants. Certains enfants ont parlés de l’atelier à la maison, d’autres non. Mais quoi qu’il en soit, il semblerait que l’installation du questionnement systématique soit un acquis assez important. Plusieurs parents mentionnent l’accentuation très nette de l’utilisation du “pourquoi ?” dans le discours de l’enfant, et le désir de discussion. “Maintenant, chaque fois que nous allons au cinéma, j’ai le droit à des commentaires en sortant.” “À table, de temps à autre il lève son doigt et dit que c’est à lui de parler.” “J’ai dit à la maîtresse que depuis qu’il fait cet atelier il semble vouloir raisonner sur toutes sortes de choses.” Disons quand même afin de tempérer l’analyse, que ce petit sondage a été effectué auprès des parents dont l’enfant participait assez activement à l’atelier. Afin d’être plus rigoureux, il aurait fallu effectuer une analyse plus conséquente, ce qui n’a guère été possible jusqu’ici pour diverses raisons, mais serait souhaitable.
6 – Trop tôt et trop tard
Au-delà de savoir si ce type exercice est utile ou pas, il est vrai que l’on peut se demander si l’enseignant est à même d’effectuer le basculement en question dans sa propre classe. Cela pose un véritable problème, en maternelle comme en d’autres classes. En général, traditionnellement, lorsque l’enseignant utilise le questionnement comme outil de travail, il est clair pour les élèves que l’on veut arriver à la “bonne réponse”, avec l’implication que toute mauvaise réponse sera d’une manière ou d’une autre sanctionnée. Comment arriver soudain à installer une situation ouverte ? Est-ce souhaitable ? Peut-on passer naturellement d’un rôle en plein à un rôle en creux ? Faudrait-il systématiquement faire appel à un intervenant extérieur ? Ce sont des questions sur lesquelles, au-delà de nos convictions propres, à ce point il nous paraît ardu de trancher. D’autre part peut-on toujours demander à des enfants d’effectuer des choix, et surtout d’en rendre compte, en exigeant des raisons, des explications, un langage plus précis, en insistant lourdement sur certains mots utilisés, en entrant dans le détail de ses réponses, en analysant le sens et la structure de ce que chacun énonce ? Peut-on aussi demander à un enfant de cet âge de parler en attendant son tour, avec la frustration que cela implique, au risque de ne plus se rappeler ce qu’il avait à dire ? Ne risque-t-on pas au travers de ces exigences formelles d’inhiber la parole de tous ceux qui ont déjà du mal à s’exprimer? N’est-ce pas un peu tôt pour “obliger” des enfants à élaborer la parole plutôt que d’exprimer un discours plus intuitif ? Un travail sur la conscience et la rationalité n’est-il pas prématuré en maternelle ? Il est vrai que dès cet âge de grandes disparités sont observables. Disparités encore plus saisissantes en maternelle que plus tard en Terminale par exemple, où une sélection partielle a déjà été effectuée. Car s’il est des enfants pour qui discuter avec un adulte, réfléchir et exprimer ses propres idées sont des actes qui semblent aller de soi, il en est d’autres pour qui un tel échange pose un véritable problème. Que ce soit pour des raisons d’ordre psychologique, telles que la timidité, ou pour des raisons plutôt intellectuelles, il semble parfois impossible d’engager le dialogue. Certains enfants paraissent ne pas entrevoir du tout ce que l’on attend d’eux lorsqu’on les interroge. N’est-ce pas déjà là qu’il s’agit d’intervenir ? Autant de questions que soulève l’exercice que nous proposons. Toutefois, n’ignorons pas que le questionnement n’est pas neutre : il est nécessairement source de conflits. Platon relate que Socrate, l’insatiable questionneur, fut exécuté sous prétexte qu’il pervertissait la jeunesse et introduisait de nouveaux dieux. Cela est compréhensible, dans la mesure où toute société se fonde et s’organise sur une bonne part d’arbitraire, un arbitraire de refus de repenser lui-même : il a trop à perdre. Questionner, c’est défier ; questionner, c’est provoquer. Pourtant, les textes pédagogiques officiels, sans aborder le sujet de la philosophie à la maternelle ou au primaire, prônent les situations ouvertes où l’élève doit être amené à s’exprimer. (Notons toutefois que la Belgique ou le Brésil tendent à systématiser la philosophie à l’école primaire.) Mais qu’est-ce qui empêche souvent que ces directives soient mises en œuvre ? Rien d’autre sans doute que nos propres habitudes. La question est donc : quand, où et à quel âge faudrait-il commencer à oser penser par soi-même, à oser parler pour soi-même, à oser parler aux autres ? A quel âge est-il trop tard ? Là est l’enjeu de notre affaire.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.Ok
Analyse d’ateliers
/par ced95vinLe mur
Сommentaires, analyses, critiques et d’autres retours
Les problèmes de l’argumentation philosophique
L’argumentation philosophique
Par : Oscar Brenifier & Isabelle Millon
I/ Evaluer les arguments
Qu’est-ce qu’un argument ?
C’est un raisonnement, un fait ou un exemple destiné à prouver ou justifier une affirmation ou une proposition quelconque. Il doit répondre à une problématique précise et être opératoire. Il faut ici distinguer l’argumentation rhétorique et l’argumentation philosophique : l’argument rhétorique a pour vocation de convaincre et persuader, y compris lorsqu’il prétend démontrer, alors que l’argument philosophique, même lorsqu’il prétend justifier une proposition, a principalement pour vocation d’approfondir, de mettre au jour la pensée. L’argument philosophique convoque un ou des concepts susceptibles de rendre compte de la nature d’une idée ou d’un jugement, de sa légitimité, de son fondement ; en ce sens, il doit établir du lien et clarifier un contenu, permettant à la pensée de se construire et s’élaborer.
Dans l’argumentation philosophie, la finalité est principalement de rendre consciente une pensée particulière : d’articuler ses concepts, son axiologie, sa démarche intellectuelle, sa genèse, de rendre visibles ses présupposés, etc. Pour ce faire, la clarté semble le critère premier, ce qui implique l’explicitation et la cohérence. Bien que périodiquement, le problème se posera de déterminer ce que l’on peut accepter comme donnée implicite, ou de dénoncer ce qui manque et devrait être explicité. Il n’est pas toujours facile de faire dire ce qu’elle dit à une idée, tout en évitant la surinterprétation. En ce sens, la capacité critique est nécessaire à l’argumentation, comme outil d’évaluation de l’argument. Le terme « critique » est repris ici dans son sens original : celui de séparer, de discriminer. Il ne s’agit donc pas de toujours trouver quelque chose à redire – ce n’est pas avoir l’esprit de contradiction – mais de savoir distinguer. Pour examiner l’argumentation, nos nous référons principalement au principe de critique interne, selon Hegel. Ce n’est pas la critique externe qui nous intéresse ici, où l’on propose de remplacer certains concepts par d’autres qui nous semblent meilleurs, moralement ou épistémologiquement. La critique interne consiste à évaluer la clarté et la cohérence, la pertinence, la force ou la faiblesse des conclusions et des arguments, de distinguer les concepts entre eux, les formes entre elles, etc… La valeur des arguments ne nous intéresse donc pas en terme de leur vérité intrinsèque, mais uniquement dans le rapport de cohérence qu’ils entretiennent avec la question et la réponse qu’ils doivent appuyer. Quand bien même a réponse sera considérée uniquement comme provisoire, elle exprimera tout de même le mode de penser qui l’a produite. Finalement, nous devons ajouter aussi le critère de la non répétition : bien souvent, au cours d’une discussion ou d’un écrit, les idées se répètent, directement ou par le biais d’une reformulation, ce qui tend à entraîner une certaine confusion. Il s’agit donc de repérer toute répétition à l’identique afin d’assurer la production de nouveaux concepts et hypothèses.
Quels que soient les divers critères d’évaluation d’arguments que nous proposons dans cet article, il ne sera pas toujours évident de déterminer la validité ou non des arguments rencontrés. Il s’agira toujours de produire un jugement singulier, parfois rapide, parfois hésitant, car la ligne rouge entre un argument acceptable ou non n’est pas clairement défini. Nous en prenons pour preuve les arguments faibles, qui à la fois son des arguments sans l’être : ils le sont par degré, et il ne sera pas toujours facile de trancher entre l’acceptation et le refus. Après analyse, ce jugement renverra toujours à des présupposés qui pourront être considérés contestables, et à l’expression d’une subjectivité. Le travail d’interprétation et d’évaluation de l’interprétation sera inévitable, et posera problème. C’est là que le travail de groupe s’avèrera utile, afin d’envisager les diverses possibilités de réception du problème, à travers l’élaboration de différentes matrices conceptuelles. La question restera de savoir dans quelle mesure une position devra s’imposer ou non, dans quelle mesure une interprétation aura plus de valeur qu’une autre, ou s’il s’agira tout simplement de les renvoyer dos-à-dos.
Nous devons néanmoins admettre aussi un choix pédagogique et épistémologique qui a été le nôtre : celui d’inclure le travail de la réponse – ou de la conclusion – dans celui de l’argumentation. Expliquons-nous. En général, une idée ne surgit pas seule : elle survient en réponse à un problème, qui se pose à l’auteur de l’idée ou à une tierce personne. S’il est besoin d’argumenter, c’est que nous pensons que notre idée ne va pas de soi, sans quoi nous n’éprouverions guère le besoin d’argumenter. En général, une argumentation est composée d’une conclusion et d’éléments de preuve que l’on nomme arguments. il peut y avoir un ou plusieurs arguments qui constituent les raisons d’accepter la conclusion qui a été énoncée. Aussi, afin d’inclure le problème de l’argument dans son cadre, pour en simplifier et en clarifier le fonctionnement, nous avons opté pour la structure générale suivante : une question, ce qui pose problème, une réponse, ce qui conclut ou positionne, et l’argument, ce qui soutient le positionnement ou la conclusion. Il nous semble donc que tout argument s’inscrit nécessairement dans un contexte réductible à une telle forme : question, réponse, argument. Bien entendu, le couple « réponse et argument » n’a pas nécessairement valeur de certitude, contrairement à une opinion répandue.
La nécessité de ce deux éléments pour constituer une « véritable réponse » implique les deux postulats philosophiques suivants. Premièrement, un positionnement n’est pas en soi une réponse adéquate, car nous ignorons quel est son sens, quel est son origine, aussi ce positionnement a-t-il besoin d’un argument pour lui fournir de la substance. Deuxièmement, un argument qui n’est pas précédé d’un positionnement ne peut pas avoir de sens en tant qu’argument : puisqu’un argument doit soutenir une position, cette dernière se doit d’être déterminée, claire et précise. Ce choix de présupposé que nous avons élu pourra paraître téméraire ou biaisé en un premier temps, mais le lecteur s’apercevra que bien que réducteur, il reste assez opératoire. Car si les réponses non argumentées sont monnaie courante au quotidien, les argumentations sans positionnement le sont tout autant, qui se cachent généralement dans la confusion du discours prolifique. À quoi servirait d’argumenter si nous ne soutenions rien ? Il s’agirait sans doute d’explications, mais pas d’argumentation, erreur tout à fait courante au demeurant. L’argument a des exigences que l’explication ignore.
Si l’on désire établir une grille simple d’évaluation des réponses et arguments, nous proposons les critères suivants :
1 – Clarté de la réponse
2 – Pertinence de la réponse
3 – Existence d’un argument
4 – Pertinence de l’Argument
5 – Force ou faiblesse de l’argumentation
6 – Pluralité ou répétition des idées. (En cas de pluralité des réponses et des arguments)
C’est dans le but de ce travail critique que nous avons tenté de mettre au jour différents types d’erreur argumentative. Pour cela, il est nécessaire d’expliciter la nature de l’argument et d’exposer sa pluralité de forme. Pour cela, rappelons-nous d’abord que l’argumentation est censée adresser des problèmes, afin de les approfondir, de les clarifier, de les traiter, voire de les résoudre. Elle produira donc des concepts, non pas pour les définir mais pour les rendre opérationnels.
Un argument peut être un fait établi ou une démonstration logique, il peut être de forme subjective ou objective : le premier relèvera plutôt de choix personnels, le second aura certaines prétentions à déterminer la réalité. Néanmoins, l’argument n’ayant pas à relever d’une quelconque certitude, il peut être une supposition ou une spéculation, voir un espoir ou une crainte qui sert de motivation, voire une condition. Bien entendu, l’intérêt ou la force de l’argument variera selon la fiabilité et la nature de son contenu,
Les arguments peuvent être de types très divers : moral, pratique, psychologique, intellectuel, logique, factuel, etc.
Voici quelques brefs exemples de ces divers cas de figure.
(Ces arguments sont parfois incomplets car ils servent uniquement à montrer le registre argumentatif.)
Question : Devrais-tu entre entreprendre cette action ?
Argument moral : Non, parce qu’il n’est pas moral d’agir sans se soucier du bien-être de la société.
Argument pratique : Non, je devrais m’entraîner trop longtemps pour la réussir.
Argument psychologique : Non, car je n’en ai pas du tout envie.
Argument intellectuel : Non, car il est prioritaire de se consacrer à la recherche.
Argument logique : Non, car une telle action est dépourvue de sens.
Argument factuel : Non, car jamais personne n’a réussi à mener à bien une telle action.
Dans les formes d’argumentation, on peut utiliser soit l’intention d’une proposition, soit les conséquences de cette proposition, soit des concepts abstraits, soit des exemples, soit encore des principes généraux. Ceci ne prétend pas épuiser l’étendue des formes : il s’agit seulement d’en montrer la pluralité.
Voici quelques exemples brefs de ces divers cas de figure.
(Ces arguments sont parfois incomplets car ils servent uniquement à montrer le registre argumentatif.)
Question : Devrais-tu entre entreprendre cette action ?
Argument portant sur l’intention : Oui, car le but de cette action est très noble.
Argument portant sur les conséquences : Oui, car une telle action améliorera la manière de fonctionner du groupe.
Argument utilisant des concepts abstraits : Oui, car cette action implique de la générosité.
Argument utilisant des exemples : Oui, car on observe la nécessité de cette action dans le domaine politique.
Argument portant sur des principes généraux : Oui, car tout ce qui peut faire bouger les choses est bien en soi.
Autre point posant problème dans la structure d’un argument : les connecteurs. Comme nous l’avons proposé ci-dessus, l’existence d’un argument doit s’inscrire dans la forme générale : problème, positionnement, argument. De manière générale, le lien entre le positionnement et l’argument, entre la réponse proprement dit et l’argument, s’établit par un connecteur. Le plus courant est « parce que », ou bien « car ». Ils indiquent tous deux un lien logique de causalité, puisque l’argument entraîne théoriquement le positionnement qu’il vient soutenir. La forme générale reste « c’est à cause de ceci » que « cela se passe ». Néanmoins, d’autres formes structurelles sont possibles dans la la mesure où elles sont réductibles à celle que nous venons d’énoncer. Par exemple l’inversion syntaxique : argument puis positionnement, qui sera introduite par exemple par le terme « comme ». D’autres connecteurs sont possibles, qui implicitement peuvent exprimer le « parce que » : la virgule en est un exemple, il en est d’autres, parfois un peu alambiqués, qu’il s’agira de décrypter pour clarifier l’énoncé. Le « sinon » en est un cas intéressant : il utilise l’évitement ou la négation comme outil d’argumentation : la raison d’être d’une idée ou d’un acte est la menace de ce qui se passerait si cette idée ou cet acte n’était pas mis en place.
Néanmoins, une mention particulière doit être effectuée à propos d’un argument qui pose régulièrement problème : l’argument conditionnel. On le reconnaîtra par exemple à l’utilisation des connecteurs suivants : « quand », « lorsque », « à condition », « dès lors que », « si », etc. Il est hypothétique et non pas catégorique. C’est un argument qui est valide dans certaines circonstances, uniquement dans certain cas, ce qui ne le prive guère de son statut d’argument, puisqu’il vient soutenir une position, aussi conditionnée et hypothétique soit-elle. La condition participe de la cause de la décision, ou détermine la cause de la décision.
Exemple : Est-ce bien ou mal pour un enfant de désobéir aux adultes ?
C’est bien lorsque c’est un ordre qui est contraire à la morale ou à la raison.
L’argumentation donne à la fois le cadre ou la condition du « pourquoi c’est bien de désobéir », et ce cadre/condition coïncide avec la raison de désobéir.
Bien entendu, la condition énoncée dans l’argument se devra de respecter les données du problèmes, afin de ne pas devenir un argument contradictoire. De la même manière, il devra autant que faire se peut ne pas être trop exceptionnel ou extraordinaire, afin de ne pas devenir un argument faible ou une hypothèse gratuite. L’argument de « l’homme totalement seul sur une île déserte », est le grand classique de ce type d’argument ou de condition : personne n’a jamais rencontré cet individu, à part dans son imagination. Même Robinson Crusoë a rencontré Vendredi…
II/ Les erreurs d’argumentation
Dans cet article, nous avons tenté de recenser les erreurs courantes d’argumentation philosophique. Les catégories que nous avons identifiées ne sont pas produites pour séparer radicalement les différents types de propositions irrecevables ou fragiles afin de les classer formellement, mais uniquement pour aider à percevoir les types de problème rencontrés dans l’argumentation et à les comprendre. Ceci implique qu’une même erreur peut parfois recouper deux ou trois catégories différentes, l’important pour le lecteur étant d’apprendre à reconnaître ces divers problèmes. Le but n’est donc pas d’apprendre à classifier les problèmes, la classification est uniquement un outil de compréhension, et de développement de la pensée.
1) Absence d’argument
2) Argument non pertinent
3) Argument indifférencié
4) Argument incomplet
5) Argument contradictoire
6) Glissement de sens
7) Faux argument
8) Tautologie
9) Rejet du problème
10) Argument interrogatif
11) Indétermination du relatif
12) Argument de conviction
13) Argument illogique
14) Fausse évidence
15) Argument faible
1) ABSENCE D’ARGUMENT
Proposition qui n’est appuyée par aucun concept complémentaire qui viendrait la soutenir. Lorsqu’il s’agit d’une réponse à une question, la réponse contient uniquement les termes de la question ou bien une reformulation de cette dernière.
Exemple : Le professeur dit qu’il ne faut pas couper la parole aux autres, mais elle coupe souvent la parole aux élèves. A-t-elle plus le droit que nous de couper la parole ?
— Non, car si nous n’avons pas le droit, elle non plus.
La formulation reprend uniquement les éléments de la question : aucun concept n’est fourni qui justifierait l’absence de droit particulier du professeur. L’argument exprime une égalité implicite, mais non articulée ni justifiée.
Exemple acceptable : Le professeur dit qu’il ne faut pas couper la parole aux autres, mais elle coupe souvent la parole aux élèves. A-t-elle plus le droit que nous de couper la parole ?
— Non, car les adultes n’ont pas tous les droits : si le professeur enseigne quelque chose, il doit déjà nous montrer l’exemple.
L’argument est acceptable car l’absence de droit absolu du professeur est justifié par un principe pédagogique : « il faut montrer l’exemple ».
Exemple : Dois-je aider une personne qui ne veut pas que je l’aide ?
— Non, car je n’aide pas les personnes qui ne veulent pas de mon aide.
La formulation reprend uniquement les éléments de la question : aucun concept n’est fourni.
Exemple : Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour ne pas blesser.
— Non. Ce n’est pas une bonne raison car même si cela blesse, il faut toujours dire la vérité.
Le connecteur « même si », qui indique l’opposition concessive, sert à montrer la radicalité de la proposition sans fournir d’argument ; on pourrait dire qu’il représente uniquement un effet rhétorique : il insiste pour renforcer l’affirmation, mais ne fournit aucun concept.
2) ARGUMENT NON PERTINENT
C’est un argument qui utilise des concepts qui ne relèvent pas du tout de la proposition énoncée. On ne voit pas le rapport entre l’argument et l’idée qu’il vient soutenir.
Exemple :
Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? La loi nous y oblige.
— Non, car si on me disait qu’il faut que je parte loin d’ici à 18 ans, je ne le ferais pas.
Il s’agit de « croire » et non pas de « faire ». Ce sont deux problèmes différents. L’argument n’adresse donc pas le problème soulevé. De plus, l’exemple répond , mais il n’argumente pas.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? La loi nous y oblige.
— Oui, si on a l’intention de respecter la loi. Non, si la loi nous oblige à une absurdité.
L’argument du oui » n’est pas pertinent, car il s’agit de » respect », ce qui n’a rien à voir avec « croire ». Mais l’argument du « non » est pertinent, car l’absurdité est en effet une raison de ne pas croire, de ne pas adhérer à une loi. Néanmoins, il aurait été utile d’expliciter le problème.
Exemple :
Je n’ai pas le droit de sortir toute seule. Est-ce juste ou injuste ?
C’est juste, car mes parents sont plus prudents que moi.
Le fait que « mes parents soient plus prudents que moi » ne prouve pas pourquoi il est juste que « je ne sorte pas seule » : sans quoi, toute personne devrait sortir avec quelqu’un de plus prudent. Ou alors, il faudrait expliciter en quoi « mon imprudence » nécessite la présence de « mes parents ».
Exemple acceptable : C’est juste, car je suis jeune, et donc plus vulnérable aux dangers extérieurs, et un enfant fait moins attention qu’un adulte.
L’argument est pertinent car il adresse le problème de l’injustice en expliquant que la jeunesse est « plus vulnérable » par ce qu’elle « fait moins attention ».
Exemple : On t’offre une bague qui te rend invisible. Tu es au magasin. En profites-tu pour prendre ce qui te plaît ?
Je préfère surveiller le magasin que prendre ce qui me plaît.
Le désir de surveiller le magasin ne vient en rien justifier le fait que je ne prenne pas ce qui me plait. Car je pourrais faire les deux à la fois : surveiller et voler.
Exemple acceptable : Non, parce que si je prends ce que je veux, je vole. Et je ne dois pas profiter de ma situation pour enfreindre la loi.
L’argument est pertinent parce qu’il qualifie le geste : c’est du « vol », et explique que ce geste signifie « enfreindre la loi ».
Quelques types d’arguments non pertinents courants
Argument émotionnel
Exemple :
Je ne veux pas mettre cette robe ? Je la mets tout le temps !
— Il y a des enfants qui n’ont aucun vêtement à se mettre, et qui seraient bien contents d’avoir cette robe.
Le fait que « des enfants n’aient pas de vêtements » ne justifie en rien qu’il faille mettre cette robe. Ou alors il faudrait expliquer le lien, par exemple celui de l’humilité : « Savoir que certains enfants n’ont rien à se mettre devrait t’inviter à être plus humble et moins soucieuse de ton apparence ». Sans cela, il s’agit uniquement d’un recours à la pression émotionnelle.
Argument du « un prêté pour un rendu »
Exemple :
Sors de la salle de bains ! Il faut que je parte au collège ! Je vais être en retard.
Dis donc, toi tu prends tout ton temps quand tu te pomponnes !
Le fait qu’une personne fasse une erreur ou commette une faute ne justifie pas en soi l’erreur ou la faute d’une autre personne.
Inversion causale
Exemple :
Pourquoi as-tu frappé ton frère ?
Parce qu’après, lui aussi il m’a frappé.
La conséquence imprévisible d’un geste ne peut pas justifier ce geste, sauf si cette conséquence était voulue. Au moment où il a frappé son frère, il ne savait pas que celui-ci allait le frapper : ce retour des choses n’était pas le but de l’acte. Cette erreur peut aussi être considérée comme un argument incohérent.
3) ARGUMENT INDIFFÉRENCIÉ
Argument utilisé pour justifier un choix dans une alternative (oui ou non, a ou b), qui pourrait néanmoins être utilisé de manière équivalente pour justifier la proposition opposée. Il n’est pas opératoire, puisqu’il peut être utilisé indifféremment dans un sens ou dans un autre.
Exemple :
En cas de danger extrême, en priorité, te sauves-tu toi-même ou sauves-tu quelqu’un d’autre ?
Quelqu’un d’autre car je n’ai pas le temps de penser et j’agis sans penser.
Le fait d’agir sans penser pourrait en soi tout aussi bien justifier le fait de « se sauver soi-même en priorité ». Ou alors il faudrait expliquer par exemple que l’altruisme est la réaction la plus immédiate en l’être humain.
Exemple : Est-il souhaitable ou non souhaitable d’aller à l’école ?
— Il est souhaitable d’aller à l’école pour se faire respecter.
On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas se faire respecter justement en n’allant pas à l’école. Ou alors il s’agit là d’une prise de position qui mériterait d’être explicitée, par exemple : « Celui qui va à l’école mérite le respect, car il apprend à travailler, au lieu de traîner dans la rue et de ne rien apprendre ».
Exemple : Est-on obligé de dire la vérité lorsque l’on a faim ?
— Non, car la personne aura pitié de nous.
Pourquoi la personne aurait pitié de nous si on lui dit que l’on a faim ? On peut imaginer qu’en exprimant sa faim, on fera « pitié », mais alors il faudrait expliquer pourquoi cette « pitié » empêche de dire la vérité. Sans quoi on pourrait aussi penser que la « pitié » joue au contraire en notre faveur.
4) ARGUMENT INCOMPLET
Argument dont l’énoncé va dans le sens d’une justification mais qui s’interrompt avant que l’énoncé soit complété. La fin de l’argument est implicite, on peut entrevoir son aboutissement, mais on ne peut pas le considérer comme achevé, car trop allusif, non articulé, ou en manque de clarification. Généralement, un concept supplémentaire serait nécessaire pour terminer la justification.
Exemple : Est-on obligé de dire la vérité lorsque la personne à qui l’on parle est malade ?
— Non, car cela peut la blesser et lui faire de la peine.
L’énoncé constitue l’ébauche d’un argument, mais reste trop général : on peut affirmer cette possibilité dans n’importe quelles circonstances. L’argument n’adresse pas précisément le problème. Il faudrait par exemple ajouter que la personne est fragilisée ou plus sensible à cause de la maladie.
Exemple : Est-on obligé de dire la vérité lorsque l’on risque d’être frappé ?
— Non, car les conséquences seront graves.
Il faut préciser de quelles conséquences il s’agit, quand bien même elles sont « graves ». Sans l’explicitation de leur gravité, l’argument est incomplet, même si l’on reprend les termes de la question, « le risque d’être frappé». Par exemple : « avoir très mal et être blessé ».
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? J’ai bien réfléchi.
— Non, car même si j’ai réfléchi ça peut être faux.
Il faudrait préciser en quoi ça peut être faux, sans quoi la possibilité semble trop gratuite ; par exemple : on peut avoir oublié des informations importantes.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? C’est écrit dans les livres.
— Oui, si c’est dans des livres scientifiques.
La condition donnée est celle d’une catégorie d’ouvrages. Pour que l’argument soit complet, il faudrait expliquer en quoi le « scientifique » est plus fiable ; par exemple : c’est prouvé par des expériences.
Exemple : Faut-il toujours obéir aux parents ?
— Il faut obéir aux parents, parce que sinon on ferait n’importe quoi.
Qu’est-ce qui autorise à dire que l’on ferait n’importe quoi ? En quoi consiste ce n’importe quoi ? Ces éléments manquent à l’établissement d’un argument complet.
Exemple : J’ai vu mon pire ennemi voler l’argent de mon meilleur ami. Je sais qu’il a déjà reçu des avertissements, et que si je rapporte ce qu’il a fait, il sera renvoyé de l’école. Dois-je le dénoncer ?
— Oui, car c’est pas parce qu’il va être renvoyé de l’école que je ne le dis pas, ça pourra peut-être lui servir de leçon.
L’argument est acceptable, mais mériterait d’être explicité un peu : en quoi consisterait la leçon ? Par exemple pour apprendre à ne plus voler. On peut néanmoins considérer que c’est implicite.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? La loi nous y oblige.
— Non, les lois n’ont pas le droit de nous forcer à y croire.
On ne comprend pas en quoi consiste ce « droit de nous forcer à y croire ». À nouveau, le lecteur peut imaginer diverses possibilités, mais cela n’est bien entendu pas suffisant : l’auteur doit expliciter sa pensée, par exemple en expliquant pourquoi les lois n’ont pas ce droit. Exemple : « Les lois peuvent nous obliger à faire quelque chose, mais elle n’ont pas le pouvoir de nous faire changer notre manière de penser ».
Exemple : Est-ce bien ou mal de ne rien dire ?
— C’est mal car ça dérange des personnes.
On ne sait pas en quoi le fait de « ne rien dire » dérangerait, ni en quoi ce dérangement serait « mal ».
5) ARGUMENT CONTRADICTOIRE
Argument dont les éléments utilisés ou invoqués sont contradictoires. Certains éléments viennent soutenir la proposition initiale, d’autres au contraire l’infirment. La forme la plus courante de l’argument contradictoire est le classique « oui, mais » : dans ce cas de figure, rien ne vient étayer le « oui », alors que l’argumentation du « mais » vient infirmer la réponse affirmative initiale.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? C’est écrit dans les livres.
— Oui, ceux qui écrivent dans les livres sont des personnes cultivées
qui n’ont pas le droit d’écrire des contrevérités, sauf dans les romans ou les BD.
On répond par « oui » mais on explique aussi « pourquoi non », en l’introduisant pas le « sauf ». C’est le problème du « oui, mais » : on ne sait pas quel est le statut de cette exception, ni quel est son rapport à la réponse initiale. L’exception des « romans et BD » ne représente-t-elle pas une immense catégorie qui remet en cause la réponse initiale ?
Exemple : Je n’ai pas le droit de sortir toute seule. Est-ce juste ou injuste ?
— C’est injuste car on a grandi, on peut sortir tout seul maintenant.
Mais pour le soir on comprend qu’il ne faut pas sortir tout seul, ça peut être dangereux.
On ne sait pas vraiment pourquoi on peut sortir seul maintenant, le concept de « grandir » est vague, mais on ajoute pourtant immédiatement des raisons de ne pas le faire. Il s’agit d’étayer la réponse initiale plutôt que de vouloir trop vite aborder les exceptions.
Exemple : Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
— C’est de la lâcheté. Cela peut être légitime car au final l’intention est bonne.
La lâcheté a une connotation négative, on ne peut pas l’utiliser comme preuve de légitimité. La phrase suivante affirme que « l’intention est bonne » mais ne dit pas en quoi cette intention est bonne. Nous avons là deux idées inachevées qui se contredisent.
Exemple : Faut-il défendre la liberté d’opinion ?
— Tout le monde a le droit de penser ce qu’il veut. Par contre, il y a des pays où l’on est emprisonné si on pense le contraire de ce que le gouvernement veut.
L’auteur n’argumente pas sa réponse initiale, mais montre que l’idée n’est pas toujours appliquée. Il utilise un fait comme contre argument à sa propre proposition, ce qui ne constitue en rien une preuve et engendre de la confusion.
6) GLISSEMENT DE SENS
Argument dont le contenu se trouve en décalage par rapport à la proposition initiale : il s’est effectué un déplacement dans l’utilisation des concepts ou dans le sens de l’idée. Soit la relation est trop indirecte, soit l’écart est trop important, ce qui rend l’argument inadéquat.
Exemple : Est-on obligé de dire la vérité lorsqu’on a faim ?
— Oui, car il n’y a pas de honte à avoir faim.
Cela répond à la question : « Peut-on dire la vérité quand on a faim ? » et non pas « Doit-on dire la vérité quand on a faim ? ». De ce fait, le problème soulevé n’est pas traité.
Exemple : Je crois ce que je veux. Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ?
— Oui, parce que tout le monde peut croire ce qu’il veut.
La question demande si c’est légitime, l’auteur répond que c’est possible. La possibilité est un glissement courant, car elle offre une sorte de réponse minimale, alors que l’obligation est plus exigeante.
Exemple : Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour ne pas blesser.
— Ce n’est pas un mensonge, c’est plutôt de la pitié.
Confusion entre l’acte et sa finalité, ou entre l’acte et sa raison d’être. « La pitié » n’indique pas si c’est un mensonge ou pas, pas plus qu’elle ne s’oppose au mensonge : elle indique pourquoi on dit ce qu’on dit. De plus, ni le mensonge, ni la pitié ne sont en soi légitime ou illégitime : il s’agirait de clarifier et d’expliciter ce parti pris.
Exemples : Pourquoi lui as-tu donné une claque ?
Ce n’était pas une claque, je ne l’ai pas fait exprès.
Ce n’était pas vraiment une claque, ça ne lui a même pas fait mal.
C’était à peine une claque, ce n’était pas très fort.
Une des diverses manières de gommer l’acte, c’est de glisser de l’acte en soi vers la motivation, vers l’intention, vers l’effet, en utilisant la quantité : un peu, pas fort, ou bien en créant des circonstances atténuantes. Gommer l’acte en le dénaturant sert à le justifier, par un processus de réduction, de dilution, de redescription.
7) FAUX ARGUMENT
Proposition qui n’est justifiée par aucun concept complémentaire. Certains termes sont rajoutés à la proposition ou réponse initiale, parfois cela peut prendre la forme d’un argument grâce à des connecteurs appropriés, sans pour autant produire de véritable sens. Il s’agit généralement d’un alignement de mots ayant parfois une valeur phatique ou rhétorique, parfois tout simplement hors sujet.
Exemple : Le professeur dit qu’il ne faut pas couper la parole aux autres, mais elle coupe souvent la parole aux élèves. A-t-elle plus le droit que les élèves de couper la parole ?
— Non, car les élèves, eux, doivent lever le doigt pour parler.
Le fait que « les élèves doivent lever le doigt » pour parler ne prouve en rien que l’enseignante a le droit ou pas de « couper la parole ». Rien ne vient justifier l’absence de légitimité : on décrit ce qui se passe déjà, au lieu d’émettre un jugement sur ce qui se passe.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? C’est écrit dans des livres.
— Généralement, les livres ne mentent pas. Alors on peut croire les livres. Et si on n’est pas sûr, on peut toujours vérifier.
On ne sait pas pourquoi il faudrait croire les livres, ni d’où sort l’idée qu’ils ne mentent pas. L’idée de « pouvoir vérifier » ne change strictement rien au problème de savoir si on peut faire confiance ou non aux livres, et donc ne constitue en rien un argument.
Exemple : Est-ce que ce qu’il dit est vrai ?
C’est vrai parce que je pense la même chose depuis toujours.
C’est vrai, je te jure que c’est la vérité.
Le fait de « penser la même chose depuis toujours » ne vient en rien appuyer une idée, sinon de façon purement psychologique, mais non épistémique, comme il se doit. Le fait de jurer n’indique qu’une certaine sincérité ou un désir de convaincre.
8) TAUTOLOGIE
Proposition qui prétend justifier une réponse ou une idée en répétant à l’identique ou en reformulant sous d’autres termes cette réponse ou cette idée. Aucun nouveau concept n’est fourni, ni pour justifier, ni pour expliquer : l’argument reprend seulement la proposition initiale.
Exemple : Faut-il toujours être poli ?
— Oui, c’est une question de politesse.
On ne peut justifier le fait d’être poli par la politesse : c’est une reformulation de la réponse initiale « oui » en reprenant les éléments de la question.
Exemple : La loi nous y oblige. Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ?
— Oui, parce qu’on est bien obligé.
La transformation de l’obligation, de la forme active à la forme passive, est une simple reformulation de la réponse initiale « Oui ».
Exemple : Es-tu toujours toi-même si tu changes de culture ?
— Oui, car le changement de culture ne modifie en rien le soi-même.
Reformulation de la réponse en une phrase complète, mais aucun argument, aucun nouveau concept n’est fourni : il s’agit d’une reprise des termes de la question.
9) Rejet du problème
Réponse ou argumentation qui ne prend pas rigoureusement en charge la formulation du problème, en prétextant de manière explicite ou implicite un désaccord avec les données du problème. Ce désaccord s’exprime soit dans la réponse initiale, soit dans l’argument qui vient soutenir la réponse initiale, au risque d’engendrer des incohérences.
Exemple : Es-tu toujours toi-même si tu changes de métier ?
— Non, car je n’en ai pas.
Rejet de la question hypothétique en alléguant une situation personnelle. De ce fait l’argument est hors sujet.
Exemple : On t’offre une bague qui te rend invisible. Tu es au magasin. En profites-tu pour prendre ce qui te plaît ?
— Non, car ça n’existe pas.
Rejet de la question hypothétique en alléguant l’inexistence de son objet. De ce fait l’argument est hors sujet.
Exemple : Si Spiderman est un être humain, alors il mourra un jour. Est-ce logique ?
— Ce n’est pas logique, car Spiderman n’existe pas.
Invocation abusive de la logique, car il s’agit plutôt d’une opinion, aussi légitime soit-elle. Rejet de la question hypothétique introduite par le « si », en alléguant l’inexistence de l’objet traité. De ce fait l’argument est hors sujet.
Exemple acceptable : Les martiens peuvent-ils débarquer sur terre demain ?
Non, car ils n’existent pas : personne n’en a jamais vu.
L’argument est acceptable, car le présupposé de l’existence des martiens n’est pas inclus dans l’énoncé du texte. Et leur non-existence justifierait leur non-débarquement.
Exemple :
En cas de danger extrême, en priorité, te sauves-tu toi-même ou sauves-tu quelqu’un d’autre ?
Les deux à la fois, car je sais bien nager.
Le problème moral présenté n’est pas traité : le choix demandé n’est pas effectué, de plus, il dérive sur un problème de compétence physique.
Exemple :
Préfèrerais-tu être riche ou célèbre ?
Ni l’un ni l’autre, parce que c’est le bonheur qui compte.
Le problème existentiel présenté n’est pas traité : le choix demandé n’est pas effectué. Une tierce proposition est utilisée en guise d’argument.
10) ARGUMENT INTERROGATIF
Utilisation d’une question en guise de justification d’une proposition. Une telle question a en général pour fonction de renvoyer le problème à l’auteur de l’énoncé initial , de simplement évoquer la possibilité de la réponse proposée, ou bien de mettre en cause toute objection à la réponse proposée. Un tel argument est au mieux trop allusif, au pire non pertinent.
Exemple : Dois-je aider une personne qui n’aide pas les autres ?
— Non, car pourquoi s’embêter à aider un égoïste ?
La question n’est pas un argument, parce qu’on pourrait répondre en trouvant des raisons pour lesquelles on pourrait « s’embêter ». La question est trop ouverte, elle ne démontre pas, ou elle tente d’exprimer indirectement une affirmation comme réponse implicite ou évidente à la question. Elle a plutôt un effet rhétorique. De plus, il n’y a pas de concept suffisant pour répondre « non » à la question de « l’argument », alors que le « non » est implicite.
Exemple : Pierre te dit qu’il est menteur. Le crois-tu ?
Je ne le crois pas, car comment croire quelqu’un qui ment tout le temps ?
La question reste ouverte, elle ne démontre pas, n’argumente pas : elle demande un moyen, une manière. À moins de prendre cette question pour une affirmation déguisée en pensant qu’elle montre une impossibilité, ce qui serait un choix très spécifique méritant d’être étayé par quelque concept. De surcroît l’effet est plutôt rhétorique : aucun concept n’est fourni.
Exemple : Faut-il toujours dire la vérité ?
— Non, parce que quelle vérité ? Est-ce qu’on connaît toujours la vérité ?
Le fait de demander la nature de la vérité ou si on la connaît ne prouve rien. Les postulats implicites des questions devraient être énoncés et justifiés, par exemple l’impossibilité de connaître la vérité. Mais il faudrait aussi établir un lien avec l’obligation de « dire la vérité », sans quoi, nous aurions un glissement de sens nous entraînant vers un hors sujet.
11) INDÉTERMINATION DU RELATIF
Utilisation de termes relatifs : ça dépend, pas forcément, parfois, pas totalement, pas nécessairement… sans autre complément d’information qui permettrait de clarifier et comprendre les raisons et les conséquences de cette relativisation. Ces termes « indéterminés » sont périodiquement utilisés de manière inadéquate comme réponse ou comme argument. Lorsqu’ils sont utilisés en guise de réponse, ils sont souvent utilisés pour ne pas répondre à la question posée.
Exemple : Est-on obligé de dire la vérité lorsqu’on vient de mentir ?
— Non, tout dépend du pourquoi du mensonge.
On peut comprendre que l’obligation de dire ou non la vérité dépende de la raison du mensonge, mais il s’agirait de donner sens à cette relativité en expliquant quels types de motivations ou quel exemples obligeraient ou non à dire la vérité.
Exemple : Est-ce bien ou mal de se venger ?
— Ça dépend comment on se venge.
La dépendance du mode de vengeance demande à être expliquée pour savoir de quoi l’on parle ; sans cette précision, l’idée est creuse.
Exemple : Est-ce une bonne raison de croire quelque chose ? Je crois ce que je veux.
—: C’est une bonne ou mauvaise raison, ça dépend pour qui.
En s’exprimant ainsi, on ne sait aucunement faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Il s’agit là, d’un relativisme radical qui n’est ni expliqué, ni justifié.
12 – Argument de conviction
Proposition qui énonce un simple état subjectif n’offrant aucune preuve ou fondement pour soutenir la réponse initiale tout en prétendant le faire. Il s’agit en général de l’expression d’une certitude ou d’un doute, ou encore d’une attestation formelle et emphatique quant à la vérité ou à la fausseté d’une réponse. Ce type d’argumentation relève plutôt de la rhétorique, puisqu’il s’agit de faire partager sa conviction pour persuader autrui.
Exemple : Qui a pris mon stylo ?
— C’est Pierre. Je suis certain que c’est lui.
Il s’agit de l’argument de la sincérité : prétendre justifier une proposition en attestant de sa propre conviction. Ce type d’argument sera en général introduit par des expressions subjectives, comme « Je te promets que.. », « Je te jure que… », « Je t’assure que.. », « Je suis certain que… » et parfois des expressions objectives : « Il est certain que… », « Il est sûr que… ». On y utilise aussi des adverbes de conviction : honnêtement, franchement, sincèrement, vraiment… Tous ces termes n’ont de valeur que rhétorique, ils ne fournissent aucune preuve, ils assurent et rassurent : la sincérité du locuteur est censée emporter l’adhésion de l’auditeur.
Exemple : Penses-tu que Yann a raison quand il dit que ce médecin n’est pas compétent ?
— Oui, parce que j’ai exactement le même avis sur la question.
Il s’agit de l’argument du sentiment personnel : prétendre justifier une opinion ou un jugement en attestant de son accord avec son contenu. C’est une sorte d’argument d’autorité où le locuteur valide une proposition en tant qu’autorité incontestable qui n’a nul besoin d’argumenter ou de fournir un quelconque contenu pour justifier sa position.
Exemple : Est-ce Pierre qui a pris mon stylo ?
Non, je ne suis pas sûre qu’il en soit capable.
Il s’agit de l’argument du doute : le fait que l’on doute d’une proposition ne montre en rien qu’elle est fausse, ni au demeurant qu’elle est vraie. L’expression d’un tel doute montre uniquement l’état d’esprit du locuteur, mais n’adresse pas du tout le problème posé. De surcroît, il n’est pas besoin d’être « sûr » pour répondre ou argumenter, puisqu’il s’agit toujours de pensée hypothétique. Dans le cas présent, cela pourrait devenir l’argument suivant, plus affirmatif : « Non, car il ne semble pas capable d’un tel geste. »
13) ARGUMENT ILLOGIQUE
Argument dont la construction transgresse certaines règles élémentaires de la logique. Par exemple l’inversion entre la cause et l’effet, les déductions invalides, les syllogismes mal construits, etc. Ces paralogismes peuvent se trouver à l’intérieur de l’argument, ou dans le rapport entre l’argument et la proposition qu’il vient soutenir.
Exemple : Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
— Non, parce que c’est de la méchanceté gratuite.
Il y a là une incohérence entre la réponse et l’argument. La question énonce l’on ne dit pas la vérité dans un but spécifique : « pour obtenir quelque chose », auquel cas l’acte n’a rien de gratuit.
Exemple : Comment sais-tu que Jean est chez lui ?
il est chez lui parce qu’il n’est pas à l’école.
Le fait de ne pas être à l’école n’implique pas nécessairement qu’il est à la maison, sauf si les données du problème le spécifient ainsi. Car il pourrait être dans bien d’autres endroits.
Quelques types d’arguments illogiques courants
Argument du contraire.
Exemple : Pourquoi dis-tu qu’il n’y a de la vie que sur terre ?
Il n’y a de vie que sur terre parce que personne ne peut prouver le contraire, et montrer qu’il y a de la vie ailleurs que sur la terre.
Cet argument erroné consiste à affirmer que le contraire d’une proposition n’est pas prouvé, ou ne peut pas être prouvé, en guise de preuve de cette proposition. Or cela déplace simplement la charge de la preuve sur le parti adverse, sans prouver quoi que ce soit.
Argument irrationnel
Exemple : Le professeur de mathématiques est-il un bon professeur ?
Non, parce que les maths, ça m’énerve.
Cet argument erroné utilise un argument subjectif pour valider une déclaration objective n’ayant pas de surcroît de lien causal entre eux. Dans un cas il s’agit du professeur, dans l’autre la matière.
Inversion logique
Exemple : Pourquoi cette personne est-elle ton amie ?
C’est mon amie parce que nous sommes toujours ensemble.
Cet argument erroné commet une inversion entre la cause et l’effet, la cause et le symptôme, la cause et les conséquences. On est ensemble parce que l’on est ami, et non l’inverse. Le fait d’être toujours ensemble n’est ni la cause, ni l’explication de l’amitié : cela constitue à la rigueur la preuve de cette amitié, ou sa manifestation : c’est comme cela que l’on peut reconnaître cette amitié.
Réaction défensive
Exemple : Pourquoi as-tu cassé ce pot.
Mais je ne l’ai pas fait exprès.
La réponse ne traite pas du tout la question demandée, elle tente uniquement de se dégager de toute responsabilité en protestant de l’absence de mauvaise intention. L’utilisation du « mais » indique déjà le refus de répondre. Le fait de « ne pas le faire exprès », de nier l’intention, ne justifie rien. L’argument aurait pu être : « J’étais trop pressé », ou bien « Je ne faisais pas attention », etc.
14) FAUSSE ÉVIDENCE
Proposition qui considère comme indiscutable un principe général, un lieu commun, ou un propos banal, justifié d’emblée par leur apparente évidence, laquelle relève en fait de la prévention, du préjugé ou de l’absence de réflexion. Ces propositions seront parfois introduites par des termes comme « normalement », ou des expressions comme « tout le monde sait que ».
Exemple : Faut-il obéir à ses parents ?
— Il faut obéir aux parents car on sait qu’ils nous mènent sur la bonne voie.
« On sait » n’est pas en soi un argument, il faudrait clarifier ce qui fait dire « qu’ils nous mènent sur la bonne voie », par ex. parce qu’ils ont une expérience de la vie. Le « savoir commun » ou le « bon sens commun » ne constituent pas en soi des arguments.
Exemple : Je ne regarde jamais la télé quand je veux. Est-ce juste ou injuste ?
— C’est injuste car tout le monde, normalement, a le droit de regarder la télé quand il veut.
On ne sait pas de quelle « norme » il s’agit, ni ce qui la justifie. Au mieux, il s’agit d’un état de fait, d’une pratique courante, ce qui ne justifie en rien la justice ou l’injustice d’un fait.
Exemple : Faut-il obéir à ses parents ?
— Oui, parce que c’est plus raisonnable
On ne sait pas ce que signifie ce « raisonnable », ni ce qui justifie ce qualificatif. Cette affirmation paraît « sensée » mais en fait elle ne dit rien.
Exemple : Est-ce une bonne raison de ne pas dire la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
— C’est de l’hypocrisie. Ce n’est pas légitime car cela fait du tort à l’autre.
Le fait de qualifier l’acte par un terme ayant une « connotation négative » ne suffit pas à montrer que ce n’est pas bien : il faudrait montrer en quoi cette hypocrisie n’est pas légitime. Et si elle « fait du tort à l’autre », il s’agit d’expliquer de quelle manière.
15) ARGUMENT FAIBLE
Proposition qui a la forme et la valeur d’un argument, mais dont le contenu reste en deçà par rapport à la proposition qu’il prétend étayer. La faiblesse de cet argument peut relever d’un problème de proportion ou de probabilité, d’une légitimité fragile ou de l’utilisation abusive des circonstances. Il tend à ne pas aller à l’essence des choses.
Exemple : Faut-il respecter ses camarades ?
— Non, parce qu’ils m’agacent.
Cet argument, plutôt irrationnel, utilise la subjectivité comme une réponse à un problème moral. Cela est dans l’absolu toujours possible, mais reste un argument pauvre, tout en s’approchant de l’argument irrationnel ou illogique.
Exemple : L’être humain est-il bon ?
Oui, les gens de ma famille s’aident tous les uns les autres.
S’il s’agit de qualifier l’humanité, on en peut pas tirer des conclusions à partir des quelques membres d’une famille. Cela relève presque de la généralisation abusive, bien que l’exemple aille déjà dans le sens d’une preuve pertinente.
Quelques types d’arguments faibles courants
Argument du précédent
Exemple : Pourquoi penses-tu que ce garçon est celui qui a volé ta montre ?
Parce c’est un voleur : il s’est déjà fait attrapé une fois.
Certes, le fait « d’être un voleur » peut être un argument pour prouver qu’une personne a volé, au niveau de la probabilité tout au moins. Mais cela reste un argument faible : car être un voleur n’est pas une « essence », un voleur ne vole pas tout le temps, certains voleurs ont arrêté de voler, il existe plus d’un voleur, il existe des voleurs qui volent tellement bien qu’on ne sait pas qu’ils volent, etc. Il s’agirait donc de produire un argument plus spécifique, traitant du cas spécifique en question : le problème de la montre volée. D’autre part, on peut considérer que d’avoir été attrapé une seule fois à voler ne suffit pas à qualifier quelqu’un de voleur.
Hypothèse gratuite
Exemple : T’es-tu préparé pour le contrôle de maths ?
Non, parce qu’on ne sait jamais, la prof sera peut-être malade.
Il s’agit de l’argument du simple possible, qui consiste à utiliser comme justification quelque chose qui n’est simplement qu’une éventualité, sans raison particulière de probabilité. Le fait que cela peut être vrai renvoie à un espoir plutôt qu’à une raison, sans toutefois en être conscient et l’avouer. On pourrait aussi nommer cela : prendre ses désirs pour des réalités. Bien que dans l’absolu, un tel argument puisse être une raison d’agir, très subjective, tout à fait commune.
Généralisation abusive
Exemple : Pour quoi penses-tu que c’est ce garçon qui a volé ?
Parce son copain est aussi un voleur.
Le fait d’appartenir à un groupe donné ou d’avoir des relations avec quelqu’un ne constitue pas un argument solide pour justifier une accusation ou une qualification. Sauf si cette qualification fait partie de la « nature» de ce groupe ou de cette relation : dans ce cas, il faudrait étayer cette qualification globale. Néanmoins, le « qui se ressemble s’assemble » reste formellement un argument acceptable.
Argument de l’habitude
Exemple : Et pourquoi dois-je aider à mettre la table ?
— Parce que les enfants ont toujours aidé leurs parents, et on ne va pas changer le monde du jour au lendemain.
Invoquer une tradition, une coutume ou une habitude en guise d’explication. Cela n’explique ni ne justifie que très superficiellement la valeur ou le sens d’un acte ou d’une idée.
Alibi des circonstances
Exemple : Pourquoi n’as-tu pas fait ton travail ?
— Parce que j’avais beaucoup de choses à faire.
Bien que l’on comprenne les circonstances et la difficulté qu’elles posent, cela n’explique pas pourquoi le travail n’a pas été fait. En effet, il faudrait rendre compte du choix qui a donné priorité à d’autres activités parmi ces nombreuses « choses à faire ». Les circonstances peuvent avoir une valeur atténuante ou aggravante, mais elles ne modifient pas l’acte, la raison de l’acte en soi ou la responsabilité de cet acte.
Alibi d’autrui
Exemple : C’est injuste que je sois punie pour avoir parlé en classe. Parce que ce n’est pas de ma faute, c’est ma voisine qui me demande tout le temps quelque chose.
Il s’agit de renvoyer la cause et la responsabilité de nos actes sur une tierce personne. Certes il n’est pas facile de ne pas parler si autrui nous parle, mais on peut envisager diverses manières de résoudre ou prévenir ce problème si nous le voulons. Autrui n’est en cela qu’une cause secondaire, ou une cause efficiente : il ne peut servir pour nier notre part de liberté et de responsabilité.
Argument d’exagération
Exemple : Et pourquoi devrais-je faire mes devoirs ?
— Si tu ne fais pas tes devoirs, tu auras une mauvaise note, tu ne pourras pas aller au lycée plus tard, et tu deviendras une clocharde.
Il s’agit de forcer le trait sur la description d’un acte, ses implications ou ses conséquences, afin de persuader autrui. Si ce type d’argument peut avoir un impact sur le plan des émotions, il est pauvre sur le plan de la raison, en raison de sa nature excessive et caricaturale. C’est ainsi que l’on justifie couramment un point de vue en exagérant le point de vue adverse qui en devient ridicule ou absurde.
Argument minimaliste
Exemple : Doit-on obéir à ses parents ?
— Non, car on a bien le droit de faire ce que l’on veut.
Il s’agit de l’argument minimaliste : produire un argument trop général car utilisable dans des situations trop diverses. De ce fait, il ne traite pas la spécificité du problème posé. De surcroît, il est facilement critiquable à cause d sa généralité : il est facile de prouver que l’on n’a pas toujours le droit de faire ce que l’on veut. C’est le cas des arguments « bateau » qui explique tout, tels que le « je n’ai pas envie » ou le « il est paresseux ».
Argument d’autorité
Exemple : Pourquoi dis-tu cela ?
— Parce que Kant l’a prouvé.
Il s’agit de l’argument d’autorité : utiliser le nom, la fonction ou le titre d’une personne pour justifier une pensée ou un acte. Au mieux, l’autorité invoquée a une compétence en la matière et peut constituer une référence, au pire, elle n’en a aucune et l’argument est absurde, bien que très utilisé pour convaincre, en particulier dans la publicité. Le problème principal est que ce type d’argument ne fournit aucun contenu.
Argument de la personne
Exemple : Pourquoi penses-tu que cette idée est mauvaise ?
— Parce que celui qui l’a dit est un idiot.
Il s’agit de réfuter une idée en disqualifiant son auteur. C’est l’inverse de l’argument d’autorité. Or rien n’empêche une personne idiote d’avoir une bonne idée, ne serait-ce que par accident. Ce type d’argument trouve une certaine valeur lorsque des compétences sont impliquées, liées à une fonction par exemple : les conseils médicaux d’une personne qui n’est pas qualifiée en médecine. Le problème reste néanmoins que ce type d’argument est dépourvu de contenu.
Alibi du nombre
Exemple : Pourquoi n’es-tu pas venu hier ?
Parce que les autres non plus ne venaient pas.
Il s’agit de l’argument du nombre : utiliser le fait que plusieurs personnes on fait la même chose pour justifier une pensée ou un acte. Le problème principal est que ce type d’argument ne fournit aucun contenu. On peut facilement en montrer l’absurdité : le nombre ne constitue pas en soi un critère de légitimité. L’argument de la rumeur ou de la suspicion fait partie de cette catégorie : « Si on le dit, il doit bien y avoir une raison ».
Justification abusive
Exemple : Pourquoi tu lui as pris son stylo ?
— De toute façon, il était abîmé et elle ne s’en servait pas.
Il s’agit d’utiliser des prétextes pour justifier un acte a posteriori, qui tentent de gommer l’intention réelle en inventant des raisons fallacieuses ou en caricaturant la réalité. Les raisons fournies sont spécieuses, voire contradictoires avec la réponse : elles ne fournissent ni contenu réel, ni légitimité. La mauvaise foi, même flagrante, ne peut être retenue pour refuser l’argument. C’est d’ailleurs tout le problème que pose la mauvaise foi : formellement, elle est irréprochable.
Argument superstitieux
Exemple : Penses-tu qu’il pleuvra demain ?
Oui, parce que demain c’est mardi, et en général il pleut le mardi parce c’est le début de la semaine.
Il s’agit de trouver ou inventer des coïncidences en leur fournissant des explications fantaisistes ou absurdes. Malgré tout, nous sommes obligé de considérer qu’il s’agit bien là d’un argument acceptable, quand bien même sa pertinence relève d’un acte de foi très singulier.
La pratique du dialogue philosophique
La pratique du dialogue philosophique
Quels sont les éléments indispensables au dialogue philosophique? Qu’est-ce qui distingue une discussion philosophique d’une discussion “ordinaire”? Avant toute chose, il nous faut tenter de répondre à ces questions, afin de traiter diverses objections qui s’élèveront. Car il ne manquera pas de voix pour affirmer que la pensée philosophique s’effectue uniquement dans la solitude, en soutenant que le cours magistral, la conférence ou le livre représentent les moyens exclusifs de la formation philosophique, qui reste en fin de compte une transmission, une passation de savoir. Certes la discussion est admise dans l’enceinte philosophique, mais elle l’est principalement dans un échange entre pairs, chargée d’érudition, centrée sur des problèmes d’interprétation et d’exégèse, qui prendra généralement la forme d’une suite discontinue de perspectives plus que d’une véritable discussion. Ou bien entre maître et élève, avec le présupposé d’une réponse philosophique à une question qui n’est sans doute pas philosophique, ou peu.
Si l’érudition reste au centre de toute préoccupation, si la complexité du savoir est le but à atteindre, il ne faut pas s’étonner du côté “vases communicants” de tout échange en philosophie. Par définition, celui qui sait éduquera celui qui ne sait pas. Ainsi l’on constatera que dans l’histoire de la pensée occidentale, rares sont les auteurs qui utilisent le dialogue comme moyen d’expression, cet exercice en commun où chacun a besoin de l’autre. Encore moins de textes valorisent l’ignorant ou le naïf, la “docte ignorance”, pour en faire l’outil et le vecteur d’une initiation philosophique. Platon et Nicolas de Cues sont parmi les rares auteurs à mettre en scène de tels personnages et de telles paroles, bien que dans la littérature et le théâtre foisonnent des exemples de “héros” qui incarnent une sorte de sagesse naturelle ou servent à l’illustration d’un imprévisible dépassement moral ou intellectuel. Ceci s’explique en partie par le postulat d’une philosophie cantonnée généralement à la construction du discours, occultant l’idée d’une pratique philosophique comme mise à l’épreuve singulière ou collective de l’être.
TRAVAILLER L’OPINION
Partons de l’hypothèse que philosopher, c’est arracher l’opinion à elle-même en la problématisant, en la mettant à l’épreuve. Autrement dit, l’exercice philosophique se résume à travailler l’idée, à la pétrir comme la glaise, à la sortir de son statut d’évidence pétrifiée, à ébranler un instant ses fondements. En général, de par ce simple fait, une idée se transformera. Ou elle ne se transformera pas, mais elle ne sera plus exactement identique à elle-même, parce qu’elle aura vécu; elle se sera néanmoins modifiée dans la mesure où elle aura été travaillée, dans la mesure où elle aura entendu ce qu’elle ignorait, dans la mesure où elle aura été confrontée à ce qu’elle n’est pas. Car philosopher constitue avant tout une exigence, un travail, une transformation et non pas un simple discours; ce dernier ne représente à la rigueur que le produit fini, atteint parfois d’une rigidité illusoire. Sortir l’idée de sa gangue protectrice, celle de l’intuition non formulée, ou de la formulation toute faite, dont on entrevoit désormais les lectures multiples et les conséquences implicites, les présupposés non avoués, voilà ce qui caractérise l’essence du philosopher, ce qui distingue l’activité du philosophe de celle de l’historien de la philosophie.
En ce sens, installer une discussion où chacun parle à son tour représente déjà une conquête sur le plan du philosopher. Entendre sur un sujet donné un discours différent du nôtre, nous y confronter par l’écoute et par la parole, y compris au travers du sentiment d’agression que risque de nous infliger cette parole étrangère. Le simple fait de ne pas interrompre le discours de l’autre signifie déjà une forme importante d’acceptation, ascèse pas toujours facile à s’imposer à soi-même. Il n’y a qu’à observer avec quel naturel on se coupe instinctivement et incessamment la parole, avec quelle aisance certains monopolisent abusivement cette même parole. Ceci dit, il est tout de même possible d’utiliser l’autre pour philosopher, de philosopher au travers du dialogue, y compris au cours d’une conversation hachée où s’entrechoquent bruyamment et confusément les idées, idées entrelacées de conviction et de passion. Mais il est à craindre, à moins d’avoir une rare et grande maîtrise de soi, que le philosopher s’effectuera uniquement après la discussion, une fois éteint le feu de l’action, dans le calme de la méditation solitaire, en revoyant et repensant ce qui a été dit ici ou là, ou ce qui aurait pu être dit. Or il est dommage et quelque peu tardif de philosopher après coup, une fois le tumulte estompé, plutôt que de philosopher pendant la discussion, au moment présent, là où l’on devrait être plus à même de le faire. D’autant plus qu’il n’est pas facile de faire taire les élans passionnels liés aux ancrages et implications divers de l’ego une fois que ceux-ci ont été violemment sollicités, s’ils n’ont pas complètement bouché toute perspective de réflexion.
MISE EN SCENE DE LA PAROLE
Pour ces raisons, dans la mesure où le philosopher nécessite un certain cadre, artificiel et formel, pour fonctionner, il s’agit en premier lieu de proposer des règles et de nommer un ou des responsables ou arbitres, qui garantiront le bon fonctionnement de ces règles. Comme nous l’avons évoqué, la règle qui nous semble la plus indispensable est celle du “chacun son tour”, de préférence en s’inscrivant chronologiquement au tour de parole géré par un de ces arbitres. Elle permet d’éviter la foire d’empoigne et protège d’une crispation liée à la précipitation. Elle permet surtout une respiration, acte nécessaire à la pensée, qui doit pour philosopher avoir le temps de s’abstraire des mots et se libérer du besoin et du désir immédiats de réagir et parler. Une certaine théâtralisation doit donc s’effectuer, une dramatisation du verbe qui permettra de singulariser chaque prise de parole. Une des règles qui se révèle efficace est celle qui propose qu’une parole soit prononcée pour tous ou pour personne. Elle protège de ces nombreux apartés qui installent une sorte de brouhaha, bruit de fond qui restreint l’écoute et déconcentre. Elle empêche aussi l’énergie verbale de se diffuser et de s’épuiser en de nombreuses petites interjections et remarques annexes, qui bien souvent servent plus au défoulement nerveux qu’à une véritable pensée.
La théâtralisation permet l’objectivation, la capacité de devenir un spectateur distant, accessible à l’analyse et capable d’un métadiscours. La sacralisation de la parole ainsi effectuée permet de sortir d’une vision consumériste où la parole peut être complètement banalisée, bradée d’autant plus facilement qu’elle est gratuite et que tout le monde peut en produire sans effort aucun. On en vient alors à peser les mots, à choisir de manière plus circonspecte les idées que l’on souhaite exprimer et les termes que l’on veut employer. Une conscience de soi s’instaure, soucieuse de ses propres propos, désireuse de se placer en position critique face à soi-même, capable de saisir les enjeux, implications et conséquences du discours qu’elle déroule. Ensuite, grâce aux perspectives qui ne sont pas les nôtres, par le principe du contre-pied, un effet miroir se produit, qui peut nous rendre conscient de nos propres présupposés, de nos non-dits et de nos contradictions.
QUESTIONNEMENT MUTUEL
Comme nous l’avons vu, le simple fait d’installer une procédure formelle d’écoute induit déjà au philosopher, mais il ne faut toutefois pas se leurrer: l’opinion est tenace et les habitudes de la parole réfléchie ne s’acquièrent pas de façon aussi miraculeuse et instantanée. Pour cette raison, des dispositifs supplémentaires s’avèrent utiles à l’introduction de la pensée philosophique dans la discussion. Parmi ces diverses procédures, l’une d’entre elles nous paraît plus particulièrement efficace: la pratique du questionnement mutuel. Le principe en est simple. Une fois qu’une parole s’est exprimée sur un quelconque sujet, avant de passer à l’expression d’une autre perspective, avant de laisser la place à une autre réaction, un temps est réservé de manière exclusive aux questions. Dans cette partie du jeu, chaque participant doit se concevoir comme le “Socrate” de la personne qui vient de s’exprimer, comme la sage-femme d’un discours considéré a priori comme à peine ébauché. Ainsi chaque idée ou hypothèse sera étudiée et approfondie avant de passer à une autre.
À la grande surprise de tous, il est plus difficile de questionner que d’affirmer. C’est la constatation qui s’imposera rapidement aux participants dans cet exercice particulier. Car une question se doit d’être une véritable question. Il s’agit là d’exclure les affirmations plus ou moins déguisées qui ne manqueront pas de s’exprimer. Dans ce jeu nous entendons par question une interrogation qui tient de ce que Hegel appelle une critique interne, c’est-à-dire une mise à l’épreuve de la cohérence d’un discours et une demande d’éclaircissement de ses hypothèses de départ. Cette pratique s’inspire aussi du principe de remontée anagogique, telle que décrite par Platon comme méthode socratique. On y voit peu à peu l’interrogé prendre conscience des limites et contradictions implicites de ses propres affirmations, confrontation l’amenant à revoir sa position dans la mesure où il entrevoit les enjeux sous-jacents restés jusque-là invisibles. Le dévoilement de ces enjeux est généralement induit par la découverte d’une unité paradoxale, substantielle et première, précédemment obscurcie par la multiplicité éparse du propos.
Pour ce faire, pour connaître une efficacité maximale, la question se doit de reprendre le plus possible les termes mêmes du discours qu’elle souhaite interroger, de coller le plus près possible à l’articulation de sa structure et de ses éléments. L’exemple même d’une “mauvaise” question est la forme du “Moi je pense que, qu’en pensez-vous?”. Un des critères pour une “bonne” question est que l’auditeur doit au maximum ignorer l’opinion de celui qui interroge, sa position devant se cantonner à une perspective principalement critique, même si dans l’absolu une position aussi dénuée de subjectivité n’est pas totalement concevable. Mais le simple fait de se risquer à une telle ascèse est important. Tout d’abord elle est un exercice d’écoute et de compréhension, puisqu’elle oblige à entendre et comprendre avec rigueur celui que nous prétendons interroger. Puis elle nous apprend à nous débarrasser momentanément du “sac à dos”: la masse d’opinions et de convictions qui nous habite. Ensuite elle nous apprend à nous “oublier”: à nous décaler et nous décentrer de nous-même par le fait de se recentrer sur une autre personne, un autre discours, d’autres prémisses, une autre logique.
QUESTIONNER POUR APPRENDRE À LIRE
Ces divers éléments sont en principe essentiels à une discussion ou à la lecture d’un texte. Car bien souvent, ce qui empêche la lecture ou l’écoute n’est pas tant l’incompréhension face à ce qui est dit, que le refus d’accepter les concepts avancés par l’auteur à tel point que le texte nous paraît dépourvu de sens. L’exercice proposé, qui revient à penser l’impensable, constitue donc une sorte de mise en abîme du lecteur ou de l’interrogateur. En confrontant la difficulté du questionnement, le questionneur s’apercevra de la rigidité de sa pensée. Ainsi, souvent, il se lancera dans un discours affirmatif avant de poser une question, s’y perdra, pour ne plus arriver à conclure et poser sa question. Au moment où il finira par s’en rendre compte, il réalisera qu’il est en train de développer ses propres idées, en ayant complètement oublié la pensée de la personne qu’il devait interroger. Une autre manière d’obtenir cette prise de conscience est de demander à l’interrogateur ce qui lui paraît essentiel dans ce que son interlocuteur a dit, ou de reformuler son discours, et l’on s’aperçoit alors que la difficulté de questionner vient en grande partie du manque d’attention et d’écoute.
Un processus identique opère chez celui qui est interrogé. À maintes reprises, en prétextant répondre, il se lancera dans un développement très éloigné du propos ou se perdra dans un méandre confus qui ne touche en rien à la question posée. Il suffira de lui demander à quelle question il répond pour s’en apercevoir: soit il ne s’en souviendra plus, soit il en donnera une lecture vague ou biaisée. Cette vérification est une procédure à utiliser en permanence, afin d’assurer un maximum de concentration et de précision dans le dialogue. Lorsque quelqu’un a développé une idée, surtout si l’explication en a été un peu longue, l’animateur pourra exiger une synthèse de trois ou quatre phrases, voire une phrase unique capable de rendre la problématique claire et distincte. Ou encore, une fois la question posée il demandera à son destinataire si la question lui semble explicite, quitte à ce que ce dernier vérifie sa compréhension en proposant une reformulation. Une procédure semblable s’appliquera aussi aux réponses proposées: on demandera à l’interrogateur d’une part si la réponse obtenue lui paraît claire et d’autre part si elle correspond vraiment à la question ou si elle l’esquive et passe à côté. Une reformulation pourra à tout moment être sollicitée comme outil de vérification.
Deux types de difficultés vont se poser ici. D’une part la difficulté d’entendre, de comprendre et d’assumer un jugement en conséquence, car il nous en coûte parfois de déclarer à notre interlocuteur qu’il n’a pas compris notre propos ou qu’il n’a pas répondu à notre question. D’autre part la crainte de ne pas avoir été compris et le sentiment permanent d’avoir été “trahi” par l’autre, qui feront que certains exprimeront constamment leur insatisfaction, au point de rendre toute discussion impossible. Les premiers fonctionneront sur un schéma trop conciliatoire, les seconds sur une perspective trop personnelle et conflictuelle. Ces deux cas de figure se poseront de manière plus fréquente chez les adolescents, plus fragiles dans le rapport qu’ils entretiennent à leur propre discours.
LA DIMENSION DU JEU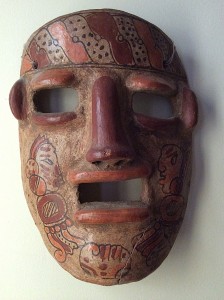
Cette aliénation, la perte de soi en l’autre qui est exigée par l’exercice, avec ses nombreuses épreuves, met à jour à la fois la difficulté du dialogue, la confusion de notre pensée et la rigidité intellectuelle liée à cette confusion. La difficulté à philosopher se manifestera bien souvent à travers ces trois symptômes, en diverses proportions. Il est alors important pour l’animateur de percevoir au mieux jusqu’à quel point il peut exiger de la rigueur avec telle ou telle personne. Certains devront être poussés à confronter plus avant le problème, d’autre devront plutôt être aidés et encouragés, en gommant quelque peu les imperfections de fonctionnement. L’exercice a un aspect éprouvant; pour cela, il est important d’installer une dimension ludique et d’utiliser si possible l’humour, qui serviront de “péridurale” à l’accouchement. Sans le côté jeu, la pression intellectuelle et psychologique mise sur l’écoute et la parole peut devenir trop difficile à vivre. La crainte du jugement, celle du regard extérieur et de la critique, sera atténuée par la dédramatisation des enjeux. Déjà en expliquant que contrairement aux discussions habituelles, il ne s’agit ni d’avoir raison, ni d’avoir le dernier mot, mais de pratiquer cette gymnastique comme n’importe quel sport ou jeu de société.
L’autre manière de présenter l’exercice utilise l’analogie d’un groupe de scientifiques constituant une communauté de réflexion. Pour cette raison, chaque hypothèse se doit d’être soumise à l’épreuve des collègues, lentement, consciencieusement et patiemment. L’un après l’autre, chaque concept doit être étudié et travaillé grâce aux questions du groupe, afin d’en tester le fonctionnement et la validité, afin d’en vérifier le seuil de tolérance. De ce point de vue, c’est rendre service à soi-même et aux autres que d’accepter et d’encourager ce questionnement, sans craindre de ne pas être gentil ou de perdre la face. La différence ne se trouve plus entre ceux qui au travers du discours se contredisent et ceux qui ne se contredisent pas, mais entre ceux qui se contredisent et ne le savent pas, et ceux qui se contredisent et le savent. Tout l’enjeu est dès lors de faire apparaître les incohérences et les manques grâce aux questions, afin de construire la pensée. Pour cela, il est important de faire passer l’idée que le discours parfait n’existe pas, pas plus chez le maître que chez l’élève, aussi frustrante que soient ces prémices.
LE ROLE DE L’ENSEIGNANT
Dans la fonction que nous décrivons, l’enseignant peut sembler perdre sa fonction traditionnelle: celui qui en gros connaît les réponses aux questions. Soit il donne ces réponses, soit il vérifie dans quelle mesure les élèves savent les donner. Dans une telle perspective, seule la dissertation reste un travail – solitaire – où une place relative, selon les critères des correcteurs, est accordée à l’apport personnel de l’élève. Dans l’exercice proposé, l’enseignant ressemble plus à un arbitre ou à un animateur. Son rôle est tout d’abord d’assurer que les pensées sont claires et comprises, ce qu’il vérifiera non seulement au moyen de sa propre compréhension mais aussi grâce aux paroles de ceux qui réagissent à un discours ou à une question donnée. Il doit au maximum utiliser les relations entre participants plutôt que d’émettre lui-même un jugement. En agissant ainsi, il permet à chaque élève de mesurer la clarté de sa parole et de ses concepts, ce qui dans de nombreux cas représente déjà beaucoup. Ensuite il sera là pour souligner les enjeux soulevés par l’échange. Il devra savoir reconnaître les “grandes” problématiques au moment où elles émergent, sans que ceux qui les articulent en soient nécessairement conscients. Il pourra donc reformuler, ainsi qu’établir des liens avec des problématiques d’auteurs. Induire cette prise de conscience aidera à la fois à conceptualiser le discours et à valoriser celui qui le prononce. Un défi se posera ici à l’enseignant: il devra manifester une grande flexibilité intellectuelle afin de déceler une problématique classique sous une forme transposée, voire très schématique. Car il s’agit d’apprendre à chacun à s’écouter afin de profiter au maximum de ses propres intuitions – comme dans une dissertation – tout autant que d’écouter les autres et de profiter de leurs intuitions.
Le rôle spécifique de l’enseignant reste quand même principalement d’initier les participants à la pratique philosophique en introduisant dans le débat un certain nombre de principes constitutif de la pensée, tels la logique, la dialectique ou le principe de la raison suffisante, même si ces outils ne constituent en rien des absolus. Ou faire accepter l’idée qu’à défaut de justifier un argument face à une contradiction, on se doit de l’abandonner, ne serait-ce que temporairement, condition indispensable à la réflexion rigoureuse. Mais ceci se fera au cours du débat, plutôt que par une théorisation a priori, permettant ainsi à chaque participant d’appréhender par lui-même la légitimité de ces outils. Comment éviter le piège d’un relativisme fourre-tout, avec les “ça dépend” qui en eux-mêmes ne veulent rien dire, ou la multiplicité infinie qui prétend à l’évidence sans fournir de réel argument. Construire un métadiscours plutôt que tomber dans le “oui-non-oui-non”. Peser le choix des termes utilisés. Autant d’éléments indispensables à la construction d’une dissertation. Remarque qui permet de répondre à l’enseignant réticent à se lancer dans ce genre de projet, par souci du programme et crainte de la perte de temps.
Il est clair que l’enseignant n’est pas tellement formé à ce genre de pratique. Toutefois, ceci n’est pas un problème dans la mesure où il ne craint pas l’erreur et le tâtonnement. Car s’il est une difficulté principale, identique chez les élèves et les enseignants, c’est la crainte liée à l’incertitude de la prise de risque, en une activité où l’on ne se sent pas nécessairement à l’aise. Mais voilà peut-être une excellente occasion d’effectuer un rapprochement entre le maître et ses élèves, qui feront ensemble l’expérience de précieux moments philosophiques, inquiétants, formateurs et marquants. Car philosopher, n’est-ce pas avant tout installer un état d’esprit ?
La conceptualisation
Le concept
De ce fait, et pour éviter les querelles et procès en hétérodoxie, si courants en philosophie, le concept reste quelque chose que l’on utilise intuitivement, sans jamais vraiment se risquer à articuler sa “véritable” nature, en évitant de trop théoriser sur la question. “Véritable”, tout au moins dans l’esprit de celui qui est censé initier des élèves à la démarche philosophique ; “cohérence” ou “clarté” devrait-on dire. Démarche qui, si elle peut s’épargner le concept du concept, pourra difficilement se passer de concepts. Peut-être est-ce justement en ce décalage entre la définition et l’utilisation que s’articule la nature particulière du concept. En effet, en suivant le langage courant, si l’on “trouve” ou l’on “a” une idée, si l’on “a” des notions, on “invente” et l’on “utilise” un concept. Ainsi le concept est très naturellement un outil, un instrument de pensée, une invention, comme celle de l’ingénieur. Si l’idée est une représentation, si la notion est une connaissance, le concept est donc un opérateur.
Qu’en est-il de l’universalité du concept ? Les concepts sont-ils spécifiques ou sont-ils généraux ? Appartiennent-ils à un auteur, tel le concept de noumène, attribuable spécifiquement à Kant ? Tombent-ils sous le sens commun, tel le concept de justice, qui semble émerger de la nuit des temps ? On peut opposer ces deux types de concept, mais on peut aussi affirmer qu’ils sont indissociables. Si le premier est plus particulier et moins fréquent, il trouve son sens et la preuve de son opérativité dans l’écho que lui offre le sens commun. En effet, dans le cas du noumène, il est facile d’admettre ou d’imaginer que toute entité déterminée est dotée d’une sorte d’intériorité. Le deuxième, la justice, en dépit de sa banalité aujourd’hui, est le produit d’une genèse et d’une histoire qui, d’une intuition commune, a d’ailleurs engendré deux sens : l’institution et la légalité d’une part, le principe et la légitimité d’autre part.
Toutefois, afin de relier les deux attributs du concept, universalité et fonction, proposons l’hypothèse suivante : l’universalité d’un concept est déterminée par son efficacité, par la possibilité de son utilisation et par son utilité. Autrement dit, le concept se doit d’être clair pour être un concept, de même que son utilité se doit d’être manifeste. Il évitera les nuances à l’infini de définitions dont on ne saisit plus tellement l’intérêt. À l’instar d’une fonction mathématique, il doit permettre de résoudre un problème, il n’existe pas pour son propre intérêt. S’il ne peut faire l’économie de la précision, il ne peut surtout pas faire celle de l’application. Ainsi, aussi singulier soit-il, son opérativité lui accordera un statut d’universalité. Pour émerger d’une pratique empirique où tout s’effectue au cas par cas, au travers d’une simple recette, on tentera de conceptualiser l’action ou la pensée particulière. C’est-à-dire d’abstraire ce qui est essentiel et commun aux divers cas de figure possibles. Il s’agira dès lors de sortir de la narration, de l’opinion et du concret pour entrer dans l’analyse.
FONCTION DU CONCEPT
Proposons trois types d’activité liés au concept.
1- connaître les concepts engendrés et approuvés par la tradition philosophique.
2- reconnaître un concept général.
3- créer un concept spécifique.
1- Il s’agit ici de connaître et d’utiliser des concepts reconnus par la tradition, qui sont présentés en tant que concepts, avec tout le crédit qui leur est accordé d’emblée. Ces concepts peuvent être généraux ou spécifiques. Pour connaître, il faut donc apprendre, c’est-à-dire acquérir, se mettre en mémoire. Il faut aussi définir, c’est-à-dire préciser, expliquer la nature du concept. Une connaissance qui, bien entendu, conditionne la capacité d’utilisation du concept. L’écueil classique majeur est ici d’apprendre des concepts sans apprendre à les utiliser. En se cantonnant à un simple énoncé ou à une définition, dépourvus d’une réelle appropriation.
2- Il s’agit ici de reconnaître un concept utilisé lorsqu’il apparaît, sans qu’il apparaisse explicitement comme tel. Pouvoir identifier un concept lorsque l’on en rencontre un. Ici se pose très souvent le problème de l’abstraction : la crainte de l’abstraction, accompagnée de l’impossibilité de percevoir cette abstraction lorsqu’elle apparaît. Certains en font une posture : refus de voir l’abstraction. Le concept n’en est plus un : il est relégué à la simple articulation d’un cas particulier. Il est privé de son opérativité générale, privé de son universalité, il reste un cas de figure concret.
3- Il s’agit ici d’articuler un concept afin de résoudre un problème de pensée. Le terme utilisé peut être un terme courant dans son acception habituelle, un terme dévié de son sens, ou un néologisme. L’important est de reconnaître l’utilisation spécifique qui en est faite, car bien souvent le concept surgira de manière assez intuitive.
Dans l’enseignement traditionnel de la philosophie, l’apprentissage des concepts classiques reste le seul aspect du concept à être relativement systématisé. Au travers des cours du professeur et des textes étudiés, l’élève devra assimiler un certain nombre de concepts qu’il s’appropriera plus ou moins. Ainsi, dans l’exercice clé, celui de la dissertation, il devra de préférence montrer qu’il en a retenu un certain nombre, non pas simplement en les citant, mais en les utilisant d’une manière appropriée qui en démontre la compréhension et la maîtrise. Toutefois, in fine, il lui est surtout demandé d’élaborer sur un sujet donné une pensée construite à partir de ses propres idées, autrement dit de fournir un certain nombre de concepts qui lui appartiennent, auxquels il devra intégrer des éléments de cours, articulant ainsi un ensemble cohérent. Mais aucune pratique, aucun exercice, aucun cours, ne l’auront entraîné à une telle maîtrise de sa propre pensée. Il aura d’une part sa culture personnelle, d’autre part il aura vu et entendu l’enseignant accomplir de tels gestes, mais il ne se sera pratiquement jamais exercé en classe. Le seul moment où il mettra en œuvre cet art sera à l’occasion des quelques dissertations qu’il effectuera seul, en examen ou à la maison, bénéficiant pour tout conseil des quelques commentaires griffonnés sur sa copie par le correcteur. Autrement dit, seule la première partie de notre triptyque est véritablement un objet de cours. Et encore, uniquement sur le plan théorique, pas dans la pratique.
RECONNAITRE LE CONCEPT
La question cruciale la plus immédiate à traiter nous semble donc la deuxième partie évoquée : reconnaître le concept que l’on utilise intuitivement, en son statut d’opérateur de pensée. Penser une chaise après l’autre rend impossible toute démarche scientifique, car un tel fonctionnement est négation de toute universalité, ou au moins de toute généralisation. Or cette universalité ou cette généralisation, qui nous permet d’appréhender l’univers, est un produit de l’esprit : une construction, une intuition, etc. Cette chaise-ci, spécifique, je peux la toucher, la voir, m’asseoir dessus, etc. Les sens servent de point de départ, d’outil de vérification de ce qui est exprimé. À l’extrême, je n’ai même pas besoin du terme pour m’exprimer : je peux montrer du doigt. Le concept (ou idée) de chaise, lui, privé de tels éléments, repose sur un accord tacite : l’autre est censé savoir de quoi je parle, sans possibilité immédiate de montrer et de vérifier empiriquement. Premier type de problème : le cas limite s’applique-t-il ou pas ? Le tronc d’arbre sur lequel je m’assieds est-il une chaise ou pas ? Et une caisse en bois ? Cette situation nous oblige à reconnaître que la chaise n’est pas un objet particulier, elle n’est pas une évidence : elle est un produit de l’esprit, qui comme tout produit de l’esprit connaît ses limites. Nous oscillons ici entre reconnaître et créer : me confronter aux cas limites oblige à préciser le concept, à le sortir de son statut de pure intuition, à le conceptualiser. Exemple : la chaise se définit-elle par sa forme ou par sa fonction ? Selon le cas, si une chaise est définie par son utilité : s’asseoir, alors le tronc est une chaise. Si elle est définie par sa forme : elle exige des pieds et un dossier, et le tronc n’est pas une chaise. L’opérativité est ici soit une fonction, soit une forme, ou les deux ensemble : cette précision est ce qui pourrait distinguer une idée d’un concept. En émettant le principe que l’idée est plus générale, ou plus subjective que le concept. Bien que l’exigence de définition, inhérente et nécessaire à l’idée, nous rapproche énormément du concept. Proposons l’hypothèse suivante, afin de distinguer concept et idée. L’idée se rapporte plutôt à une entité générale, elle se réfère plutôt à un en soi, alors que le concept est plutôt une fonction, ou un rapport. Si l’idée se cantonne à l’intuition et à la définition, le concept s’intéresse plutôt à l’utilisation.
Avouons qu’en fin de compte cette distinction peut être très fragile. Elle permet toutefois de réfléchir au statut de l’objet de pensée. Pour éviter une théorisation outrancière, du concept ou d’autre chose, posons-nous la question : qu’est-ce que cela change ? Dans la présente réflexion, une première distinction nous paraît importante. S’agit-il d’abord de définir puis d’utiliser, ou est-il possible, voire préférable, d’utiliser puis de définir ? La première hypothèse est la plus courante dans les conseils donnés aux élèves pour les aider à disserter. Mais l’inverse constitue une pratique tout aussi valable. Le présupposé de la définition comme action première implique de connaître à l’avance les idées utilisées, puis de les composer entre elles, au risque de figer la pensée. Plutôt que de procéder par hypothèses générales successives et d’en définir ensuite les concepts ou idées utilisés. Dans le premier schéma, l’élève risque de proposer quelques concepts premiers, mais par la suite il ne cherchera plus nécessairement à analyser finement son travail en tentant de percevoir les concepts engendrés par le flux de la rédaction. Concepts aussi importants que les premiers, concepts qui risqueront aussi de modifier, voire de contredire les propositions initialement annoncées. C’est pour cette raison que nous proposons de travailler sur le principe de la “reconnaissance du concept”. Il ne s’agit pas ici de clamer la primauté d’une méthode, mais d’envisager différentes possibilités, avec leurs divers avantages, sur le plan philosophique et pédagogique. D’autant plus que certains élèves se sentiront plus à l’aise avec un cheminement qu’avec un autre, facilitant leur propre construction de pensée. Certains préfèreront partir d’un mouvement général, au risque du flou, d’autres de briques bien définies, au risque de la rigidité.
UTILISATION DU CONCEPT
Ainsi le concept doit être reconnaissable. Par sa définition, mais surtout par son utilisation. Il doit permettre par exemple de résoudre un problème, de répondre à une question. Il doit surtout pouvoir établir des liens ; c’est là sa principale opération. Le concept de verre lie tous les verres entre eux, en dépit de leurs nombreuses différences. Il doit aussi lier deux termes d’ordre différent entre eux. Ainsi le concept de verre relie le boire à l’eau, en tant que moyen par exemple. Cette idée de rapport correspond à un raisonnement tout à fait ordinaire. Mais une bonne part du travail de l’enseignement philosophique est de rendre l’élève conscient de l’ordinaire, le rendant spécial, lui donnant du sens au-delà de l’évidence. C’est ce qui caractérise le concept et la conceptualisation. Quel est le lien entre verre et eau ? Le verre contient l’eau. Au-delà de la réponse intuitive, il s’agit de réaliser que l’on a fait intervenir un nouveau concept : contenir. Entre les différents verres, il s’agit d’un autre rôle, d’un autre type de lien : la généralité, ou l’abstraction, la catégorisation qui regroupe les entités de qualités semblables, plutôt que l’opération de relation, causale ou autre. Peut-être avons-nous là une autre possibilité de distinction entre l’idée, plus proche de la catégorie, et le concept. Toutefois, il s’agit aussi d’une opération, mais plus qualitative que fonctionnelle. Cette deuxième opération représente un autre type de difficulté. Le “Qu’est-ce qui fait que deux choses sont semblables ou non ?” se distingue du “Quelle est l’action qui relie deux objets ou deux idées ?”
À partir de cela, un certain nombre d’exercices deviennent visibles. Qu’y a-t-il de commun entre… Quel rapport y a-t-il entre… Quels sont les concepts utilisés, qui donnent sens à telle ou telle phrase ? Nous apercevrons que créer du lien est difficile. La tendance naturelle est de faire que chaque idée reste dans son coin, dans son isolation intellectuelle, dans sa singularité empirique ou idéelle. L’expression commune et courante : “Cela n’a rien à voir !” en est une manifestation la plus évidente. Le “C’est autre chose”, qui renvoie la résolution du problème ou l’élaboration de la pensée aux calendes grecques. À l’inverse, symptôme cohérent avec le précédent, les idées seront reliées entre elles sans aucune considération de logique ou de substantialité, sans articuler précisément le lien, sans le mettre à l’épreuve. Sous la forme d’une liste d’épicerie, ou d’idées complètement isolées. La doxa philosophique tombe facilement dans le même travers, par un souci extrême de précision lié à la déformation de la définition, souci qui prend souvent le pas sur tout autre considération.
La difficulté est de concevoir que le concept n’est qu’un outil. Qui apparaîtra explicitement ou n’apparaîtra pas dans le produit fini. Et quoi qu’il en soit, pouvoir l’identifier et en clarifier le sens dans le but d’en expliquer l’utilisation. Si le concept apparaît dans une phrase, il s’agit simplement de reconnaître le mot clé autour duquel s’articule la proposition en question. D’en peser le sens et les conséquences. De voir la nouveauté qu’il amène et de se demander à quoi il répond. S’il affirme, s’il répond à quelque chose, il est nécessairement une forme ou une autre de négation. Demandons-nous alors ce qu’il nie, ce qu’il refuse, ce qu’il prétend rectifier. Pour cela il est intéressant d’utiliser le principe des contraires. Que se passerait-il si ce concept n’était pas là ? Quelle en est la négation ? Que refuse-t-il ? Il s’agit dès lors de soulever les enjeux liés à ce concept précis. Ce qui permet à la fois de mieux comprendre ce qui est dit, et de changer le concept si en le mettant à l’épreuve de son sens il paraît soudain inadéquat.
Le concept peut aussi ne pas apparaître dans la proposition. Il s’agit alors de l’exprimer pour qualifier cette dernière. Quitte à ajouter, si l’on en voit le besoin, l’articulation de ce concept dans une proposition complémentaire. Ou à se servir de son articulation pour formuler une nouvelle problématique. Pour formuler le concept non dit, le principe des contraires est également utile. À quoi répond cette proposition ? Quel est l’enjeu entre cette proposition et ce à quoi elle répond ? Comment s’opposent leurs qualifications respectives ? Invariablement, comme on opère ici au méta-niveau de la pensée, on devrait retrouver les grandes antinomies de la philosophie : singulier/universel, subjectif/objectif, fini/infini, noumène/phénomène, etc.
Une des difficultés courantes dans ce type d’exercice – due sans doute aux tendances relativistes et consensualistes de notre époque – est le refus permanent de saisir des oppositions. Dans un rapport entre deux propositions, on voit du “autre chose”, du “complémentaire”, de la “précision”, mais plus difficilement de l’opposition. Face à l’antinomie entre singulier et universel, qui servira à distinguer une proposition générale d’un cas concret et spécifique, beaucoup hésiteront à parler d’opposition et préfèreront employer les termes mentionnés. Ce qui ne serait pas un problème si ce n’était que les enjeux ne sont plus exprimés, les conséquences de la proposition gommées. Une voie moyenne par laquelle l’élève tentera d’échapper à l’opposition est le “plus et moins”. Ainsi il dira qu’une première proposition est concrète et la deuxième moins concrète. Mais il se refusera à réellement qualifier la seconde. Pourtant, le sens du concept “concret” qu’il utilise diffèrera selon qu’il utilise comme opposé “universel”, “abstrait” ou “général”. Il s’agit donc de refuser l’utilisation du “plus et moins” pour qualifier de manière plus spécifique. La table carrée n’est pas moins ronde que la table ronde : elle est carrée. Il s’agit ici de comprendre que l’utilisation des contraires, dans le choix de leur couple spécifique, permet de préciser la pensée et de la mettre à l’épreuve. Un tel exercice aide à sortir un concept donné de son statut d’évidence, en le mettant en relief grâce à son contraire. Prenons un exemple : une élève suggère de qualifier une proposition générale comme “universelle”, et après diverses hésitations, qualifie celle qui s’oppose, plus concrète, de “naturelle”. Questionnée, elle propose comme opposé de “naturel” : “artificiel”. L’universel est-il donc artificiel ? Elle refuse ces conséquences et remplace alors “naturel” par “particulier”. Elle aurait pu aussi assumer une nouvelle antinomie, comme “naturel et artificiel”, dans la mesure où elle aurait pu en rendre compte. Ainsi, grâce au principe des contraires, la connotation est articulée, permettant de clarifier le concept et d’avancer posément dans la réflexion, voire de poser de nouvelles problématiques. Dans cet exemple précis, l’élève formulera une proposition dite “universelle” et une “particulière”, établissant un lien entre les deux, ce qui permet aussi la possibilité d’une mise à l’épreuve de la proposition “universelle”. Tout cela de manière consciente et explicite, plutôt que vague, intuitive et implicite.
Un autre obstacle fréquent dans ce genre d’exercice est le refus de travailler dans l’intensif. L’extensif semble généralement plus confortable et moins anxiogène. Plutôt que d’analyser une proposition donnée, l’élève préfèrera ajouter des mots. Prétendument pour expliquer la première. Mais soit l’idée suivante est une autre idée et donc n’explique pas vraiment la première, soit elle répète en d’autres mots ce qui a déjà été affirmé. Parfois, presque par chance, l’idée est réellement expliquée, mais ce sera plus en abordant les conséquences de l’idée qu’en affrontant l’idée elle-même. La raison en est simple : les idées que nous formulons nous paraissent tellement évidentes qu’il ne semble pas nécessaire de s’appesantir sur leur statut, sur leur sens. Nous préférons “avancer”. Le surplace est trop pénible, nous préférons courir. Pourtant il permettrait de mieux problématiser notre propre pensée, mais un tel désir n’est pas toujours au rendez-vous. L’esprit trouve plus facile de rajouter des idées que de travailler sur le concept et la justification conceptuelle.
COURS OU MIRACLE ?
La pratique que nous venons de décrire se doit d’être un objet de cours, sans quoi il ne faut pas s’attendre à ce que l’élève se livre seul, miraculeusement, à une conceptualisation de sa propre pensée. Pour cela il faut être prêt à rendre compte de tels processus, et ne pas laisser croire que c’est le génie propre et irremplaçable de l’enseignant, ou accessoirement de l’élève, qui produit du concept. Il s’agit d’être prêt à identifier les ficelles et à en rendre compte. Peut-être certains élèves, et l’enseignant lui-même, ont naturellement accès à la conceptualisation, mais il serait absurde de croire que c’est le cas pour la majorité d’entre eux. Et même s’il y a intuition, il y a tout à gagner à conceptualiser la conceptualisation. Si Mozart n’a sans doute pas eu besoin de beaucoup de cours de solfège ou de composition, il n’en va pas ainsi du commun des mortels. Il serait donc présomptueux de penser que nos élèves et nous-même pouvons nous en dispenser. Et si le concept se limite aux concepts établis, dans la prétendue objectivité ou universalité fournie par le génie de leur auteur, ne nous étonnons pas que les élèves offrent pour toute dissertation un collage entre des citations plus ou moins comprises et des opinions toutes faites. Le cœur d’une réflexion, et le véritable critère de correction, reste quand même la conceptualisation et l’articulation d’une pensée singulière. Alors autant en enseigner la pratique, plutôt que de se contenter de visiter les musées
Dix principes de l’atelier philosophique
Dix principes de l’atelier philosophique
1- Jouer le jeu
N’oublions pas que les règles ont un contenu : elles orientent le fonctionnement de l’élève et sa pensée dans un sens plutôt que dans un autre, elles tentent de pallier une difficulté plutôt qu’une autre. Ainsi, si des élèves ont du mal à s’exprimer, par timidité, à cause d’un contexte de classe difficile ou par un quelconque handicap langagier, l’accent sera plus naturellement porté sur la simple opération d’articuler des idées que sur la capacité d’abstraction ou d’explication. L’affirmation sera privilégiée par rapport au questionnement, et de fait l’enseignant se réservera par défaut le rôle de l’interrogation. De même pour la conceptualisation ou la problématisation : l’enseignant sera, selon les situations, obligé de réaliser lui-même, au degré qu’il jugera bon, le travail de valorisation de la parole singulière. Parfois, il se verra obligé de travailler principalement sur le vocabulaire, ou sur l’agencement logique de la phrase, car les mots et les phrases utilisés souffriront de lacunes trop importantes dans leur utilisation ou dans leur compréhension. De temps à autre, la mise en place des principes élémentaires de comportement, tel que parler à son tour, constituera l’essentiel du travail, surtout en début d’année, avec les classes de maternelle ou de cycle 1. Mais comme il s’agit de prendre les enfants là où ils sont, comme ils sont, cela ne pose guère de problème en soi, à moins de vouloir trop rapidement accélérer la manœuvre, pour des raisons d’attendus personnels ou administratifs, attendus qui parasitent facilement le fonctionnement de l’atelier.
Cependant, n’oublions pas que ces règles de base, plutôt que d’être perçues comme une corvée et un pur formalisme disciplinaire, peuvent très bien être présentées comme un jeu et gagnent à l’être. Si au début ces exigences de forme rencontrent une certaine résistance, celle-ci s’atténue progressivement, proportionnellement à la capacité d’assimilation et de mise en pratique des obligations, selon l’aptitude à prendre plaisir de jouer avec ces contraintes. Pour la majorité des enfants, une telle contrainte ne présente jamais un gros problème en soi, quand bien même ces règles représentent un certain défi : plus que les adultes, ils sont animés par l’instinct du jeu, ils ne croient pas encore trop à ce qu’ils font, leur fonctionnement n’est pas encore trop surinvesti par un désir d’apparence et diverses craintes existentielles : ils savent encore faire confiance. Ce qui poserait toutefois un réel problème serait un ensemble de règles inappropriées, qui visant des compétences trop étrangères aux élèves concernés. Il s’agit donc de maintenir une tension permanente entre l’exigence et l’impossibilité : se placer un pas en avant, et non un pas trop loin. En ce sens, la fabrication et l’utilisation des règles de fonctionnement comme outil primordial d’enseignement sont déjà un art en soi, auquel l’enseignant ne sera pas nécessairement préparé, initié ou même disposé. Art qui ne se résume jamais à des recettes, mais résulte nécessairement de la continuité d’une pratique.
Pour faciliter cette appropriation des règles de fonctionnement, il est important d’insister sur leur dimension ludique et discutable. Elles sont ludiques dans le sens où elles ne constituent pas une sorte de vérité ou de bien absolu. Elles représentent uniquement un moyen de jouer. Elles sont discutables dans le sens où elles ont une raison d’être, et autant de raisons de ne pas être, c’est-à-dire d’être supprimées ou remplacées par d’autres règles, ce dont il est possible de débattre en toute sérénité. C’est dans cette perspective que l’on peut parler de connaître et de comprendre les règles. Car elles ne sont plus uniquement le produit d’un pouvoir régalien, celui d’un maître au pouvoir mystérieux, mais le produit de la raison, d’une raison ou d’un agencement contractuel et contestable. Dès lors elles peuvent faire l’objet d’une réflexion, plutôt que de solliciter uniquement l’adhésion ou de provoquer le refus. Qu’est-ce qu’un jeu ? Un exercice collectif (ou individuel) qui permet à chacun de se confronter aux autres et à soi-même, à travers une procédure quelconque mettant en œuvre des compétences particulières. La loi n’est alors plus une fin en soi, elle n’est plus la dura lex sed lex qui de sa dureté tire sa substance et son légitimité, mais un simple moyen d’exister, parce qu’elle offre à l’être une possibilité de faire et d’être. Une telle perspective invite à la générosité, plutôt qu’à l’âpreté punitive de la simple discipline.
Jouer le jeu renvoie à un autre enjeu : la construction du savoir. En effet, si le savoir n’est pas constitué a priori, d’où provient-il ? Comment émerge-t-il ? Jouer le jeu implique déjà que la connaissance est une pratique, un savoir-faire, et non un ensemble de connaissances théoriques établies a priori, qu’il s’agit de reproduire. Les connaissances résultent d’un savoir-faire, plutôt que d’être perçues comme le préalable de ce savoir-faire. On oublie trop vite que la connaissance naît de la pensée. Certes, toute mise en œuvre présuppose un certain savoir, ne serait-ce que celui d’un langage minimum dans l’exercice qui nous concerne, mais plutôt que de se soucier de faire acquérir formellement ces préalables aux élèves – ce qui peut au demeurant s’effectuer en d’autres moments -, lançons-les dans l’exercice. Ce pari de la dynamique permettra à tous, enseignants et élèves, en premier temps d’évaluer les compétences et faiblesses de chacun, et de déterminer ensuite ce qu’il convient de faire.
Car c’est d’un cheminement dont il est question ici. Les procédures requises invitent le groupe à convoquer ce qu’ils savent, à utiliser ce savoir, à en percevoir les limites, à identifier les besoins, et selon les cas, à résoudre les problèmes et obstacles qui se présentent en mobilisant de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Quand bien même le participant en resterait à la simple perception du problème, le travail est accompli, qui consiste à susciter un besoin pour la connaissance, à créer un appel d’air pour la pensée. Cet état d’esprit induira une motivation supplémentaire et procurera des éclairages porteurs pour l’enseignant, qui pourra, par la suite, expliquer quelque principe important en se fondant sur une expérience concrète. Cette genèse de la connaissance, une connaissance affirmant et démontrant de manière substantielle sa nécessité, devrait d’une part aider ces élèves qui vivent le travail en classe et l’apprentissage comme un immense pensum où l’on doit ingurgiter d’étranges choses, mais aussi aider ceux qui réussissent précisément parce qu’ils ont compris le système et savent reproduire ce qui leur est inculqué, au détriment parfois d’une pensée vive et authentique. Jouer, sans exclure la rigueur, car ce ne serait plus un jeu mais la récréation, c’est rendre opératoire et dynamique la pensée, c’est lui rendre son souffle.
Si dans l’idéalité de l’absolu, la fonction de maîtrise ne nécessite guère d’être incarnée par une personne particulière, le groupe pouvant se suffire à lui-même dès que la responsabilité est prise en charge par chacun, il n’en va pas de même avec la réalité du quotidien. En particulier si le groupe est large, et si le jeu présente quelques enjeux importants ou difficultés particulières. Toutefois, avouons-le, plus le rôle du maître pourra être minimisé, plus le jeu pourra être pensé comme un succès. Sans toutefois succomber pour des raisons pratiques – douce facilité – à la tentation d’un jeu minimal, bien que là encore, il soit possible de s’orienter vers d’autres options de fonctionnement, du moment que l’on clarifie la nature, les implications et les conséquences de ces options.
Tout banquet, comme tout navire, a besoin d’un capitaine, nous recommande Platon. Si la navigation, tâche complexe, s’effectue à plusieurs, il s’agit tout de même de nommer une personne qui de manière ultime, au gré des événements, prendra les décisions finales lui semblant justes, au risque de l’erreur et de l’injustice. Sachant qu’il ne s’agit pas là d’un pouvoir de droit divin, mais uniquement d’un accord tacite établi pour des raisons pratiques. Ce rôle pourra donc être imparti à diverses personnes, à tour de rôle. Rôle politique qui, à nouveau selon Platon, consiste à tisser la diversité en une œuvre unique. Et si l’enseignant, plus au fait de la pratique qu’il tente d’introduire, assume initialement cette fonction, il lui est recommandé de la déléguer périodiquement à des élèves, selon l’opportunité des circonstances. Les difficultés qui se poseront alors feront partie intégrante de l’exercice, les deux écueils de la pratique philosophique étant l’autoritarisme et la démagogie.
Quel est ici le rôle du maître, puisqu’il n’est plus celui qui est chargé de “ dire la vérité ” ? Tout d’abord il est un législateur : il établit la loi, l’énonce, en rappelle périodiquement les termes, voire en modifie les articles. Comme nous l’avons déjà exprimé, les règles sont soumises au débat, mais il s’agit de délimiter le lieu de ce débat, d’en spécifier le moment approprié, et de décider lorsqu’il doit s’interrompre, afin que l’exercice ne soit pas un permanent débat sur le débat, chausse-trappe dans lequel il est facile de tomber. Quitte à demander au groupe, en fin de jeu, ou au démarrage, si un quitus est accordé à la personne en question. Il est différentes manières de mettre en place un tel processus, mais ce qui nous paraît le plus efficace est d’accorder durant le jeu les pleins pouvoirs à celui qui est désigné, puis de réserver à la fin de la partie un espace de discussion afin d’effectuer le bilan du travail accompli.
Le maître du jeu est aussi un arbitre, fonction judiciaire, dans la mesure où il doit assurer que les règles en question, qu’elles soient les siennes propres où celles établies au préalable, sont respectées. Toutefois, il semble préférable de renvoyer au groupe toute décision, par le biais d’un vote à main levée par exemple. Son rôle d’arbitre consistera alors à soulever ce qui lui paraît un problème, à solliciter les avis de quelques personnes, puis à produire une décision, directe ou indirecte. L’arbitrage ne doit pas ici être conçu comme une activité annexe, mais comme faisant partie intrinsèque de l’exercice, puisque l’élaboration du jugement, la formulation d’arguments, se niche au cœur même de l’activité philosophique. Souvent, les questions les plus intéressantes au cours d’une discussion naîtront en ces débats d’arbitrage, souvent délicats, ce qui n’est pas étonnant puisqu’ils exigent de penser la forme, celle de la logique et des rapports de sens, autrement dit de réfléchir au niveau de la métadiscussion, et non pas à celui du simple échange d’opinion. Il s’agit donc de dépasser le niveau des accords ou désaccords de contenu qui renvoient principalement à la subjectivité, aussi argumentée soit-elle. Penser la conformité aux règles, c’est travailler l’exigence de la vérité, qui n’est jamais que la conformité à quelque chose, aussi arbitraire que soit cette chose : une autre idée, un principe, la logique, l’efficacité, etc.
Le maître du jeu a pour troisième casquette d’être un animateur, ou fonction exécutive. Bien souvent, le rôle de l’exécutif est perçu uniquement à travers son pouvoir discrétionnaire, comme une prérogative dont on abuse sans scrupule, ce qui avant tout autre sentiment installe la méfiance, au lieu de son contraire, la confiance, sans laquelle pourtant aucun groupe ne peut fonctionner de manière paisible et sereine. De surcroît, son autorité relève de l’arbitraire, puisque nul ne sollicite l’avis de tous, ou bien il compte si peu que l’apport personnel du commun est considéré quantité négligeable. Dans notre exercice, il s’agit d’établir un rapport de confiance mutuelle, entre l’animateur du moment, qu’il soit l’enseignant, un autre adulte ou un élève, et ceux qui participent au jeu. Car si le jeu ne peut s’effectuer sans lui, il ne peut présider la séance sans les autres, sans chacun d’entre les participants. Non pour des raisons uniquement formelles, mais parce que si le moindre participant se met en tête d’interrompre par un comportement intempestif le jeu, il le peut. Tout comme le moindre participant qui avance une idée porteuse, permet à tout le groupe d’avancer. N’oublions pas que ce n’est pas l’animateur qui fournit les idées, mais les participants, ce qui place celui-ci dans un rapport de dépendance, assez déstabilisant d’ailleurs pour certains enseignants, qui ont du mal à faire confiance à leurs élèves.
Ainsi le pouvoir ne doit plus être un mauvais mot, pas plus qu’il ne doit être incontestable. Il est un art et une responsabilité, une pratique à laquelle on s’exerce comme n’importe quelle autre. Cette pratique renvoie au fonctionnement de la cité, à la séparation des tâches. Elle apprend à faire confiance aux autres, tout comme à soi-même, et de ce fait revalorise l’individu à travers ce pacte entre pairs. Elle apprend aussi à accepter la dimension d’arbitraire de la vie en société, et de l’existence en général, non comme un facteur subi, induisant la passivité et le ressentiment, mais comme un des aspects constitutifs de l’établissement d’un groupe, qu’il s’agit de prendre avec distance, et de régler dans le temps dans la mesure où l’on reste conscient du problème général qu’il présente. Cette capacité d’accepter l’arbitraire nécessite une conscience en éveil, implique une distanciation avec soi-même, une capacité de minimisation de soi-même en faveur du groupe, et l’apprentissage du deuil quant à ses propres prétentions et désirs. Un tel fonctionnement comporte une indéniable prise de risque, surtout pour celui qui en temps habituel détient le pouvoir a priori, mais aussi pour ceux qui doivent l’exercer momentanément. L’alternance de la présidence et les moments réservés au débat sur le débat, où chacun évalue son propre fonctionnement et celui des autres, forgent la solidité du pacte, précisément parce qu’il est critiquable et révocable. À tout moment, certes, même s’il est généralement convenu de laisser le président de séance aller jusqu’au bout de son mandat, sauf difficulté majeure. L’exercice de la citoyenneté passe également par la protection de ce qui institue le jeu. Cela signifie, entre autres, garantir que puisse travailler en toute sérénité celui qui doit assurer le bon déroulement du jeu. Pour certains participants, chez qui la méfiance et la réactivité sont une manière d’être, une telle perspective implique un retournement psychologique et identitaire assez phénoménal, mais néanmoins soulageant.
La plupart des élèves connaissent la règle qui consiste à demander la parole en levant la main au préalable, mais il n’est pas sûr qu’ils la mettent en pratique et surtout qu’ils en saisissent le sens. En général, les deux conceptions les plus courantes, relativement inconscientes, sont d’une part celle qui octroie au maître ou à la maîtresse le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser la parole, d’autre part celle qui conçoit cet acte comme un rituel – plus ou moins obligatoire – qui accorde automatiquement la parole, comme le geste de politesse qui garantirait la satisfaction d’une demande ou légitimerait un geste, à l’instar de “ s’il vous plaît ” ou de “ pardon ”. Le premier cas de figure se trouve plus rarement à l’école primaire, il s’instaure plus tardivement, le second est respecté à des degrés très divers : on voit dans de nombreuses classes des élèves qui commencent à parler dès qu’ils lèvent la main.
À nouveau, nous souhaitons insister sur l’idée de la compréhension des règles, sur leur nature discutable, compréhension et discussion qui n’excluent ni la possibilité d’imposer ces règles, ni d’envisager leur aspect arbitraire. Le problème qui se pose ici est celui du “ Pourquoi parle-t-on ? ”. Est-ce parce que la parole se bouscule en nous et doit sortir coûte que coûte, autrement dit est-ce pour s’exprimer comme l’on exprime le jus d’un citron ? Certaines discussions peuvent jouer ce rôle, qui instaurent en classe le lieu d’une parole libre et sans contrainte. Mais s’il s’agit de philosopher, c’est-à-dire de “ penser la pensée ”, alors d’autres déterminations interviennent. À commencer, et ce n’est pas le moindre des critères, pas l’écoute. En effet, à quoi sert de parler dans le brouhaha, tandis que d’autres parlent ou que personne n’écoute ? Pour l’élève, l’idée est de parler lorsque l’on s’est assuré d’une écoute maximale afin de maximiser l’impact de ses paroles et garantir le meilleur retour possible. Mais en va-t-il autant du maître ? Quel exemple donne-t-il ? A-t-il, par lassitude, par découragement ou par surdité, pris l’habitude de parler dans le vide ou le chaos ? Ou bien considère-t-il normal – non peut-être par son discours mais par son comportement – que si sa parole d’autorité exige le silence, celle de l’élève peut tant bien que mal surgir dans le bruit ?
Présentons quelques enjeux de l’affaire. Premièrement, comme nous l’avons dit, lever la main avant de parler revient à s’assurer que l’écoute est active avant de prononcer quoi que ce soit, plutôt que de lâcher des mots par simple défoulement. Deuxièmement, il en va du statut de l’élève et du respect mutuel qui contribue activement à la définition de ce statut. Pas plus que l’on ne devrait couper la parole au maître, on ne devrait davantage interrompre un élève qui élabore sa pensée, quand bien même elle nous paraîtrait lente à émerger, incongrue ou incompréhensible : l’erreur ou l’incompréhension font partie intégrante du processus d’apprentissage, elles ne peuvent être un vecteur de dévalorisation de l’individu. D’autant plus que l’élève peut au cours de son intervention rectifier peu à peu son propos. Demander à un élève d’écouter son voisin, c’est lui garantir en retour qu’il sera lui aussi écouté. En n’oubliant pas de surcroît que si le maître peut encore suivre le fil de ses idées lorsqu’il est interrompu par un élève, ce dernier aura plus de mal à garder sa concentration. Cela est d’autant plus le cas pour l’élève timide ou brouillon. D’ailleurs, afin d’assurer une écoute plus grande ainsi que la manifestation de cette écoute, il est préférable de demander aux élèves de ne pas lever la main pendant qu’un camarade parle : cela équivaut à lui demander de s’activer ou se taire. De toute façon, on n’écoute pas mieux le bras levé dans les airs…
Troisièmement : habituer l’élève à articuler sa pensée propre, en percevoir les limites et prendre ainsi conscience de ses difficultés. Il est à ce propos une pratique courante de l’enseignant, au potentiel néfaste, qui consiste à régulièrement terminer lui-même les phrases de l’élève ou à reformuler ses propos de manière abusive. Certes il n’est pas toujours possible, selon le contexte, de prendre le temps de laisser chacun s’exprimer, à tel point que le réflexe naturel consiste à parler pour l’élève, à la place de l’élève, mais on percevra aisément les limites de ce type de comportement. Aussi est-il important de réserver certains moments de la vie de classe à cette “ perte de temps ”, moments que nous nommons discussion philosophique car nous accordons à l’élève le temps de penser sa propre pensée, défaillances, erreurs et incompréhensions comprises, puisqu’elles sont la réalité de sa pensée, réalité qu’il serait inopportun de gommer. D’autant plus que l’élève prend l’habitude de ce secours artificiel et non sollicité. Ce qui n’empêche nullement, comme nous le verrons plus tard, d’aider activement un élève en lui proposant des idées qu’il n’arrive pas à articuler, mais il sera préférable que d’autres élèves jouent ce rôle.
Quatrièmement, l’intérêt de ce rituel du lever de main porte sur la capacité de l’élève à se distancier de lui-même, à se décaler dans le temps, à ne pas être dans l’impulsion et l’automatisme. Bien souvent, l’élève qui lâche des mots dès qu’il les “ ressent ”, ne prend pas le temps de construire son discours, et souvent ne retient pas ce qu’il vient de dire : il suffira de lui demander de se répéter pour s’en apercevoir. Si ce n’est qu’il n’osera pas, par crainte, par honte ou par timidité, assumer à nouveau cette parole aux oreilles de tous. Qui n’a jamais fait en classe l’expérience de l’élève qui, dans le brouhaha de la classe lance des idées, idées qu’il n’osera pas répéter une fois que tous écoutent attentivement ce qu’il a à dire. Ce qui nous amène au cinquième point : la singularisation de la parole. Oser parler de manière singulière en tant qu’individu qui s’adresse à ses pairs, à l’ensemble de la cité, avec toute la dimension de la prise de risque que cela implique. Il y a là une pratique qui n’est pas naturelle chez chacun, et qui exige un certain travail, une certaine expérience que l’enseignant se doit de favoriser. Au travers des formes, il ne s’agit de rien de moins que d’apprendre à assumer une singularité explicite et articulée, assumer la prise de pouvoir temporaire qu’elle représente, en prenant le risque de l’écoute, du regard des autres et de l’image de nous-même qu’ils nous renvoient. C’est prendre le risque d’exister ouvertement et pleinement face au monde.
La forme la plus simple de la demande de parole est celle couramment utilisée de la main ou du doigt levé. Mais il existe d’autres techniques pour inviter l’élève à se distancier de sa propre parole, pour lui apprendre à surseoir et temporiser, à retarder son geste en attendant une occasion favorable, à façonner au mieux son idée avant de l’exprimer, à sortir de l’immédiat et se décentrer pour prendre en compte le groupe tout en se séparant de lui. On peut utiliser un bâton de parole, voire un micro, qui circule dans le groupe, et nul ne peut parler sans le détenir. Ou bien celui qui vient de parler invite quelqu’un d’autre à prendre la parole. L’important, comme nous l’avons dit, est de redonner du sens au geste, comme moyen d’établir un rapport à la collectivité, pour lui rendre sa valeur symbolique, et extraire la règle de sa gangue réduite de simple autorité, afin de lui faire jouer pleinement son rôle éducatif.
4- Rester sur une idée
Cette règle est sans doute sur le plan cognitif une des plus fondamentales, qui exige de porter en permanence le regard sur un sujet donné, de rester et de se concentrer sur une idée donnée, afin d’en discuter, de l’approfondir, de l’analyser, afin de l’illustrer et de la problématiser. Clef de tout exercice intellectuel, à la fois son fil d’Ariane et sa substance, le sujet, comme objet de réflexion, doit en permanence être présent à l’esprit de chacun. Ceci n’est pas toujours évident, dans la mesure où toute discussion, où toute réflexion, attirera notre regard sur des pistes annexes, vers des connexions associatives, digressions plus ou moins légitimes et utiles, voire sur des enjeux de métaréflexion qu’il s’agit d’évaluer sans pour autant abandonner le sujet premier. Tâche d’autant plus ardue que nos exercices de discussion se réalisent à voix multiples et croisées, multiplicité et croisement dont l’entrelacs provoque d’innombrables occasions de dériver et de se perdre en voies parallèles, chemins broussailleux et impasses sans retour. L’écoute des autres, quand bien même nous la recommandons ou l’imposons comme règle, nous offre la permanente tentation d’oublier le sujet à traiter, pour ne plus que réagir et rebondir aux diverses paroles que nous entendons. Pour caractériser le problème général posé ici à la pensée, reprenons l’idée de Platon, qui nous enjoint de saisir simultanément le tout et la partie, chacune de ces perspectives, prise isolément, pouvant piéger la pensée dans une partialité inadéquate. Suivre un sujet implique donc des actes et des fonctionnalités parfois contradictoires. Voyons-en quelques-unes, avant de voir par la suite dans quelle mesure cette diversité conflictuelle participe à la construction de la pensée.
Tout d’abord, il s’agit de pouvoir contempler une idée, avant de tenter d’établir son utilité, et surtout avant de se demander si l’on est d’accord ou pas avec elle. Cette dernière réaction en particulier, souvent assimilable à un simple réflexe, incarne l’obstacle premier à la compréhension de bien des paroles et bien des textes. La prise de position, ou réaction, précédant généralement en rapidité opératoire la compréhension, cette dernière se trouve souvent faussée par la première. Suivre un sujet, c’est donc en tout premier lieu, selon l’injonction cartésienne, suspendre son jugement, retenir son approbation ou son refus, maintenir à l’écart la subjectivité, afin d’accueillir l’idée avec un esprit relativement ouvert. Aussi s’agit-il d’inviter les participants à la discussion à éviter en un premier temps toute déclaration du type “ Je suis d’accord avec cette phrase ” ou “ Cette idée est fausse ” ou encore “ Cette idée ne me plaît pas ”. Car il s’agit avant tout de soupeser l’idée, de l’examiner, de la comprendre.
S’il s’agit d’une question, il est crucial de l’apprécier initialement en tant que question, sans la parasiter par l’automatisme d’une réponse. Gardons-nous de ce réflexe qui, comme tout autre réflexe de la pensée, relie deux concepts ou idées, les déplace ou les greffe l’un sur l’autre, voire les télescope, sans prendre le temps de les appréhender séparément et observer ce qu’ils contiennent en eux-mêmes. Répondre à une question, c’est la réduire à presque rien, c’est lui enlever son potentiel interrogatif, c’est en fixer l’acception en un aboutissement unique, plutôt que d’envisager l’ampleur du problème posé et envisager le potentiel interrogatif de cette question Puisqu’une question pose par définition un problème, puisqu’elle est un problème, pourquoi ne pas inviter le participant à contempler le problème, pour lui-même ? Moment esthétique, comme au musée, lorsqu’on se laisse interpeller par une œuvre, au lieu de se précipiter au pas de course sur la suivante, au lieu de regarder sa montre et se demander ce qu’il reste à voir pour terminer la visite.
Ce n’est pas qu’il soit interdit de répondre à la question, bien au contraire, et comme nous le verrons par la suite, pas plus qu’il n’est interdit d’objecter ou d’être d’accord avec une idée donnée, mais il nous paraît simplement utile de décomposer artificiellement le mouvement, afin d’en saisir les moments et de leur ôter leur caractère enchaînant, compulsif et systématique. Les compétences sont diverses, et puisqu’il s’agit d’un jeu, justifions cette exigence en expliquant que sa dynamique s’installe et se structure en des moments où les actions, les rôles et les fonctions diffèrent. La plupart des sports relèvent ainsi de stratégies diverses, et l’entraînement consiste pour partie à travailler séparément les dextérités, les subtilités et les techniques qui leur sont attachées.
Il nous est conseillé de prendre le temps, de contempler les idées, puisque les idées sont à la fois l’objet et la finalité de notre exercice. Rappelons qu’à une certaine époque, avant que s’instaure le règne de l’utilité et de la subjectivité, il était hautement recommandé, en Grèce antique par exemple, de contempler les idées, en particulier celles qui nous semblaient en valoir la peine, celles qui justement édifiaient l’architecture de la pensée elle-même, par exemple les grands transcendantaux, tels le vrai, le beau, et le bien. Le concept de transcendantal, comme Kant nous l’explique, renvoyant à ce qui conditionne et permet à la pensée de se constituer.
Mais la règle qui consiste à exiger de contempler les idées est difficile à mettre en place. Car si l’esprit des élèves est quelque peu rebelle à ce ralentissement du mouvement de l’esprit, qu’en est-il de l’enseignant ? Y arrive-t-il lui-même ? N’est-il pas habitué à vouloir faire avancer coûte que coûte la discussion ? Par souci d’efficacité. Par crainte d’ennuyer ou de brimer les élèves. Par incertitude quant à la valeur des idées en question. Parce qu’il attend des idées spécifiques qui seules l’intéressent. Par phobie du vide. Par simple impatience ou manière d’être. Poser la pensée, respirer, interrompre le processus qui se met en place, installer artificiellement des interstices dans la discussion, autant d’obstacles courants et compréhensibles qui retiennent l’enseignant. Pourtant, si l’on pense à tous ces enfants, et adultes, qui vivent dans la fébrilité du monde, dans le zapping permanent et le souci de gagner du temps, si ce n’est à l’école que l’on apprend à prendre le temps de penser, à rendre leur valeur aux idées en soi, quand et par quel heureux ou miraculeux hasard l’apprendra-t-on ?
De manière plus active, rester sur une idée, c’est l’expliquer, sans commentaires annexes, c’est la reformuler, c’est demander de la rappeler en l’énonçant. Ainsi, si un participant veut questionner une idée ou lui adresser une objection, demandons-lui d’abord de réitérer l’idée à laquelle il veut faire subir un sort. Si un participant veut répondre à une question, demandons-lui de redire la question à laquelle il prétend répondre. Surtout lorsqu’il a déjà répondu, et que l’on s’aperçoit au travers de sa réponse, que visiblement, il ne se souvient guère de ladite question. Si un auditeur croit avoir compris l’idée d’un camarade, demandons-lui de vérifier ce qu’il comprend auprès de l’auteur de l’idée, quitte à ce que celui-ci ne sache pas s’il s’est mal exprimé ou s’il n’a pas été écouté. Autrement dit, avant d’aller plus loin, vérifier si le point de départ et d’ancrage est clair et présent. Ces simples demandes constituent souvent, en elles-mêmes, un exercice en soi, qui amène chacun à prendre conscience des mauvaises habitudes que nous entretenons dans notre hygiène de pensée : nous voulons dire quelque chose, mais nous ignorons de quoi nous parlons, à quoi nous répondons.
N’oublions pas néanmoins que si le jeu consiste parfois à rester sur une idée pour prendre le temps de l’apprécier, il est aussi mouvement, puisqu’il invite le participant à traverser diverses étapes. Et c’est la capacité de suivre ces étapes, de répondre aux diverses exigences et de savoir changer de rôle, un rôle qui dès lors est mis à l’épreuve.
Nous avons déjà évoqué le concept de problème, mais il nous semble devoir le reprendre comme un principe en soi, constitutif de l’exercice philosophique. Aussi parce qu’il s’agit de réhabiliter le problème, et le considérer comme partie intégrante de l’enseignement, plutôt que comme un obstacle, regrettable entrave qu’il s’agirait d’éliminer coûte que coûte quand ce n’est pas de l’occulter. La difficulté repose sur la mauvaise presse que s’attire le problème lui-même : le problème en tant que problème. “ Il n’y a pas de problèmes ” dit l’enseignant par ses paroles, par ses actions, par ses silences. Il a sa conscience pour lui. Pour l’élève, il y en a un. Parfois le pire des problèmes : lorsque l’élève ne comprend pas et ne sait pas même exprimer la nature du problème. S’il le savait, le problème commencerait déjà à disparaître. Pour l’instant, il ne fait que ressentir une douleur et dire “ je n’aime pas cette matière ”, quand ce n’est pas “ je n’aime pas ce professeur ”. Réflexe on ne peut plus approprié, défense de l’intégrité territoriale de l’être : l’autre nous inflige une douleur, il est normal qu’il soit perçu comme un ennemi. Moins l’élève est capable d’exprimer le problème, plus grande est la douleur, plus sera vive la réaction, que ce soit par la confrontation ou par l’absence.
Face à cela, à quoi sert-il de parler ? Parler sert avant tout à problématiser. Problématiser ne revient pas uniquement à inventer un problème, c’est aussi articuler un problème bien présent, articulation qui ne permet pas nécessairement de résoudre le problème, mais au moins de l’identifier et de le traiter. Un problème n’a pas à être nécessairement résolu, bien qu’il puisse l’être. Un problème a surtout à être aperçu, à être vu, à être manipulé, à devenir substantiel. En tant que pratique, la peinture sera toujours un problème pour le peintre, comme les mathématiques pour un mathématicien, comme la philosophie pour un philosophe. L’illusion la plus catastrophique est celle qui laisse croire qu’il n’en est rien, celle laissant croire que l’enseignant est un magicien, au sens traditionnel du terme, qu’il a des pouvoirs particuliers, plutôt que de montrer qu’il est un illusionniste, quelqu’un sachant simplement tirer les ficelles car il voit comment celles-ci qui s’entrelacent et s’organisent.
Mais pour ce faire, il s’agit avant tout de réhabiliter le concept de problème. “ Il n’y a pas de problème ! ”, “ Je n’ai pas de problème ! ”, la fierté ou le souci de la tranquillité nous obligent à renier l’idée même de problème. Le problème est ce qui nous empêche d’agir, il est un obstacle, un frein, un ralentisseur de vitesse. Et si justement en cet effet apparemment pervers se trouvaient sa substance et son intérêt ! Car ne sommes-nous pas toujours tentés de réduire une matière et son apprentissage à un ensemble de données, à quelques opérations diverses, autant d’éléments pédagogiques quantifiables, vérifiables et notables ? Néanmoins, qu’en est-il de l’esprit, entre autres celui de la matière enseignée ? Certes l’esprit filtre à travers les diverses activités proposées, mais pourquoi faudrait-il l’abandonner à son triste sort, celui de facteur aléatoire, accidentel et secondaire, qui n’est guère une préoccupation en soi ? D’autant plus que cette connaissance intuitive n’est pas donnée à tous les élèves. Si certains sont préparés à la recevoir pour des raisons et des circonstances qui ne sont guère du ressort de l’enseignant, les autres, ceux qui buttent sur l’étrangeté de la démarche, entrent justement dans son champ d’action. Pour cela faut-il encore que la matière soit pour l’enseignant un problème, qu’elle ne soit pas rangée soigneusement au rayon des articles ménagers. Rangement que l’élève en difficulté viendrait déranger.
Les difficultés de l’élève servent un but bien précis : repenser la matière enseignée, sa nature, son efficacité, sa vérité et son intérêt. Si tout cela va de soi, les difficultés deviennent une simple entrave dont il faut se débarrasser au plus vite afin d’avancer. Le programme devient alors l’alibi par excellence, le refuge de la crainte et de l’insécurité. Nous avons toutes ces choses à apprendre, qu’avons-nous le temps d’étudier l’esprit ? Nous avons à nous concentrer sur la matière. Nous oublions un peu vite la leçon des Anciens, et nous nous retrouvons avec une matière sans âme, réduite à des apprentissages et des performances. Utiles certes, mais tellement réducteurs.
Aussi s’agit-il, en tout premier lieu de pouvoir dire : “ J’ai un problème ”, “ Cette tâche spécifique me pose problème ”, ce qui peut aussi s’articuler sous la forme de “ Je ne sais pas ”, “ Je ne peux pas répondre ”, ou simplement “ Je ne comprends pas ”. Ces mots, qui par leur absence relative de contenu ou de réponse peuvent paraître ne rien signifier et ne rien apporter à la discussion, ce simple aveu d’une difficulté, qui peut le laisser assimiler à un échappatoire ou à un rituel de politesse, sont au contraire lourds de conséquence. Déjà, ces mots posent de manière ouverte l’existence du problème, ce qui ouvre la porte à la suite des événements. En lui reconnaissant ce statut productif, on extrait le problème de sa gangue de culpabilité et de mauvaise conscience, qui en général interdit de parole celui qui souffre de l’opacité d’une connaissance ou d’une pratique. Ce dernier devient au contraire agent de réflexion. Car le problème de l’un devient le problème de tous, en premier lieu pour une bonne raison : il est évoqué. Ensuite, parce qu’il se peut fort bien que ce problème soit aussi celui d’autres personnes, qui, elles, n’ont pas su ou pas pu l’avouer ou le reconnaître. Mais il est aussi le problème de ceux qui pensent ne pas avoir de difficulté avec le problème en question, qui vont devoir vérifier publiquement leur capacité de le traiter. Car une fois que le problème de l’un devient le problème de tous, chacun est invité à s’en occuper par une phrase apparemment anodine prononcée par l’auteur du problème : “ Je ne comprends pas et je demande de l’aide ”. De là, ceux qui pensent être capables de traiter le problème s’en expliqueront, à tour de rôle ou par une quelconque procédure de sélection. Jusqu’à ce que celui qui avait exprimé une difficulté s’en satisfasse, ou en concluant après quelques essais infructueux à une impossibilité temporaire de résolution.
Certes ce processus est lent, qui oblige à piétiner sur un aspect spécifique et réduit du cheminement, peut-être même un aspect annexe, mais il n’est pas question de faire “ comme si ”, de passer outre comme si de rien n’était. Et si on laisse le moindrement filtrer ou s’exprimer l’impression que le problème à traiter empêche la procédure “ d’avancer ”, autrement dit laisser entendre qu’il y a mieux à faire, alors tout le travail de réhabilitation du problème et de l’aveu d’ignorance sera réduit à néant. Ce qui ne signifie pas qu’il faille non plus s’embourber pendant toute une séance dans une seule et unique difficulté ; une procédure “ garde-fou ”, telle celle qui propose de limiter toute tentative de résolution d’un problème à trois essais consécutifs, permet de s’extraire d’une affaire épineuse sans l’avoir pour autant ignorée.
Ainsi il n’y aurait pas les problèmes dignes de ce nom, bien intellectualisés, baptisés du pompeux nom de problématique, et les autres, les “ bêtes ” problèmes, ceux qui émanent du manque, de l’ignorance et de l’incompréhension. Une telle distinction encouragerait la négation de la dimension réelle, profonde et existentielle du problème, inavouable, pour ne plus exprimer que les problèmes qui résulteraient des élucubrations des esprits subtils. L’enseignant lui-même n’oserait plus avoir de problèmes, même inavoués, et pourquoi se lancerait-il alors dans des procédures risquées, dont il ne peut prévoir ni les embûches, ni l’aboutissement de l’exercice ? Un exercice comme celui de la réflexion en commun, pris dans toute sa rigueur, impose à chacun une certaine humilité minimale, et en tout cas une capacité d’admettre ouvertement la difficulté et l’erreur, un refus de la toute-puissance, et une acceptation de la dépendance sur autrui.
Comme nous l’avons en partie expliqué, l’atelier démarre d’emblée par une prise de risque, de la part de l’élève et de la part de l’animateur, prise de risque du choix et du jugement, qui se prolonge tout au long de l’exercice. En réfléchissant sur ses choix, en les articulant, tout en sachant qu’il devra les argumenter, voire les justifier, afin d’en approfondir la teneur et d’en vérifier le contenu, l’élève prend un risque qu’il ne faut pas sous-estimer. Périodiquement, certains n’y arriveront d’ailleurs pas. Risque d’exprimer ce qu’il pense, risque de parler devant les camarades, risque de parler devant l’enseignant, risque de ne pas pouvoir justifier ses choix, crainte de “mal faire”, etc. Pour l’enseignant, la prise de risque est d’entendre des choix et des arguments qui pourront lui sembler aberrants, inquiétants, voire faux. Sans pour autant manifester sa désapprobation ou son inquiétude. Tout en continuant la procédure de questionnement, à cet élève ou à un autre. Certains enseignants avouent en outre leur impatience face à ce genre de situation, révélatrice d’une certaine inquiétude.
En général, l’atelier commence par une question. Une question ouverte, et non fermée, car elle ne fait pas appel à des connaissances spécifiques qui autoriseraient une autorité quelconque à valider ou invalider la réponse comme étant bonne ou mauvaise, vraie ou fausse. Car il s’agit de produire une pensée, et non de fournir la bonne ou la vraie réponse. Exigence qui peut surprendre l’élève, peu habitué à ce type de demande. Car si l’exigence de vérité n’est pas au rendez-vous, il en est d’autres qui ne sont pas moins exigeantes. La réponse répond-elle à la question ? L’esquive-t-elle ? Répond-elle à une autre question ? La réponse est-elle claire ? Est-elle un minimum justifiée par un argument ? Déjà, il s’agit nécessairement de produire des phrases, plutôt que de manifester un simple assentiment ou articuler un mot isolé. Il s’agit de construire la pensée, et non de vérifier l’apprentissage d’une leçon.
L’incertitude face à l’absence de validation immédiate et assurée gênera d’ailleurs souvent les élèves les plus “ scolaires ”. Ils auront l’impression d’être livrés au néant. Ils demanderont et redemanderont ce qu’il faut faire, incrédules, ayant du mal à croire qu’on réclame d’eux uniquement de penser, sans attendus de réponses spécifiques, validées d’avance. Lorsqu’il s’agit d’une discussion avec l’ensemble de la classe, ces élèves appliqués et studieux se sentiront abandonnés par le maître, trahison les privant d’une présence sécurisante, de la garantie habituelle et réconfortante d’un jugement certifié conforme. Même les “ cancres ” seront inquiétés par ce type de procédure, qui les soustrait eux aussi à la spécificité de leur statut, volontaire ou non, dans lequel ils se sont installés. Car c’est au jugement de l’ensemble de la classe que doit se mesurer chaque élève, un jugement mouvant et inattendu, imprévisible et déstabilisant, auquel il est demandé de se confronter. Confrontation autrement plus périlleuse que celle de la quasi-incontestable autorité du maître, même si la parole revêt une apparence plus libre et spontanée. Ainsi, ce qui pouvait paraître apparemment trop facile s’avère au contraire ardu, très ardu pour certains.
Toutefois, comme nous l’avons déjà dit, afin de dédramatiser la prise de risque auprès des élèves, l’exercice est souvent présenté comme un jeu, comparable à un autre, et l’aspect ludique doit être périodiquement rappelé, en alternance avec des moments plus sérieux. Pour les enfants qui ont du mal à exprimer leur opinion, il s’agit d’être patient, de recourir à eux de temps à autre afin qu’ils ne se sentent pas exclus, quand bien même ils ne réussissent pas à verbaliser aisément, ou même très peu, et à rassurer les timides en leur proposant de parler plus tard s’ils se sentent coincés. L’enseignant devrait ainsi veiller à ce que tous puissent s’exprimer un minimum, en s’assurant que les plus loquaces n’écrasent pas les autres, danger récurrent de toute discussion. D’autant plus que ceux qui produisent de l’oral de manière plus laborieuse ne sont pas nécessairement les moins intéressants et les moins profonds.
Répondre à des questions de connaissance présuppose un apprentissage spécifique : une leçon apprise, des éléments d’information retenus. Articuler une pensée implique la totalité de l’être. C’est en ce sens que le discours ne renvoie plus à de simples enjeux de savoir théorique et formel, mais à un savoir-faire, voire à un savoir être. Car c’est la pensée tout entière qui est convoquée lorsqu’il s’agit de faire un choix. De là l’intérêt de se risquer à l’articulation d’un choix, conçu comme acte inaugural de la pensée. Reste ensuite à justifier la proposition initiale en mobilisant les connaissances acquises, en élaborant les arguments et les raisonnements possibles, en tentant de répondre en un second temps aux questions et aux objections. Quitte à revenir sur son jugement initial, décision on ne peut plus fondamentale, car elle manifeste une certaine liberté de pensée et un rapport honnête et courageux aux autres, ainsi qu’à ce que l’on peut nommer une quête ou un souci de vérité.
Dernier point important au sujet du jugement : il correspond à une réalité existentielle dans la mesure où les connaissances sont généralement ce qui nous permet d’effectuer des choix, jour après jour. Une telle pratique permet donc de rendre sa réalité usuelle à l’enseignement, puisqu’il ne renvoie plus uniquement à la classe, aux bonnes et mauvaises notes et à la succession prévisible des années, mais à ce qui constitue le rapport entre un sujet et le monde qui l’entoure, le monde qu’il habite. Il s’agit donc de travailler au corps la tendance schizophrénique de la double vie, du double langage, entre l’école et la rue, entre les livres et la maison, entre la classe et la cour de récréation, hiatus qui affaiblit énormément – quand il ne mine pas carrément – le travail de l’enseignant et le processus d’éducation auquel est censé participer l’enfant. Ainsi, au cours de l’exercice philosophique, l’élève sera amené à effectuer des choix pour répondre aux questions, à analyser ses propres choix et ceux de ses camarades, à justifier ces choix, à déterminer le degré de validité des arguments invoqués, et même à poser des jugements sur les comportements qui président aux discours, aux réactions et aux réponses de chacun. Autant de décisions cruciales, qui se doivent d’être lentement construites et examinées, car non seulement elles ne sont pas annexes au fonctionnement quotidien, mais elles en forment la substance et le creuset. Et s’il s’agit de réfléchir, discuter et travailler plus directement la matière spécifiquement scolaire, l’appropriation de cette matière en sera facilitée, puisque l’élève sera invité à la mettre en œuvre, à la rendre opératoire, à prendre position par rapport à elle, pratique qui interdit une sorte d’extériorité formelle au travail de classe. Nul ne peut dès lors se cantonner à une position extérieure, puisque la règle du jeu pose comme préalable de se situer par rapport à la matière étudiée. La vie est rendue à la matière, la matière est rendue à la vie.
S’il est un principe fondamental qu’il s’agit d’inculquer dans notre affaire, c’est le réflexe du questionnement, questionner l’autre et questionner soi-même, questionner tout ce qui est énoncé. Or il est un accès privilégié au questionnement : le « pourquoi ? », élément dynamique et déclencheur, fondateur de la pensée et du discours, qui procurera à la pensée et au discours sa substance, en lui demandant de s’étayer et de s’approfondir. Le « pourquoi ? », auquel fait écho un « parce que », répond à divers types de demande : « Qu’est-ce qui nous fait dire cela ? », « De quel droit dit-on cela ? », « Comment expliquer qu’il en soit ainsi ? », « Dans quel but dit-on cela ? », « Que signifie ce que l’on dit ? », « Qu’implique ce que l’on dit ? ». Sont questionnés à la fois le sens des paroles, la raison d’être de leur objet, la légitimité de leur auteur. Ce processus multiforme déclenché par un puissant adverbe interrogatif, invite à extraire le discours de sa plate et immédiate évidence, afin d’en démêler les arcanes, d’en éclairer la genèse, d’en entrevoir les implications et les conséquences. « Mot magique » dirons-nous avec les plus jeunes, afin de leur laisser entrevoir la force et les innombrables possibilités du questionnement contenu au sein du « pourquoi ? ». S’il est un terme qui permet de montrer le pouvoir des mots, c’est celui-là, qui, lancé à un interlocuteur, le laisse souvent embarrassé, alors que l’auteur du discours doit simplement rendre compte un minimum de ses propres paroles.
Les élèves saisissent bien la portée du « pourquoi ? », car une fois initiés à ce terme, lorsqu’ils doivent poser une question, ils s’empressent de l’utiliser à répétition, si ce n’est à tort et à travers, comme solution de facilité : « Pourquoi as-tu dit ça ? ». Car si « Combien ? », « Quand ? », « Comment ? », « Où ? », « Qui ? », « Quel ? », « Que ? » ou « Est-ce que ? » requièrent pour leur utilisation la compréhension de circonstances spécifiques et l’élaboration d’une phrase appropriée, le « Pourquoi ? » peut toujours être casé de manière simple, sans gros effort de l’imagination. À tel point qu’il sera parfois utile d’en suspendre momentanément l’utilisation, dans le cas d’une systématisation abusive qui semble gêner la progression du travail. Car si la question est facile à poser, il est d’autant plus difficile d’y répondre ; or celui qui questionne se doit aussi de réaliser un véritable travail, permettant de faire émerger de nouvelles idées, en posant des problèmes spécifiques à l’interlocuteur, et non en trouvant un « truc » qui peut être casé à tout propos.
Le questionnement impose donc à l’élève de justifier ses propos, de fournir des arguments, des preuves, des raisonnements, autant de nouvelles propositions qui en principe devraient à la fois soutenir la proposition ou les propositions initiales, et en approfondir la teneur. Dans cette perspective, sont tenus en échec un certain nombre de type d’arguments classiques qui, s’ils ne sont pas prononcés ouvertement, font pourtant office de loi, surtout en classe : l’argument d’autorité par exemple. Car dans l’exercice philosophique, il n’est plus question de se référer au maître, aux parents ou à un livre quelconque pour établir la valeur d’une idée. Non pas que ces sources « premières » de la connaissance soient invalidées d’office, loin de là – il serait d’ailleurs difficile et vain de prétendre s’en abstraire -, mais elles trouveront leur place uniquement dans le cadre d’une construction intellectuelle, c’est-à-dire en un agencement de propositions établies par l’élève. En ce sens, il devient l’auteur de son propre discours, même si l’empreinte d’une quelconque influence peut se faire sentir de manière appuyée.
Le processus dans lequel est engagé chaque participant à travers ce questionnement est nommé, chez Platon, principe anagogique. Il s’agit de retracer en amont l’origine d’une pensée particulière, afin d’en vérifier la teneur, car c’est en cette origine que se retrouve le véritable sens d’une idée, et non en son apparente évidence. De plus, le processus de remontée dans l’être de l’idée rend à la pensée sa vigueur, ce qui permet de passer du stade de l’opinion à celui de l’idée. En effet, la distinction entre l’opinion et l’idée se résume au travail qui l’engendre et l’entoure. Une même proposition peut donc être considérée opinion ou idée selon le mode de lecture ou d’analyse utilisé, selon le degré d’intensité de l’interprétation. Enfin, cette enquête sur la causalité d’une idée fournit aussi dans le temps un certain nombre d’idées annexes, corrélats de l’idée initiale, qui éclairent cette dernière. Certaines contradictions ou incohérences émergent, qui s’offrent à l’étude et à la critique. Cette confrontation entre les différentes idées devient ainsi l’occasion, à travers un effort de cohérence que l’on peut assimiler à un souci de vérité, d’identifier et de retravailler divers postulats jusque-là restés inconscients dans l’esprit de leur auteur. Confronté à une multiplicité de propositions, l’intellect se doit d’en découvrir l’unité fondatrice et causale.
Ainsi, le travail qui consistait en premier temps à fournir des arguments pour répondre à des questions quant à la justification d’un propos initial, se transforme rapidement en un travail d’approfondissement. L’argumentation pouvant pratiquement se réduire à un simple prétexte, celui d’une exploration ou d’un examen plus fouillé. Ce qui nous autorise à évaluer la légitimité d’une idée non par quelque canon établi a priori, ou par appartenance à un texte officiel, mais grâce au rapport qu’une idée spécifique entretient avec son environnement intellectuel. Mais pour réaliser un tel projet, il est nécessaire d’apprendre à poser des questions, exercice qui constitue un art en soi. Car si certaines questions, percutantes, facilitent le travail et donnent lieu à un approfondissement, d’autres au contraire trouvent porte close ou n’invitent nullement à la production de concepts.
Le travail du questionnement oscille entre deux écueils. D’une part la question qui ressemble à un cours, difficile à comprendre, avec un long préambule qui souvent contient déjà les réponses attendues : celles qui laissent l’interlocuteur sur le carreau, soit par incompréhension, soit parce qu’il sent bien que l’on n’attend de lui rien d’autre qu’un acquiescement. D’autre part la question vague qui ne demande rien de spécifique : le « Dis-m’en plus » peu inspirant qui n’invite à rien. Sur cet aspect du travail, davantage encore que sur d’autres aspects, l’enseignant apprendra des élèves, c’est-à-dire de la multiplicité, car il est difficile de prévoir quel genre de question opèrera plus qu’une autre dans un cas particulier : c’est uniquement grâce à l’expérience, « sur le tas », que cette pratique s’améliorera. Car s’il est plus facilement possible pour l’enseignant d’entrevoir un point aveugle ou une contradiction dans une parole donnée, ce n’est pas pour autant qu’il trouvera les mots qui feront mouche chez l’interlocuteur, lui faisant prendre conscience du problème interne que couve son discours. C’est pourquoi toute la classe est invitée à se pencher sur les propositions d’un « auteur », car chacun doit réaliser que ce n’est pas tant de donner « sa » réponse qui représente le véritable travail, que de forger les questions appropriées. D’autant plus qu’une vraie question exige de ne pas mettre de l’avant ses propres idées, ce qui implique un redoublement du travail : prendre conscience des idées que l’on véhicule, et réussir à taire ses propres concepts et convictions, les mettre de côté pour s’adresser à quelqu’un afin de savoir ce qu’il pense, sans chercher à lui communiquer la « bonne pensée » ou à induire un contenu. Critique interne, nous dit Hegel, qui interroge de l’intérieur une thèse, à distinguer de la critique externe, qui consiste à avancer arguments et concepts servant à objecter. Questionner, c’est faire accoucher, ce qui signifie que les idées doivent émerger chez celui qui est interrogé, et non être fournies clé en main par le questionneur. Questionner, c’est créer un interstice de respiration et non boucher un trou
La singularité du discours présuppose une sorte d’originalité de ce discours, originalité qui en constituerait la spécificité. Pourtant, on pourrait difficilement affirmer que tout ce que l’on entend dans une discussion de classe possède une telle caractéristique d’originalité. Aussi sans exclure le côté parfois inattendu de certaines réponses, pour le moins surprenantes, proposons l’hypothèse que la forme première de la singularité est plutôt celle de l’engagement. S’engager sur une idée, prendre des options sur une idée, c’est la rendre singulière, ou personnelle, par un phénomène d’appropriation. Ainsi, régulièrement, au cours de l’exercice, l’élève devra prendre parti, que ce soit par la production d’une idée ou par son rapport aux idées des autres. Pas uniquement sur le fait d’être d’accord ou non, mais aussi sur la nature même du discours proposé, sa cohérence, sa logique ou sa justesse, le sien ou celui d’un autre. Parti pris qui, comme on l’a vu, devra dans la mesure du possible pouvoir être expliqué, argumenté, justifié, etc.
L’idée de déterminer sa position par rapport à une question donnée, quel qu’en soit le degré d’abstraction, implique un acte de réflexion, une prise de conscience, qui demande aux élèves un effort, à certains plus qu’à d’autres. Car il devient nécessaire de se poser consciemment la question du choix personnel, ce qui dans les petites classes n’est pas nécessairement un acquis. Pour que cet acte s’effectue, il s’agit tout d’abord ne pas tomber dans un premier piège : le réflexe de la répétition, très courant en ces âges. Dire comme les autres, fussent-ils les élèves ou le maître, c’est la tentation et la solution de facilité, le réflexe fusionnel si commun chez les enfants. Fusion avec le groupe, parce que cela fait moins peur, parce qu’on se sent moins seul ou parce qu’il faut faire comme les autres. Fusion avec le maître, parce qu’il est un adulte, parce qu’il est celui qui sait, parce qu’il doit avoir raison.
Pour cette raison, au cours de notre exercice, il est crucial que l’enseignant ne manifeste ni accord ni désaccord, tout au moins sur le contenu, et même sur la forme, ce qui ne l’empêchera nullement de revenir en d’autres moments sur un problème soulevé qu’il lui semble devoir traiter lui-même. Quant au rapport entre camarades, afin d’assurer qu’il n’y ait pas de répétition mécanique, une des règles du jeu consiste à interdire de redire ce qui a déjà été dit par quelqu’un d’autre, ou par soi-même, au risque d’un symbolique “mauvais point” ou d’une élimination momentanée. On observera parfois certains élèves qui tentent d’articuler différentes formulations d’une même réponse afin de reprendre l’idée et ne pas pour autant être sanctionnés par la règle du jeu, ce qui en soi est un mécanisme intéressant. Car il s’agira pour tous de se demander si cette « nouvelle » réponse est identique ou non à la précédente, ou si elle a produit une quelconque nouveauté conceptuelle. L’animateur pourra à tout moment demander à la classe : “Est-ce que quelqu’un a déjà dit cela ?”. Et pour que la proposition puisse être refusée, il faudra pour commencer qu’au moins un élève reconnaisse qu’il s’agit d’une réponse identique à celle de quelqu’un d’autre : il devra expliquer en quoi ces réponses sont semblables et de préférence nommer l’auteur de la réponse initiale. En cas de doute ou de dissension, l’animateur pourra proposer une discussion et provoquer un vote sur la question, vote au cours duquel chacun devra trancher le litige.
Ne pas répéter. Assurer qu’une réponse répond à la question. Déterminer si la question est une question, si elle porte bien sur l’objet qu’elle est censée questionner. Déceler les incohérences d’une proposition. Diverses règles parmi d’autres, autant d’exigences diverses qui invitent chacun à arbitrer la discussion en usant de son jugement. Un tel fonctionnement présente l’avantage suivant : il oblige déjà chacun à écouter et à se rappeler ce que disent les autres, puisque à tout moment l’élève peut être sollicité afin d’évaluer la légitimité de ce qui a été dit. Toute analyse, toute lecture particulière et personnelle des idées évoquées pourra infléchir la discussion dans un sens ou dans un autre, puisque les discours s’élaborent en réciprocité et ne sont pas imperméables les uns des autres : ils se valident ou s’invalident mutuellement, ils s’approfondissent ou se problématisent entre eux. Ce qui nous conduit à un autre aspect de la singularisation : le principe de responsabilité, sous-jacent à l’exercice.
Certes, toute discussion implique un certain sens de responsabilité, ne serait-ce que par rapport aux idées que l’on émet soi-même. Mais dans la mesure où nous interdisons de sauter du coq à l’âne, où nous empêchons de passer d’une idée à une autre au gré des inspirations individuelles sans établir de lien, du fait que le groupe entier reste sur une idée donnée avant de passer à une autre, afin de la travailler, chacun devient implicitement responsable des idées des autres. Que ce soit en la questionnant, afin de lui faire dire ce qu’elle n’a pas encore dit, en posant sur elle des jugements de forme, ou en provoquant des problèmes de fond, on prend une lourde responsabilité, vis-à-vis de l’auteur de l’idée et de la classe tout entière. Le fait de se décentrer, afin de s’occuper en priorité des idées du voisin, offre de manière paradoxale un degré accru de singularisation, au travers de la prise de responsabilité. Se distancier de soi-même signifie en effet devenir responsable, puisque l’on est plus que jamais à l’écoute des autres, puisque l’on répond aux autres.
Autre aspect crucial du caractère singulier de l’idée : la justification ou l’explication. Car si une idée donnée peut avoir un sens commun et obvie, voire une signification apparemment objective, elle peut aussi trouver dans l’esprit et les mots de son auteur ou de son interprète un contenu très particulier. Aussi incongru soit ce contenu, il ne sera pas question de l’écarter d’un simple revers de main. D’autant plus que certaines propositions apparemment absurdes, ou dotées de tournures étranges, prendront réellement corps de manière inopinée après quelque explication ou modification. Des mots spécifiques connaîtront aussi une telle dérive, utilisés en des acceptions étranges, quand ils ne s’installeront pas, à l’occasion, carrément dans le contresens par rapport à leur définition classique. Dans ces divers cas de figure, que ce soit paralogisme, incompréhension ou inadéquation, le rôle de l’enseignant ne sera pas de « rectifier » des propos qui ne lui appartiennent pas, mais de faire confiance à l’auteur et au groupe, quitte à attirer l’attention de tous et solliciter leur avis sur un point particulier ou un autre, en évitant, bien sûr, de projeter une quelconque « bonne » pensée téléguidée. Il fera confiance au groupe, et il s’apercevra que bon nombre « d’erreurs de tir » se rectifieront d’elles-mêmes, procédure plus gratifiante, pédagogique et cohérente que s’il corrigeait lui-même, bien que nettement plus lente.
D’ailleurs nul ne peut sans son accord le moindrement modifier la proposition d’un participant. Déjà parce que toute proposition ou idée inscrite au tableau est signée, ce qui singularise d’office la pensée. Le « on » n’a pas ici droit de cité. Toute suggestion de modification ou d’explication par un camarade devra donc être acceptée par l’auteur pour pouvoir être inscrite au tableau. Mais le groupe peut sanctionner globalement par le biais d’un vote majoritaire une proposition qui lui paraît inadéquate : par exemple une proposition qui est hors sujet. C’est d’ailleurs le seul rôle imparti au groupe en tant que groupe : faire office de jury, afin d’approuver ou de sanctionner une hypothèse ou une analyse, puisque l’animateur de la discussion n’a pas ce droit. Il sera toutefois utile de spécifier que cette fonction d’arbitrage est d’ordre purement pragmatique, en expliquant que le groupe peut tout à fait se tromper, dans la mesure où une personne seule peut avoir raison contre tous. Mais avouons qu’en classe, en général, le groupe reste, dans ses jugements, relativement pertinent, suffisamment en tout cas pour permettre de l’utiliser comme référent, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Restons toutefois ouvert à des revirements de situation significatifs, et pour cela il est conseillé de barrer les propositions refusées plutôt que de les effacer.
Nous reprenons à notre compte cette expression de Leibniz, car elle spécifie pour nous de manière précise ce qui distingue la discussion « ordinaire » de la discussion philosophique. Pour cet auteur, la réalité ou substance des choses ne réside pas tant dans leur être distinct, que dans leur rapport à ce qu’elles ne sont pas. Ce qui distingue une entité fait plutôt appel à définition, analyse relativement statique d’un objet figé et isolé, tandis que saisir une entité dans son rapport à une ou plusieurs autres invite à la problématisation, posture intellectuelle plus vivante et dynamique. Non que la définition soit exclue, mais parce qu’elle se voit subordonnée à un ensemble de situations dont le caractère mouvant modifie et travaille au corps le sens qui ne peut plus être défini a priori. Le travail de la pensée consiste dès lors à éprouver la résistance d’une idée ou d’un concept en les frottant à ce qui leur paraît en un premier temps étranger, révélant ainsi les limites constitutives de leur être. Pour être cohérent avec nous-même, proposons le principe que le rapport entre discussion « ordinaire » et discussion « philosophique » consiste justement en l’explicitation du rapport, rapport constitutif et déterminant, car l’explicitation du rapport modifie en les éclairant et donc en les modifiant les éléments mêmes du rapport.
Pour être plus concret et visible, prenons le premier degré de ce rapport, tel que nous l’intégrons à notre pratique : la reformulation, utilisée comme outil de vérification de l’écoute. Comment pourrions-nous prétendre mener une quelconque discussion, et a fortiori une discussion philosophique, si les interlocuteurs ne s’écoutent guère ? D’autant plus qu’une des caractéristiques de l’échange philosophique pourrait consister en la contiguïté et le rapprochement entre les arguments afin de faire émerger les éléments essentiels de l’architectonique. « Enlève ta chemise, et viens pour le corps à corps ! » enjoint Platon. Non pas un corps à corps destiné à savoir qui l’emportera, mais dans le but de mettre à l’épreuve les idées et les rapports qu’elles entretiennent en elles-mêmes et entre elles. Ce ne sont jamais la présence des mots ou leur existence que l’on peut contester, mais uniquement leur utilisation ou leur fonction, c’est-à-dire le lien occasionnel qu’ils conservent avec d’autres mots, et la finalité à laquelle ils sont théoriquement assujettis.
La reformulation, qui renvoie à l’agrément des parties en présence quant à l’objet de leur discussion ou à la nature de leurs différences, condition d’une discussion réelle, paraît ainsi représenter la première étape du « lien » que nous tentons d’établir comme principe. Lien à la fois intellectuel, comme nous venons de le définir, mais aussi lien psychologique : instaurer un minimum d’empathie avec l’interlocuteur. En effet, reformuler posément, en sollicitant l’accord du partenaire sur le résumé de ses propos, exige de ne pas interpréter de manière réductionniste, empêche de caricaturer, et oblige surtout à bien distinguer la compréhension des arguments entendus et les diverses nuances, rectifications ou objections qui surgissent et que l’on s’apprête à avancer en réaction à ce qui a été entendu. Quant à celui qui entend sa parole reformulée, un tel exercice le contraint à entendre ce qui est entendu par son auditeur, expérience qui en soi n’est pas évidente, car entendre nos propres idées ou mots prononcés par une bouche autre que la nôtre peut représenter en soi une expérience assez douloureuse. Ne serait-ce que parce que cela nous force à repenser nos propos, de manière plus distante, avec toute la dimension critique que ce dédoublement infère. Bien souvent nous ressentirons une certaine irritation envers celui qui fait ainsi office de miroir, qui avive ainsi notre anxiété. D’autre part, notre auditeur n’est pas une machine à enregistrer : il traduit avec les mots qui lui sont propres, il résume comme il peut. Il nous faut alors savoir distinguer l’essentiel de l’accessoire, faire le deuil de « l’ampleur » de notre pensée et de tout ce que nous voudrions dire ou ajouter, pour être capable d’admettre que ces paroles étrangères correspondent bien aux nôtres. Un tel jugement est délicat, qui doit évaluer l’adéquation entre deux formulations : sans une certaine liberté de pensée accompagnée de rigueur, elle devient impossible. Si l’on joue le jeu, la reformulation permettra toutefois de mieux entrevoir ce que contiennent nos idées, d’en percevoir les faiblesses et les limites.
Le lien substantiel, nous le voyons déjà, est aussi l’unité d’un discours, unité transcendante, pas nécessairement exprimée, qui contient de manière condensée le contenu, abrégé ou intention de notre pensée, proposition réduite dont la forme et le fond souvent nous échappent. Une fois formulée, cette unité sous-jacente peut même nous surprendre ou nous insupporter. Elle est le principe unificateur ou générateur de nos exemples, cause antécédente du fameux « c’est comme quand… » si populaire chez les enfants, et les adultes. L’établissement explicite de ce lien requiert de réquisitionner des mots clefs, ou concepts, termes choisis qui rendent opératoire le discours en extrayant l’intimité du sens. Pour ce faire, il devient nécessaire de travailler l’art de la bréviloquence. Ainsi il pourra être demandé à un orateur de forger une proposition simple, phrase unique qui lui semble capturer l’essentiel de ce qu’il tente de signifier à travers une multiplicité de phrases dont l’enchevêtrement a souvent pour rôle premier d’obscurcir le sens plutôt que de le rendre manifeste. C’est cette phrase qui sera notée au tableau, pour servir de témoin exclusif d’une pensée donnée. Néanmoins ne soyons pas étonnés si un élève ne réussit pas à relever ce défi, et s’il lui faut solliciter l’aide de ses camarades accomplir sa tâche. Périodiquement, il sera nécessaire de transformer quelques aspects cruciaux de la parole initiale pour réussir ce pari : à partir du moment où notre discours s’explicite, nous nous voyons souvent obligés d’en modifier les termes.
Le lien substantiel est donc l’unité d’un discours, mais il est aussi l’unité de deux ou plusieurs discours. Bien entendu, dans la mesure où des paroles proviennent d’origines différentes, on peut s’attendre à ce qu’elles comportent une dimension contradictoire ou conflictuelle. Contrairement à une parole unique qui doit s’astreindre à un souci de cohérence, la multiplicité des auteurs n’oblige en rien à un quelconque consensus. Toutefois, l’exigence de la discussion implique tout de même une unité : celle de l’objet. Il s’agit donc en premier lieu d’identifier, en dépit de la variété des formes d’expression, des angles d’attaques du propos ou de la diversité des perspectives, quelque communauté de sens sans laquelle nous nous retrouvons engoncés dans l’absurdité, le solipsisme et le dialogue de sourds. En même temps que cette communauté d’objet, et grâce à elle, nous découvrirons les différences conceptuelles, accompagnées des visions du monde qui les sous-tendent, différences qui nous permettront d’estimer et prononcer les enjeux de la discussion. « Dialectique du même et de l’autre », propose Platon : en quoi l’objet de la discussion est-il même et autre ? La phrase simple, proposition unique qui nous semble toujours si nécessaire prendra naturellement la forme d’une problématique. Proposition qui pose un problème sous la forme d’une question, d’une contradiction ou d’un paradoxe. Nous retrouvons ici la même demande : l’art de la bréviloquence. Mais souvent, afin de placer en regard deux propositions, il nous faut découvrir une ou des antinomies dont les termes ne sont nullement exprimés, de manière consciente, dans les propositions initiales. De la même manière où nous devions creuser un discours unique pour en saisir le sens et l’intention, en produisant de nouveaux concepts et une proposition simple, un certain travail d’approfondissement doit être effectué pour capturer et montrer de manière visible ce qui oppose deux discours. De manière surprenante, nous découvrirons alors périodiquement que des propos qui se veulent contradictoires ne le sont guère, qui se paraphrasent allègrement, arguant exclusivement sur quelque point de sémantique ou autre subtilité peu substantielle, tandis que ceux qui prétendent « aller dans le même sens » entretiennent une illusion fusionnelle dépourvue de toute justification.
Dans la Critique de la raison pure, Kant distingue deux types de concepts : les concepts empiriques, tirés de l’expérience, et les concepts purs, produits dérivés de la raison. Ainsi le concept « homme » provient pour bonne partie de l’expérience, mais celui de « contradiction » est engendré par la raison. Car si je peux percevoir par les organes des sens des hommes concrets, je ne peux pas percevoir de contradictions par ces mêmes organes, ce dernier concept renvoyant uniquement à un problème d’intelligible et non de sensible, donc à un travail d’analyse et de synthèse. Or il nous semble que le travail philosophique doit tendre à la production de concepts, certes empiriques, mais aussi purs concepts de raison. Processus d’abstraction que nous avons déjà traité. Mais nous souhaitons revenir sur la production de ces concepts purs à travers lesquels se forge une pensée consciente d’elle-même et de son fonctionnement. Une pensée qui peut et doit périodiquement s’abstraire d’elle-même pour s’engager dans un processus de métaréflexion.
L’aspect le plus évident de ce processus existe très tôt sur le plan intuitif, en ce que nous nommerons intuition logique. Car si l’enfance se caractérise par une vision magique du monde, un monde où tout peut arriver sans que cela ne surprenne, petit à petit l’esprit s’initie à « l’ordre des choses ». Par un processus associatif, prélude au cheminement de la raison, des objets, des êtres et des phénomènes sont reliés ensemble. Divers liens sont établis, qui lentement deviendront la structuration de l’espace, du temps, de la causalité, de la logique, du langage, de l’existence, avec toutes les lourdeurs et les rigidités que cette vision figée du monde implique, certes, mais qui s’avèrent aussi la condition nécessaire à l’avènement de la raison. Raisonner consiste à connaître ou reconnaître la réalité des choses, à la comprendre et donc à prévoir, car si rien n’est prévisible, si rien n’est reconnaissable, notre raison devient caduque. Ce qui explique notre étonnement, lorsque qu’un événement dépasse les frontières de notre raison et de ses attendus. La transformation dont nous parlons est celle d’un esprit pour lequel tout est possible, qui peu à peu distingue le possible et l’impossible, ainsi que le compossible : ce qui est possible par rapport à une condition donnée, fondement même de la pensée logique : « si ceci, alors cela », ou bien « si d’une part ceci et d’autre part ceci, alors cela » base du très classique syllogisme.
L’exercice philosophique, par le biais de la discussion ou autre, consiste donc à inviter la raison à effectuer un double travail sur elle-même. D’une part, aller « au bout » de ses interrogations, de ses problèmes, de ses analyses. D’autre part, se voir fonctionner, repérer les mécanismes, à la fois ceux qui opèrent et produisent de la pensée, et ceux qui freinent, dévient ou interrompent le processus de réflexion. Ces deux aspects du travail se nourrissant mutuellement, puisque la perception des limites permet de saisir la nature précise d’un processus, et l’identification d’un processus permet de retravailler ou dépasser les limites. Ainsi le travail de métaréflexion permet à la pensée de progresser. Or c’est précisément le problème qui est soulevé par les enseignants qui nous disent « Je ne sais pas quoi répondre aux questions des élèves » ou bien « Ça tourne en rond, je ne vois pas comment faire avancer la discussion » : comment faire progresser la pensée. La solution n’est ni de fournir des réponses toutes faites sur lesquelles les élèves se précipiteront, ni de simplement proposer une piste qui « sortira d’affaire » le groupe, mais d’inviter les uns et les autres à observer leur propre fonctionnement, leurs idées, leurs contradictions, leurs glissements de sens, etc., tout simplement par quelques petites règles méthodologiques qui spécifient le rôle et la finalité de chaque moment de réflexion.
Le premier aspect de ce processus consiste à être conscient de la nature de nos propos, comme de nos actes, et pour cela savoir catégoriser ces propos, savoir nommer la forme ou la finalité de notre parole. Sommes-nous en train de poser une question, de proposer une nouvelle idée, de répondre à une objection ou d’en fournir une, de démontrer ou de prouver une idée, d’argumenter ou de problématiser, de donner un exemple ou de conceptualiser une illustration, de rapporter des faits ou de les interpréter ? Il s’agit ici d’émerger du « Je veux dire quelque chose… Ça me fait penser à… Je voudrais ajouter… ». Autant de souhaits exprimés de « commenter », « nuancer », « compléter », « rebondir », ou « préciser » qui, vérification faite, ne signifient pas grand-chose, sont très vagues ou restent très éloignés de ce qu’ils disent. Ce type d’analyse renvoie en premier à l’intention de la prise de parole, car pour son auteur, elle est souvent vécue et perçue exclusivement comme une « pulsion de parole », quelque chose qui nous vient à l’esprit et demande à sortir, le plus vite possible, opinions d’origine principalement associative, dont nous ignorons la nature et le rôle. Ignorance qui explique un certain nombre de difficultés d’articulation, de balbutiements, de ratures et de contradictions. Prendre conscience de ce que l’on veut dire, signifie aussi travailler et lisser cette parole en fonction d’une finalité ordonnatrice permettant de mieux structurer la pensée. Bien que lors des premières tentatives, le fait de catégoriser ou définir semble rendre notre parole plus confuse encore. Faire et se voir faire, comme action simultanée, peut être pensé et subi initialement comme un facteur dédoublant, alourdissant la tâche, mais plus ou moins rapidement, au fur et à mesure que se développe la capacité d’être à la fois « dedans » et « dehors », ce processus facilite le travail de la pensée et de l’expression en clarifiant la compréhension.
Dire les mots, c’est penser, nous dit Hegel, affirmant qu’il serait illusoire de croire penser sans forger par des concepts cette pensée. L’intention, le ressenti, l’impression, l’intuition, autant de formes inadéquates, insuffisantes et trompeuses de la pensée, une pensée non consciente d’elle-même. Certes ce présupposé, comme tout présupposé, connaît ses limites, mais il connaît aussi son utilité. Savoir ce que l’on dit, c’est dire ce que l’on dit, c’est annoncer son intention, c’est définir la forme, c’est articuler la relation à ce qui a déjà été dit. Toutefois, comme pour l’ensemble de l’exercice, il ne s’agit pas ici de faire un travail de vocabulaire, sur les termes « hypothèse », « objection », « abstrait », « essentiel » ou autres, bien que cela ne soit guère exclu, en un autre temps. Non pas savoir, mais savoir-faire ; non pas connaître, mais utiliser. Notre affaire est surtout que l’élève s’entraîne à penser sa pensée, c’est-à-dire à tenter de spécifier la nature de son discours. En un sens, peu importent les mots qu’il utilise, ceux qui seront les siens en un premier temps, approximatifs et inhabituels, ou ceux qu’il acquerra au cours de la pratique, plus précis ou plus conventionnels. L’important est surtout de desceller l’immédiateté qui le lie à sa parole, de creuser un interstice, d’installer une respiration, pour passer de l’implicite à l’explicite, afin que le sujet se détache de lui-même et que la pensée devienne un objet pour elle-même. Nos opinions sont des vérités, nous indique Pascal, à condition d’entendre ce qu’elles disent, et la vérité de nos opinions n’est pas toujours là où nous le pensons. Tentons alors de nous en rapprocher.
Principes de la pratique philosophique
Peut-on parler de pratique philosophique ?
Le concept de pratique est en général étranger au philosophe d’aujourd’hui, presque exclusivement un théoricien. Le mot même le dérange. En tant que professeur, son enseignement porte principalement sur un certain nombre de textes écrits, dont il doit transmettre la connaissance et la compréhension à ses élèves. Son principal centre d’intérêt sera l’histoire des idées, et son activité favorite l’art de l’interprétation. Une faible minorité d’enseignants ou de spécialistes s’engagera dans la spéculation philosophique écrite. Dans ce contexte, de manière récente, quelque peu en rupture avec la tradition, de nouvelles pratiques émergent, ouvertes au grand public, qui s’intitulent pratiques philosophiques, consultations philosophiques, philosophie pour enfants ou autres, pratiques qui se voient contestées vigoureusement ou ignorées par l’institution philosophique. Cette situation pose les deux questions suivantes, que nous traiterons dans cet ordre. La philosophie est-elle seulement un discours ou peut-elle avoir une pratique ? Qu’est-ce qui constitue une démarche philosophique ?
Bien entendu, nous admettrons ici la partialité de notre engagement philosophique en distinguant au sein de l’activité philosophique quatre différentes modalités, souvent considérées de manière indistincte. Ainsi nous distinguerons l’attitude philosophique, le champ philosophique, les compétences philosophiques et la culture philosophique. Bien que ces différents aspects ne puissent être radicalement séparés, disons simplement pour l’instant que la culture, ou connaissance de la parole d’autorité, tend de manière générale dans l’approche occidentale moderne à prendre le pas sur les autres fonctions philosophiques, tandis que nous privilégierons à la fois l’attitude philosophique et les compétences philosophiques, sur lesquelles nous tenterons brièvement de donner un aperçu.
Nous terminerons notre propos par quelques éléments sur l’idée d’atelier philosophique.
I – La matérialité comme altérité
Une pratique peut être définie comme une activité qui confronte une théorie donnée à une matérialité, c’est-à-dire à une altérité. La matière étant ce qui offre une résistance à nos volontés et à nos actions. Premièrement, la matérialité la plus évidente du philosopher est la totalité du monde, incluant l’existence humaine, à travers les multiples représentations que nous en avons. Un monde que nous connaissons sous la forme du mythe (mythos), narration des événements quotidiens, ou sous la forme d’informations culturelles, scientifiques et techniques éparses, de nature factuelle ou explicative (logos). Deuxièmement, la matérialité est pour chacun d’entre nous “l’autre”, notre semblable, avec qui nous pouvons entrer en dialogue et en confrontation. Troisièmement, la matérialité est la cohérence, l’unité présupposée de notre discours, dont les failles et l’incomplétude nous obligent à nous confronter à des ordres plus élevés et plus complets d’architecture mentale.
Avec ces principes en tête, inspirés par Platon, il devient possible de concevoir une pratique qui consiste en des exercices mettant à l’œuvre la pensée individuelle, dans des situations de groupe ou singulières, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Le fonctionnement de base, à travers le dialogue, consiste d’abord à identifier les présupposés à partir desquels fonctionne notre propre pensée, ensuite à en effectuer une analyse critique, puis à formuler des concepts afin d’exprimer l’idée globale ainsi enrichie. Dans ce processus, chacun cherche à devenir conscient de sa propre appréhension du monde et de lui-même, à délibérer sur les possibilités d’autres schémas de pensée, et à s’engager sur un chemin anagogique où il dépassera sa propre opinion, transgression qui est au cœur du philosopher. Dans cette pratique, la connaissance des auteurs classiques est très utile, mais ne constitue pas un pré-requis absolu. Quels que soient les outils utilisés, le défi principal reste l’activité constitutive de l’esprit singulier.
a – L’altérité comme mythos et logos
Comment vérifier des idées données sur tous les petits mythos de la vie quotidienne, sur les morceaux plus ou moins éclatés de logos qui constituent notre pensée ? Le problème avec la philosophie, comparée à d’autres types de spéculation, est que le sujet pensant ne mesure pas réellement sa propre efficience sur une véritable altérité, mais sur lui-même. Bien que l’on puisse objecter que le physicien, le chimiste, ou encore plus le mathématicien, sont enclins à camoufler leur subjectivité, déguisée en constatation objective. Mais admettons que ce problème s’aggrave dans la pratique philosophique, puisque l’idée particulière qu’il doit mettre à l’épreuve en la confrontant à ses mythos et logos personnels, est elle-même engendrée par ces mythos et logos personnels, ou intimement entrelacée à eux. De plus, comme pour la science “dure” qui parfois change la réalité, soit en agissant sur elle à travers des hypothèses innovantes et efficaces, soit en transformant simplement la perception, la “nouvelle” idée particulière du philosophe peut altérer le mythos ou le logos qui occupent son esprit. Le problème posé par ces deux processus, est qu’il existe une tendance naturelle de l’esprit humain à se déformer afin de réconcilier une idée spécifique avec le contexte général dans laquelle elle intervient, soit en minimisant cette idée spécifique, soit en minimisant l’ensemble du mythos et du logos établis, soit encore en créant une barrière entre eux pour éviter le conflit. Cette dernière option est la plus commune, car elle permet d’éviter, en apparence, le travail de la confrontation ; phénomène qui explique le côté “marqueterie mal jointe” de l’esprit humain, selon l’expression de Montaigne.
Heureusement, ou malheureusement, la douleur provoquée par l’absence de cohérence ou d’harmonie de l’esprit (similaire à la douleur provoquée par la maladie qui exprime les dissonances du corps) nous oblige à travailler cette dissension, ou à porter une armure pour nous protéger, pour oublier le problème afin de minimiser ou occulter le désagrément. Cet oubli a toute l’efficacité d’un analgésique, mais aussi les inconvénients d’une drogue. La maladie est encore là, se renforçant puisque nous ne la traitons pas.
b – L’altérité comme “l’autre”
Passons au second type d’altérité : “l’autre” sous la forme d’un autre esprit singulier. Ce dernier a un premier avantage sur nous : il est le spectateur, plutôt que l’acteur que nous sommes ; les ruptures et divergences de notre propre système de pensée ne lui causent pas a priori de douleur. Contrairement à nous, il ne souffre pas de nos incohérences, en tout cas pas de manière directe, sauf à travers une sorte d’empathie. Pour cette raison, il est mieux placé que nous pour identifier les conflits et contradictions qui nous minent. Bien qu’il ne soit pas un pur esprit : ses réponses et analyses seront affectées par ses propres bogues et virus, par ses propres insuffisances. En dépit de cela, étant moins impliqué que nous dans notre affaire, il pourra poser un œil plus distant sur notre processus de pensée, avantage certain pour nous examiner de manière critique et non défensive, bien que l’on doive se garder d’attribuer une quelconque toute-puissance à cette situation ; toute perspective particulière souffrant nécessairement de faiblesses et d’aveuglements. Ce peut être par manque de compréhension de la pensée de l’autre, ou bien par crainte de l’autre, ou encore à cause de la complaisance induite par le manque d’intérêt pour l’autre, et même l’empathie s’avère ici dangereuse, qui menace d’engluer deux êtres l’un dans l’autre.
c – L’altérité comme unité
La troisième forme d’altérité est l’unité du discours, l’unité du raisonnement. Nous postulons ici la présence d’un “anhypothétique”, selon Platon, l’affirmation d’une hypothèse aussi incontournable qu’inexprimable, unité transcendante et intérieure dont nous ignorons totalement la nature propre, bien que sa présence s’impose à travers ses effets sur nos sens et notre compréhension. L’unité ne nous apparaît pas en tant que telle, comme une entité évidente, mais à travers une simple intuition, désireuse de cohérence et de logique. Point de fuite niché au sein d’une multiplicité d’apparences, qui cependant guide notre pensée et reste une source permanente d’expériences cruciales, pour notre esprit et celui des autres, sauvant nos esprits de l’abîme obscur et chaotique, de la multiplicité indéfinie et du tohu-bohu, pénible chaos qui trop souvent caractérise les processus de pensée, les nôtres et ceux de nos semblables. Les opinions, les associations de pensées, les simples impressions et sentiments, chacun d’entre eux régnant sur son petit monde immédiat, rapidement oubliés lorsqu’ils traversent les frontières étroites d’espace et de temps qui les attachent à un territoire microscopique. Pauvres et pathétiques éphémères, qui aussi réels soient-ils, tentent de se maintenir, faibles et impuissants, dans le brouhaha de processus mentaux déconnectés, essayant en vain d’être entendus, tandis que l’écho reste silencieux et désespérément muet. À moins de résonner sur fond de cette mystérieuse, généreuse et substantielle unité, toute idée particulière sera condamnée à une fin prématurée et soudaine, révélant à toute conscience le vide de son existence. Le seul problème, ici, est précisément que cette conscience est tragiquement absente, car sa présence, liée à l’unité en question, aurait déjà radicalement transformé la mise en scène. L’unité de notre discours est donc ce mur intérieur, à la fois rempart, appui et butée, dont nous ignorons toujours la nature essentielle. Elle est l’autre en nous, l’autre qui, d’une certaine manière, est en nous plus nous que nous-même.
II – Qu’est-ce que philosopher ?
En résumé, l’activité pratique philosophique implique de confronter la théorie à l’altérité, une vision à une autre. Elle implique la pensée sous le mode du dédoublement, sous le mode du dialogue, avec soi, avec l’autre, avec le monde, avec la vérité. Nous avons défini ici trois modes à cette confrontation : les représentations que nous avons du monde, sous forme narrative ou conceptuelle, “l’autre” comme celui avec qui je peux m’engager dans le dialogue, l’unité de pensée, comme logique, dialectique ou cohérence du discours. Dès lors, qu’est-ce que la philosophie, lorsque cruellement et arbitrairement nous lui enlevons son costume pompeux, frivole ou décoratif ? Que reste-t-il une fois que nous l’avons déshabillée de son soi souvent autoritaire, hypertrophié et de son trop de sérieux ? Autrement dit, au-delà du contenu culturel et spécifique qui en est l’apparence, généreuse et parfois trompeuse – si tant est que nous pouvons faire l’économie de cette apparence – que reste-t-il à la philosophie ?
En guise de réponse, nous proposerons la formulation suivante, définie de manière assez lapidaire, qui pourra paraître comme une paraphrase triste et appauvrie de Hegel, dans le but de se concentrer uniquement sur l’opérativité de la philosophie en tant que productrice de concepts, plutôt que sur sa complexité. Nous définirons l’activité philosophique comme une activité constitutive du soi déterminée par trois opérations : l’identification, la critique et la conceptualisation. Si nous acceptons ces trois termes, au moins temporairement, le temps d’en éprouver la solidité, voyons ce que ce processus philosophique signifie, et comment il implique et nécessite l’altérité, pour se constituer en pratique.
a – Identifier
Comment le moi que je suis peut-il devenir conscient de lui-même, à moins de se voir confronté à l’autre ? Moi et l’autre, mien et tien, se définissent mutuellement. Je dois connaître la poire pour connaître la pomme, cette poire qui se définit comme une non-pomme, cette poire qui définit donc la pomme. De là l’utilité de nommer, afin de distinguer. Nom propre qui singularise, nom commun qui universalise. Pour identifier, il faut postuler et connaître la différence, postuler et distinguer la communauté. Dialectique du même et de l’autre : tout est même et autre qu’autre chose. Rien ne se pense ni n’existe sans un rapport à l’autre.
b – Critiquer
Tout objet de pensée, nécessairement engoncé dans des choix et des partis pris, est de droit assujetti à une activité de critique. Sous la forme du soupçon, de la négation, de l’interrogation ou de la comparaison, diverses formes d’une problématique. Mais pour soumettre mon idée à une telle activité, je dois devenir autre que moi-même. Cette aliénation ou contorsion du sujet pensant en montre la difficulté initiale, qui en un second temps peut d’ailleurs devenir une nouvelle nature. Pour identifier, je pense l’autre, pour critiquer, je pense à travers l’autre, je pense comme l’autre ; que cet autre soit le voisin, le monde ou l’unité. Ce n’est plus l’objet qui change, mais le sujet. Le dédoublement est plus radical, il devient réflexif. Ce qui n’implique pas de “ tomber ” dans l’autre. Il est nécessaire de maintenir la tension de cette dualité, par exemple à travers la formulation d’une problématique. Et tout en tentant de penser l’impensable, je dois garder à l’esprit mon incapacité fondamentale de m’échapper véritablement de moi-même.
c – Conceptualiser
Si identifier signifie penser l’autre à partir de moi, si critiquer signifie me penser à partir de l’autre, conceptualiser signifie penser dans la simultanéité de moi et de l’autre. Néanmoins, cette perspective éminemment dialectique doit se méfier d’elle-même, car aussi toute-puissante se veuille-t-elle, elle est également et nécessairement cantonnée à des prémisses spécifiques et des définitions particulières. Tout concept entend des présupposés, une construction particulière, un contexte. Un concept doit donc contenir en lui-même l’énonciation d’une problématique au moins, problématique dont il devient à la fois l’outil et la manifestation. Il traite un problème donné sous un angle nouveau. En ce sens, il est ce qui permet d’interroger, de critiquer et de distinguer, ce qui permet d’éclairer et de construire la pensée. Et si le concept apparaît ici comme l’étape finale du processus de problématisation, affirmons tout de même qu’il inaugure le discours plutôt qu’il ne le termine. Ainsi le concept de “ conscience ” répond à la question “ Un savoir peut-il se savoir lui-même ? ” , et à partir de ce “ nommer ”, il devient la possibilité de l’émergence d’un nouveau discours.
III – L’atelier de philosophie
Deux notions sont indissociables du concept d’atelier : l’exercice ou pratique, et la production. Un troisième, qui sans être obligatoire, a aussi son importance : le collectif. En cela l’atelier philosophique se distingue de deux autres types d’activités philosophiques. D’une part le cours ou la conférence, dans lequel un maître dispense son savoir à des auditeurs ou à des élèves, et la discussion, sur le modèle du débat citoyen ou du café-philo, où les interventions se succèdent tous azimuts au gré des participants et des animateurs. Comme pour toute tentative de schématisation, de telles catégories ne servent que de points de repère, car selon les lieux et les individus, les appellations et les fonctionnements varieront selon toute une gamme de nuances procédant de la continuité plutôt que du discret. Il est en effet des cours ou des cafés-philo qui ressemblent à des ateliers, et vice-versa. Il est aussi des animateurs qui ressemblent à des professeurs et des professeurs qui ressemblent à des animateurs. Risquons-nous toutefois à élaborer quelque peu cette spécificité théorique de l’atelier.
Comme dans un atelier de peinture, dans l’atelier philosophique tout participant se doit de travailler, ou tout au moins est fortement encouragé à s’engager. Le principe d’observateur ou d’auditeur n’est guère de mise. En cela il se distingue du cours et de la discussion, où pour des raisons différentes nul n’est tenu à une participation active. Par exemple, si le nombre s’y prête, un tour de table se tiendra sur un problème donné. Ou bien tout participant pourra en interpeller un autre ou le questionner sans que ce dernier ne se rebiffe, quitte à avouer son incapacité ou sa difficulté à répondre, ce qui fait partie intégrante – voire importante – de l’exercice. C’est en ce sens que cette activité se définit comme une pratique ou un exercice. Chacun vient sur le terrain pour jouer ou accomplir sa part de l’ouvrage, non pour regarder les autres. Bien entendu, l’animateur, responsable de cet engagement effectif, devra en cela agir de manière suffisamment subtile pour ne pas effrayer ceux qui éprouvent encore une certaine réticence à approcher le ballon.
Comme dans l’atelier de peinture, il s’agit de produire. Produire, dans le sens où l’on se confronte à une matérialité, dans le but d’un résultat. Mais la matérialité de l’activité philosophique n’est pas la couleur et sa texture. Elle est la pensée individuelle, à travers sa représentation orale ou écrite. Chacun se confronte d’abord à ses propres représentations du monde, ensuite à celle de l’autre, et enfin à l’idée d’unité ou de cohérence. De cette confrontation jaillissent de nouvelles représentations, sous forme conceptuelle ou analogique. Ces représentations émergeantes se doivent d’être articulées, soulignées, comprises par tous, travaillées et retravaillées. En cela, à nouveau, l’atelier se distingue du cours et de la discussion. Car dans le cours, les concepts sont préparés à l’avance : ils sont souvent codifiés, estampillés en référence à des auteurs et à l’histoire de la philosophie. Et dans la discussion, le mouvement de la pensée glisse, n’insiste pas, ne cherche pas en permanence à revenir sur lui-même, à moins que cela se produise arbitrairement. Sur cette dernière distinction repose sans doute le rôle plus appuyé, voire plus contraignant de l’animateur dans le cadre d’un atelier. Ainsi l’atelier s’insère plus naturellement dans l’activité de classe – entre autres le cours de philosophie – que la simple discussion, plus libre et informelle, aux enjeux didactiques moins explicites.
Nous l’aurons compris : l’atelier philosophique tend à avoir des règles de fonctionnement plus spécifiques et formalisées que celles de la discussion. Ces règles doivent être explicitées, puisqu’elles concernent le fonctionnement d’un groupe, et non pas celui d’un individu seul, comme lors d’une conférence. Les règles du jeu peuvent être innombrables, et sont de fait très variées. Il n’existe donc pas d’exemple type, d’autant plus que dans le domaine de la philosophie, très théorique malgré tout, chacun trouve toujours à redire sur le travail du voisin. Mais à titre d’exemple, décrivons brièvement quelques mises en scène utilisées comme modus operandi d’un atelier philosophique.
a – Questionnement mutuel.
Une question d’ordre général est posée. Une première hypothèse de réponse, relativement courte, est offerte par un participant. Puis, avant de passer à une autre, ses collègues sont invités à le questionner, afin d’éclaircir les points obscurs et résoudre les contradictions. Mais les interventions sont surveillées par l’ensemble du groupe, qui doit déterminer si les questions sont véritablement des questions, ou des affirmations plus ou moins déguisées ; toute question déclarée “fausse” à la majorité du groupe sera refusée. Car tout nouveau concept doit émaner du porteur d’hypothèse et non pas des questionneurs. Chaque participant est ainsi obligé d’entrer dans le schéma du voisin, en laissant de côté, temporairement, ses propres opinions. Principe qui permet de développer en commun l’hypothèse initiale, dont l’initiateur est le garant. C’est lui qui, pressé par les questions reçues, développera son hypothèse, la reformulera, ou même l’abandonnera si au fur et à mesure de la discussion si elle vient à lui paraître intenable. Puis une nouvelle hypothèse est proposée par un autre participant, et le processus recommence. Le résultat final est de problématiser la question initiale, en comparant ces diverses lectures, en mettant au jour leurs enjeux et leurs concepts forts, réalisant ainsi ce que l’on pourrait nommer une dissertation collective.
b – Exercice de la narration.
Une question d’ordre général est posée. Mais au lieu de la traiter par des considérations abstraites, les participants sont invités à présenter une narration courte, fictive ou réelle, inventée ou tirée d’une œuvre quelconque, qui pourrait servir de cas d’école afin d’étudier la question posée. Plusieurs histoires – cas d’école – sont proposées, qui sont comparées par les participants, en argumentant leur intérêt respectif pour traiter le sujet. Puis un vote du groupe choisit une seule de ces histoires, qui sera analysée plus en profondeur. Le narrateur est alors questionné par ses collègues. D’abord sur les données factuelles de la narration, afin de travailler l’objectivité du contenu. Puis sur l’analyse conceptuelle qu’il en donne, dont l’énoncé devrait permettre de traiter la question initiale. Les autres participants peuvent ensuite soumettre une nouvelle lecture de cette narration, en précisant les enjeux philosophiques comparatifs de leur propre lecture. Le produit final de cet exercice est à nouveau une problématisation de la question initiale, grâce à un certain nombre de concepts et d’idées qui ont émergé au fil de la discussion.
c – Travail sur texte.
Un texte est distribué aux participants, court extrait d’une œuvre philosophique, littéraire ou autre. Une lecture à haute voix est effectuée par un volontaire. Tous sont ensuite invités à exposer une analyse du texte, qui devra se conclure par une phrase courte censée capturer l’intention principale de l’auteur. La première interprétation sera discutée par l’ensemble des participants avant de passer à une autre. Des questions seront posées, portant à la fois sur le sens de cette interprétation et sur son accord avec le texte. Des citations précises pourront être exigées afin d’en légitimer l’articulation. De nouvelles interprétations seront développées, qui subiront un semblable traitement. En un second temps, des critiques du texte pourront aussi être formulées. Les enjeux philosophiques de ces différentes lectures devront alors être précisés, afin d’analyser les présupposés de chacune d’entre elles, permettant de mieux saisir les différences conceptuelles, souvent importantes. Le produit final est la problématisation d’un texte initial, au moyen des différentes interprétations offertes et travaillées. Précisons qu’un travail semblable peut être réalisé autour d’un texte écrit par un des participants.
Tous philosophes ?
Identifier ce qui est nôtre. Se rendre capable d’une analyse critique de cette identité. Dégager de nouveaux concepts afin de prendre en charge la tension contradictoire qui émerge de la critique. De manière assez abrupte, qu’il reste à développer en d’autres lieux, disons que ces trois outils nous permettront de confronter l’altérité qui constitue la matière philosophique, matière sans laquelle il ne serait pas possible de parler de pratique philosophique. Une pratique qui consiste à s’engager dans un dialogue avec tout ce qui est, avec tout ce qui apparaît. À partir de cette matrice, il n’est de catégorie d’êtres humains qui ne puisse tenter à différents degrés de philosopher, de s’engager dans une pratique philosophique.
Philosopher, c’est savoir ce que l’on dit
Philosopher, c’est savoir ce que l’on dit
« La vérité est bien dans leurs opinions, mais non pas au point où ils se figurent.«
Pascal, Pensées.
Le principe auquel nous faisons appel ici ne prétend pas diminuer le rôle de l’intuition, de la parole spontanée, voire même de la compréhension approximative qui préside à bien des discussions, mais nous souhaitons simplement arrêter un instant le regard du lecteur sur les limites visibles de certains types d’échanges, qui par complaisance ou par ignorance restent en deçà d’eux-mêmes. De manière générale, disons que le problème est celui de ce que l’on peut nommer la pensée associative. Elle fonctionne sur le schéma général du « ça me fait penser à quelque chose », sur le modèle du « je voudrais rebondir » si populaire dans les débats télévisés, ou encore sur celui du « je voudrais compléter », ou du « je voudrais apporter une nuance ». Autant d’expressions qui au fond ne signifient pas grand-chose, disent souvent ce qu’elles ne disent pas ou veulent dire quelque chose qu’elles n’évoquent nullement.
En classe, cette tendance se manifeste par une nette tendance de l’enseignant à faire primer l’expression d’idées, aussi vagues soient-elles, sur toute autre considération : l’élève s’est exprimé, c’est bien ! Ce souci est poussé à un tel point que ledit enseignant est prêt à finir les phrases de l’élève, à lui mettre des mots dans la bouche sous prétexte de reformuler, uniquement pour pouvoir dire : il a dit quelque chose, il a parlé. Or si un tel souci ou un tel comportement peut se comprendre dans certains types d’exercices de langage, il peut poser problème pour le travail philosophique. Pour étayer notre hypothèse, nous décrirons quelques compétences particulières, liées à la discussion, qui nous semblent essentielles au travail philosophique.
Certains nous objecteront d’emblée que l’exigence de « parler au bon moment » n’est qu’une préoccupation superficielle, dénuée de substance réelle. Ceci pour deux raisons possibles. Soit parce que cette règle est conçue comme un simple acte de politesse : par exemple ne pas couper la parole à un interlocuteur. Soit parce qu’elle est animée par un simple but pratique : parler en même temps que quelqu’un d’autre empêche d’entendre et de comprendre. Mais de telles perspectives oublient l’intérêt premier du philosopher : le rapport à sa propre parole. Déjà, le simple fait de pouvoir solliciter ou mobiliser de manière délibérée sa pensée et sa parole, non pas par quelque enchaînement fortuit et incontrôlé, mais par un acte voulu, conscient de lui-même, modifie en profondeur le rapport entre soi-même et sa pensée. Ensuite, si l’idée en question ne devient pas l’objet d’un dialogue avec soi-même, il est à craindre que cette idée, tout comme elle surgira inopinément, ne sera pas vraiment comprise, ni même entendue par son auteur. Pour vérifier cela, il n’est qu’à demander à un enfant ou à un adulte dont la parole a jailli trop spontanément, de répéter ce qu’il vient de dire, pour apercevoir le problème : bien souvent il ne saura pas le faire.
Il est une raison importante à cet oubli : l’aspect gauche et maladroit du comportement renvoie à une dévalorisation de soi. « Mes propres idées n’ont aucune espèce importance, pourquoi les exprimerai-je ? Pourquoi en soignerai-je la forme et l’apparence ? Pourquoi parlerai-je pour être entendu ? D’ailleurs, comment puis-je choisir le moment approprié pour les prononcer ? C’est malgré moi que ma parole sort, voire en dépit de moi : elle ne m’appartient pas ». Ainsi, lorsqu’on demande à cet individu de parler au « bon moment », c’est un effort important qu’on exige de lui, mais un effort on ne peut plus nécessaire. Il implique un travail en profondeur de soi sur soi, qui, s’il n’est pas toujours facile, est absolument vital.
Le problème est identique quand on impose de lever la main pour parler, quand bien même cela paraît ardu, en particulier avec les jeunes enfants. Pourquoi d’ailleurs ne pas faire de cette exigence un exercice en soi ? Si ce n’est qu’il est un peu frustrant pour l’enseignant, qui avant tout veut montrer aux autres et à lui-même que « ses » enfants ont des idées. Pourtant, peut-être répètent-ils simplement ce qu’ils ont entendu à la maison ou à l’école, mais cela fait tellement plaisir à entendre… Tandis que le fait de prononcer une parole au bon moment, montre au contraire que l’enfant sait faire ce qu’il a à faire, et qu’un débat intérieur non accidentel s’est engagé. Et à quelques nuances près, il en va de même pour l’adulte. Se distancier de soi, en découplant sa parole et son être, comme acte constitutif de l’être.
Comme nous l’avons évoqué, il est si tentant de finir les phrases de son interlocuteur, enfant ou adulte ! Mais si nous y réfléchissons bien, qu’est-ce qui nous anime, sinon une sorte d’impatience déguisée sous les oripeaux d’une empathie superficielle et complaisante. Si l’enfant tombe, faut-il nécessairement se précipiter sur lui pour le relever, ou bien lui laisser la chance de se ressaisir, s’il pleure, et lui donner l’occasion d’apprendre à se relever tout seul ? D’autant plus que les mots ou bouts de phrases qui nous sont obligeamment fournis par l’enseignant ou par le voisin, sont peut-être très éloignés ou très en deçà de ce que nous étions sur le point d’articuler. Mais tout comme celui qui se noie se précipite sur l’objet qu’on lui lance, sans même réfléchir, alors que l’objet lancé ne lui est peut-être d’aucune utilité, celui qui cherche ses mots s’empare souvent instinctivement de ce qui lui est dit sans même en analyser le contenu, sans prendre le temps et la peine d’en vérifier l’efficacité ou la justesse.
Immanquablement, en prétendant aider l’autre, nous cherchons surtout à nous faire plaisir, nous cédons sans vergogne à nos impulsions. Alors que celui qui peine à terminer son œuvre effectue pourtant un travail important sur lui-même et sa pensée. Ce qui ne signifie pas qu’il doive peiner sans aucune assistance, mais la première assistance qui lui est due est celle qui consiste à lui laisser du temps, à lui permettre de se retrouver lui-même sans subir la pression du groupe ou de l’autorité en place qui le bouscule sous prétexte de le secourir. Quitte à installer des procédures qui lui permettront de sortir de l’impasse, si impasse il y a. Par exemple, en apprenant à dire : « Je n’y arrive pas », « Je suis coincé », ou bien en demandant « Est-ce que quelqu’un d’autre peut m’aider ? ». Car dès cet instant, le problème est articulé, il est signalé, et en ce sens le sujet reste libre et autonome, puisqu’il est conscient du problème et réussit à l’articuler avec des mots.
Leibniz avance la téméraire hypothèse que ce n’est pas dans la chose en soi, mais dans le lien que se trouve la substance vive. Profitant de cette intuition, nous avancerons le principe que ce qui distingue la pensée philosophique par rapport à la pensée en général, est précisément le lien, c’est-à-dire le rapport articulé entre les idées. Une idée n’est en soi jamais qu’une idée, un mot n’est jamais qu’un mot, mais dans l’articulation grammaticale, syntaxique et logique, le mot accède au statut de concept, puisqu’il devient opératoire, et l’idée participe à l’élaboration de la pensée, puisqu’en s’associant à d’autres elle permet d’échafauder et construire.
Pour ce faire, ce n’est pas tant des idées que nous cherchons, aussi futées et brillantes soient-elles, car la discussion ressemblerait ainsi à une vague liste d’épicerie, à un vulgaire débat d’opinions, produisant une pensée globale inchoative et désordonnée. Ce sont des liens, des rapports, qui impliquent la maîtrise de ces connecteurs généralement si mal compris et utilisés, à commencer par le « mais » qui procède du « oui, mais… », et une compréhension accrue des relations et corrélations entre les propositions. Combien de dialogues échangent des propos conflictuels sans en relever le moindrement la nature contradictoire, sans en évaluer le potentiel problématique ! Combien de propos affirment un désaccord sans préciser ou percevoir le caractère spécifique de ce désaccord, tandis que les propositions en question ne portent pas sur le même objet, ou affirment la même idée en changeant simplement les mots !
Aussi, plutôt que de se précipiter sur d’autres idées, ou plutôt d’autres intuitions, avant d’empiler plus de mots, pourquoi ne pas prendre le temps de déterminer et d’évaluer le rapport entre les concepts et les idées, afin de prendre conscience de la nature et de la portée de nos propos. Mais là encore, l’impatience règne : ce travail est laborieux, il est apparemment moins glorieux et plus frustrant, et pourtant, n’est-il pas plus conséquent ?
Aussi, exercice très simple, demandons à celui qui va parler d’annoncer en premier lieu le but de sa parole, d’articuler le lien entre son intention et ce qui a déjà été dit, de qualifier son discours. S’il n’y arrive pas, qu’il le reconnaisse, et qu’il tente de réaliser ce travail une fois que sa parole a été prononcée. S’il n’y arrive toujours pas, il peut alors demander aux autres de se donner la peine de l’aider. Mais pour réaliser cela, il s’agit de s’intéresser à la parole déjà prononcée, et ne pas uniquement penser à ce que l’on a envie de dire, même si ailleurs l’herbe est plus verte. Il s’agit de se fixer un but, s’y atteler et se concentrer, et ne pas se laisser déborder par le bouillonnement intérieur, lorsque les idées se bousculent au portillon comme pour une sortie de métro à l’heure de pointe. Schwarmereï, dirait Hegel, vrombissement d’un essaim de guêpes où plus rien ne se distingue.
Le tout n’est pas de dire, mais de déterminer de manière délibérée ce que l’on veut dire, de dire effectivement ce que l’on veut dire, et de savoir ce que l’on dit. Sans cela, la discussion peut s’avérer tout à fait sympathique et conviviale, mais est-ce bien philosophique ?
Les questions des enfants
Comment éviter les questions des enfants ?
Nous ne prétendons pas proposer ici une étude vaste et exhaustive de la question, mais seulement lancer quelques pistes qui nous impliquent des conséquences sur le philosopher lui-même.
Adultes enfants
Intuitivement ou consciemment, une personne qui rencontre des difficultés pour établir une relation fonctionnelle avec des adultes, pourra se tourner vers les enfants. Premièrement, parce que dans bien des cas ces derniers ne contestent pas l’identité de l’adulte, tandis que ce dernier se sent grand et fort en leur présence. Deuxièmement, parce que l’autorité et le pouvoir sont a priori accordés à l’adulte sur les enfants. Troisièmement, parce que l’adulte a l’impression d’en savoir beaucoup, comparé aux enfants. Quatrièmement, parce que l’adulte peut revivre son enfance et pour cela, certains se sentirons bien avec leurs petits compagnons. Néanmoins, bien sûr, rien de tout cela n’est totalement clair et net, ni particulièrement conscient. Comme Frédéric Schiller l’identifia, il réside toujours une certaine ambiguïté dans la relation entre l’adulte et l’enfant. Quand une grande personne voit trébucher un bambin qui apprend à marcher, il se sent certainement très compétent, fort et puissant comparé à lui, mais au même moment il ressent une petite touche de jalousie, à l’idée que ce jeune être a encore toutes ses possibilités, qu’il a toute la vie devant lui : toutes les options lui sont encore ouvertes, ce qui a pour conséquence d’induire quelques regrets dans l’esprit de l’adulte par rapport à un passé déjà révolu et déterminé. Toutefois, les bonnes âmes protesteront énergiquement que jamais semblable jalousie envers un pauvre enfant innocent et sans défense ne leur soit jamais venue à l’esprit.
Les enfants sont naturellement philosophes au sens où les questions leur viennent facilement à l’esprit. À un âge où ils ont tant à découvrir sur le monde et sur eux-mêmes, l’étonnement, l’émerveillement et la stupéfaction, caractéristiques importantes d’un esprit philosophe, jouent encore assez pleinement. Bien que l’on puisse objecter qu’il ne soit pas totalement conscient du contenu des questions qu’il formule: prenons comme exemple le pourquoi qui peut être articulé de manière très mécanique sas aucun souci réel de la réponse. Néanmoins, comme pour tout ce qui a trait à la nature humaine, cette tendance peut être maîtrisée ou encouragée, interrompue ou développée. Ainsi, dès l’âge de sept ou huit ans, nous observons comment un certain principe de réalité, que nous pouvons nommer également principe de certitude, aussi légitime soit-il, envahit l’esprit de l’enfant, ce qui a pour effet d’étouffer l’interrogation métaphysique qui jusque-là constituait la majeure partie de sa vie intellectuelle. Il entre dans un âge « scientifique », qui comprend lui aussi son propre domaine de questions et de réponses, de nature bien établie, un domaine qui tend cependant à restreindre son activité au champ du physique, à la contrainte du probable et de la certitude sensible, plus communément acceptables que la pure possibilité et la veine poétique. Notre propos souhaite mettre en exergue ici un certain conditionnement de l’esprit, au demeurant tout à fait attendu et acceptable, puisque ce processus constitue la majeure partie de l’apprentissage de la vie en société, qui implique de se conformer à la connaissance et au comportement acquis socialement, processus qui simultanément entraîne une contrainte et une diminution importante des compétences intellectuelles de l’enfant. Maintenant, bien sûr, la nature et les modalités de cette transformations dépendront largement du contexte culturel et familial qui entoure l’enfant. Dans notre perspective, l’enseignement philosophique consiste à entretenir, instaurer ou restaurer le questionnement illimité qui autorise l’enfant, et l’adulte plus tard, à penser l’impensable. Tentons de montrer maintenant comment est inhibé lentement ou brutalement ce potentiel de mise en abyme de l’esprit singulier.
Trop occupés
Il nous semble avoir identifié trois dysfonctionnements importants par lesquels le questionnement des enfants et leur étonnement se sont refroidis ou éteints. Nous les présenterons dans un ordre de subtilité et de sophistication croissant, bien que le processus ne soit pas aussi mécanique que nous le présentons, et qu’opère souvent un certain mélange hétérogènes de comportements parentaux ou adultes. Le premier obstacle, le plus commun et le plus sommaire, est l’inattention pure et simple au questionnement et à l’étonnement. Cela prend la forme légère et indirecte de ne pas écouter, ou l’injonction plus brutale de garder le silence ou d’aller voir ailleurs. Il nous semble important de classer ces deux types de réaction dans la même catégorie, même si l’une semble conserver une apparence plus souple et plus civilisée ; à long terme cela produira exactement le même effet. Combien de parents, qui ne privent jamais ou rarement leur enfant du droit de parler, et qui seraient même horrifiés à une telle idée, continuent pourtant avec la meilleure conscience du monde à mener leurs petites affaires, peu importe leur utilité ou leur nécessité, que ce soit le travail, les courses, regarder la télévision, ou aller ici et là, sans réellement prendre le temps d’écouter leur enfant. En agissant de cette façon, le parent établit une hiérarchie précise dans l’esprit de sa progéniture, déterminant pour lui au présent et dans le futur, ce qui est primaire et ce qui est secondaire. La nécessité immédiate définitivement prime sur la gratuité de l’examen intellectuel et la beauté de la contemplation. S’il en est ainsi, l’adulte ne devrait pas s’écrier, à ce moment-là ou plus tard, que son enfant ne réfléchit pas avant d’agir et suit principalement ses impulsions premières.
Réponses toutes faites
La seconde manière d’occulter le questionnement de l’enfant est en répondant directement à ses questions, peu importe le degré de complexité, l’opportunité et la qualité des réponses. Quoique le temps imparti et la manière dont les réponses s’articuleront feront manifestement une différence. Ce qui motive notre critique de la réponse parentale ou enseignante est d’abord qu’une telle systématisation induit une relation faussée à l’idée même de question. Ce comportement encourage une tendance à compter sur une autorité extérieure, développant l’hétéronomie plutôt que l’autonomie. Ce que nous qualifions de « faussé », est le fait que les questions ne sont pas appréciées pour elles-mêmes, comme un cadeau précieux que notre propre esprit nous offre, mais se voient transformées en de simples envies qui demandent à être satisfaites, un manque qui demande à être comblé, situation déplaisante que le parent « bienveillant » veut obstinément corriger en fournissant des réponses toutes faites. Pourtant, ces réponses de valeur aléatoire seront souvent moins innovatrices et créatrices que la question elle-même. L’idée que nous avançons ici consiste à affirmer qu’une question a de la valeur en elle-même. Elle représente une ouverture sur le monde et sur l’être, qui nécessairement produit un concept ou une idée, sous une forme négative qui n’a pas moins de valeur que son image miroir : la réponse. Une question a une valeur esthétique, sa forme provoque l’esprit, identique en son aspect à une peinture ou une sculpture que le spectateur contemple sans arrière-pensées et préoccupations urgentes, quant à l’utilité, la vérité ou la solution du problème offert à ses sens et à sa raison. Cette perspective n’interdit nullement une tentative de réponse, mais dans notre perspective, la réponse est quelque peu dévalorisée, retirée de son piédestal, elle perd son statut de but final et ultime du processus intellectuel, de l’activité de l’esprit.
On ne peut pas répondre aux questions importantes, aux questions profondes, on ne doit pas y répondre. Elles peuvent être seulement problématisées, ce qui signifie pour nous analyser initialement leur contenu, les apprécier pour ce qu’elles apportent, et en un second temps peut-être, suggérer quelques idées susceptibles d’éclairer différents aspects pouvant fournir matière à une discussion. Le questionnement est une expérience de l’esprit, un outil permettant d’explorer les limites de la connaissance et de la compréhension. Au demeurant, pour cette raison, il reste crucial que l’adulte, parent ou enseignant, avoue parfois à l’enfant ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, soit parce qu’il ne connaît pas la réponse, soit parce qu’il postule et explique qu’aucune réponse précise ne conviendrait pleinement, et que dans ces cas la question doit se satisfaire à elle-même, ne serait-ce que temporairement, comme une garantie de la vie de l’esprit. Il est indéniable qu’une telle vision pourra engendrer une certaine crainte ou anxiété dans l’esprit de l’enfant – et de l’adulte – qui a besoin de valeurs dans lesquelles il peut ancrer son existence et sa vie spirituelle, de la même manière qu’il a besoin de nourriture pour satisfaire les besoins de sa vie biologique. Ajoutons simplement que, heureusement, un enfant ne mange pas dès qu’il le désire, qu’on lui apprend à retarder la satisfaction de ses besoins, de façon à le libérer de la satisfaction immédiate de ses propres impulsions. Le désir, l’état de manque, est en soi sain et productif, dans la mesure où on lui permet de jouer son rôle dans le temps, dans la durée, si l’on s’abstient de « résoudre » instantanément l’équivocité et le doute qu’il engendre dans le soi. Après tout, autant s’y habituer, puisque le déséquilibre, l’irrégularité et l’inconfort représentent des caractéristiques fondamentales et constitutrices de la vie.
Autonomie
Revenons à l’autonomie : comme pour n’importe quelle autre activité dans laquelle l’enfant est impliqué, il est utile et indispensable qu’il apprenne à se débrouiller lui-même. Ce type d’enseignement présuppose que l’adulte retienne sa tendance naturelle à « materner » qui nous incite instinctivement à « donner la becquée », de façon à inviter l’enfant à se confronter à lui-même et à développer ses propres capacités. Apprendre à pêcher à un homme, plutôt que de lui donner des poissons, dit un proverbe chinois, signifie bien que fournir des poissons est un obstacle à l’apprentissage de la pêche, aussi nourrissants que soient ces poissons. Mais bien sûr, et cela constitue la réalité de ce problème, il est plus pratique de fournir des poissons frais, petits objets pouvant être tenus facilement en main, car l’apprentissage de la pêche implique une procédure plus lente et plus subtile, où l’enseignant doit consciencieusement approfondir la compréhension de son propre art et en même temps être plus perspicace quant au fonctionnement global de l’enfant. Le chemin long, dit Platon, plutôt que le chemin court où le maître fournit des réponses toutes faites à son élève. L’enfant doit apprendre à travailler par lui-même, sinon il cherchera éternellement ses réponses chez les autorités établies – signe de respect sans doute – au lieu de chercher en lui-même. L’apprentissage de l’autonomie doit cependant commencer très tôt, et ce n’est pas par des injonctions immédiates ou tardives d’autodétermination forcée que le jeune adulte s’initiera à cet aspect crucial de son existence – comme beaucoup de parents le croient, lorsqu’ils font soudain face, dans l’urgence d’un problème spécifique, à ce qu’ils considèrent comme une influence négative et perverse du monde extérieur sur leur enfant. Le processus qu’il s’agit d’engager est d’encourager l’enfant à faire confiance à ses propres capacités à penser, à produire des idées, à délibérer et à juger par ses propres moyens, par lui-même, et cela s’accomplira uniquement par une lente initiation, par le biais d’une pratique constante qui démarre dès le plus jeune âge.
Nous rencontrerons deux objections courantes à une telle attitude pédagogique, étroitement liées entre elles. La première est l’argument de valeur, la seconde est l’argument du doute, son corollaire. L’argument de valeur affirme que les enfants ont besoin de valeurs pour se construire eux-mêmes, points de repère sans lesquels ils ne peuvent grandir et se constituer eux-mêmes pour devenir des adultes matures et responsables, valeurs sans lesquelles un être humain n’est pas complet. Aussi, les parents, ou les enseignants, dans le but d’éduquer, se doivent de véhiculer un nombre de lignes directrices sur les questions fondamentales : le vrai et le faux, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la beauté et la laideur, l’interdit et l’obligation, les droits et les devoirs, etc. Disons que les adultes, en général, se conçoivent eux-mêmes comme les gardiens de certains principes acquis et hérités, composant une axiologie approximative dont les fondements ne sont pas vraiment clairs, quand ils ne sont pas pétris de contradictions. Néanmoins ils restent convaincus que ces valeurs sont nécessaires aux enfants dont ils sont responsables, pour un mélange de raisons pratiques, idéologiques, ou simplement pour affirmer leur autorité, distinctions majeures, pourtant plus que souvent négligées. Si nous insistons sur le côté arbitraire de ces schémas éducatifs, c’est parce que la raison y joue seulement un rôle mineur, voire absent. Il est évidemment utile et nécessaire d’inculquer à l’enfant un ensemble de « vérités » générales sur la réalité globale et singulière, issu de notre expérience d’adulte, de façon à ce que ses actions et décisions ne soient pas réduites au cas par cas, afin qu’il apprenne à ne pas se limiter à des impulsions purement instinctives ou réactives. Nous ne devons pas oublier que cette entreprise est destinée à fournir du sens au monde et à sa propre existence, un sens dont l’enfant a besoin. Mais, si nous n’allouons pas à cet enfant un espace de liberté pour créer de lui-même une telle vision du monde, il deviendra, comme beaucoup d’êtres humains, le produit d’un conditionnement réducteur, rigide et irréfléchi, à moins qu’il se révolte contre une perspective dogmatique avec une contre-perspective également dogmatique. En ce sens, il doit être initié à la pratique des principes généraux de sagesse, de connaissance et d’utilité, pour des raisons existentielles, morales et intellectuelles, avec un certain degré d’imposition sans lequel ces principes perdraient leur force, mais il doit également apprendre à analyser, comparer, critiquer, questionner et formuler de tels principes généraux de sa propre gouverne. Ce pari éducatif, pari sur la raison et l’autonomie, exige un engagement vaste, généreux et exigeant, devant lequel trop de parents et d’enseignants reculent, pour différentes raisons : manque d’énergie, manque d’éducation, peur, etc.
Les mêmes principes seront plus ou moins utilisés pour « l’argument du doute » avec de surcroît l’affirmation que l’incertitude est génératrice d’anxiété : il faut protéger le pauvre petit être. Mais de la même façon que protéger en permanence un enfant de la mise à l’épreuve corporelle ne lui permettra pas de développer sa force physique, il en va de même pour sa force psychique. Si un adulte conçoit sa responsabilité envers l’enfant principalement comme une protection contre lui-même et le monde extérieur, nous ne devrions pas être surpris que cet enfant développe une vision paranoïaque du monde, un monde qui ne ressemblera jamais à ce qu’il devrait être, un monde sur lequel en tant qu’adulte il ne pourra jamais intervenir, puisqu’il n’aura jamais travaillé ses propres capacités, puisqu’il n’aura jamais été initié à sa propre puissance. Comment quelqu’un peut-il être généreux et libre s’il n’a jamais subi l’angoisse du doute, s’il n’a pas appris à le confronter, à l’accepter, à le résoudre et même à l’aimer comme une sorte de déséquilibre qui maintient l’esprit et le garde vivant ? Le symptôme premier d’une société de consommation n’est-il pas le fait que les adultes sont plus soucieux de satisfaire leurs misérables besoins immédiats, privés et quotidiens, que de relever n’importe quel autre grand défi enthousiasmant ? Mais cette dernière attitude exige de développer une certaine confiance en soi, au fil du temps, à travers les nombreux obstacles et difficultés apparentes, et grâce à eux.
Un dernier point que nous désirons soulever sur cette question est que les enfants ont un sens plus aigu de la gratuité que les adultes : ils savent encore comment jouer divers rôles, comment faire « comme si », comment être dans l’instant, ils perçoivent plus aisément la facticité de leur comportement et se sentent pour cela probablement moins menacés que leurs aînés par le libre examen et la vérification de leurs postures et de leurs idées. Du fait de leur âge et de leur ancrage dans l’existence, les adultes ont plus à perdre et à prouver : souvent, ils craignent la mort et l’absurdité, plus qu’ils n’aiment l’authenticité, la vie de l’esprit et la mise à l’épreuve de l’intellect. En cela réside probablement la raison principale pour laquelle ils se sentent obligés de répondre aux questions des enfants, refusent ouvertement d’admettre leur ignorance sur des questions fondamentales, et imposent leur autorité de manière inconsidérée. Tout cela avec la meilleure conscience du monde, et pour le bien suprême des enfants, du moins en apparence.
Complaisance
Le troisième travers important par lequel le questionnement de l’enfant et son étonnement sont anéantis est ce qu’on pourrait qualifier de complaisance ou d’attitude condescendante. Sa manifestation la plus fréquente surgit comme une exclamation, en guise de réponse aux mots de l’enfant, qui ressemble à quelque chose comme : « Oh ! Écoute ça ! C’est trop mignon ! ». Par le mot complaisance, nous entendons à la fois une complaisance à l’égard de l’enfant et à l’égard de l’adulte lui-même, ce dernier pensé à la fois comme témoin des mots enfantins et auteur du commentaire, en son attitude paternaliste et satisfaite. Il s’agit aussi d’une complaisance envers l’enfant puisque, par facilité, nous ne lui permettons pas de s’entendre, nous ne l’encourageons pas à s’écouter réellement, à prolonger son discours, à l’expliciter, à se saisir de ses propres paroles, à en envisager les conséquences et les applications. De manière générale, l’enfant est alors principalement incité à offrir une performance, à être en représentation, à plaire à l’adulte, à être mignon, à éparpiller quelques mots dans l’espoir de quelque succès aisé, un succès qui sera acquis dans la mesure où il obtient une exclamation de satisfaction de la part de l’autorité en place. Quant à l’adulte, il se satisfait de peu puisqu’il ne prend pas la peine de penser jusqu’au bout ce qu’il a entendu. Peut-être le désir de l’enfant était-il d’exprimer quelque chose de profond et de puissant, tentative qui se trouve en un certain sens ridiculisée, en se voyant réduite à la mignardise et à la coquetterie.
Quand bien même il serait surpris ou pris au dépourvu par le rire, le sourire ou l’exclamation de l’adulte, en un second temps l’enfant sera content de son succès : la prochaine fois il essaiera de manière délibérée d’obtenir un résultat identique, plutôt que de tenter à nouveau d’exprimer quelque chose de profond, encourageant chez lui un comportement d’histrion. Le travail de l’adulte, le défi qui se pose à lui étaient de creuser, d’approfondir et de mettre au jour l’intention de l’enfant, qui était peut-être une intuition forte comme les petits peuvent en avoir, du type « le roi est nu ! ». Ou encore l’une de ces questions basiques, oubliées depuis si longtemps, si embarrassantes pour nous, du type « Pourquoi sommes-nous là ? ». La responsabilité de l’adulte doit davantage être d’inviter l’enfant à aller plus loin, responsabilité qui nécessite ouverture, réceptivité, vigilance, patience et un minimum de rigueur. Combien d’enseignants négligent trop facilement le discours de l’enfant pour ces manques très spécifiques, alors qu’une écoute attentive leur aurait fourni de précieux éclaircissements sur certaines difficultés pédagogiques, ou aurait permis d’éclairer ou de justifier certaines interprétations inattendues d’objets de connaissance. N’oublions pas que la réaction « C’est mignon ! » est l’équivalent inverse ou l’image miroir de « Tout ça n’est que charabia ! » : le sens profond est oublié dans les deux cas.
La condescendance est une attitude complexe. Pourquoi être vexé lorsque quelqu’un essaie d’être gentil ? Si vous l’accusez de ne manifester aucun respect dans sa façon de s’adresser à vous, il opposera à vos critiques sa gentillesse et ses bonnes intentions envers votre personne. Et que pourrez-vous répondre, sinon quelque chose comme « Mais tu me traites comme un enfant ! ». Les adolescents se rebellent avec colère contre cette attitude, parce qu’ils arrivent difficilement à déceler et à conceptualiser le problème que pose cette attitude, parce que prime alors le sentiment de frustration et que la colère reste le seul mode de rébellion. Mais l’enfant, lui, opère dans un mode relationnel de dépendance : la complaisance peut fort bien ne pas le gêner. Il veut principalement obtenir des manifestations d’amour et d’appréciation, il n’est pas encore trop angoissé au sujet de sa propre autonomie, du moins pas sur la question de la pensée et des idées. Aussi sacrifiera-t-il très facilement un désir d’exprimer des pensées profondes, intelligentes et passionnées, ainsi fera-t-il fi d’une intention qu’il n’est pas sûr de maîtriser, afin de simplement plaire à l’autorité en place. Il se sent davantage valorisé par ces réactions condescendantes que par la demande d’un questionnement supplémentaire ou d’une discussion avec l’adulte, à moins qu’il ne devienne plus conscient de ses capacités de penser et n’apprenne à les apprécier et à leur faire confiance. Observons le sourire permanent que certains adultes arborent comme un signal de bienvenue du discours de l’enfant : ne nous sentirions-nous pas insultés si l’on nous écoutait avec ce même sourire quasi contraint ? Le sourire fréquent, qui pour un nouveau-né comporte un sens fort et important, peut devenir un obstacle quand l’enfant grandit, quand il a besoin d’être pris au sérieux.
Aimer les enfants
Sans aucun doute, les adultes peuvent apprendre en discutant avec les enfants. En raison de leur attitude naïve, pas encore trop conditionnée, ni fermée à l’originaire, moins effrayée par les vérités générales et leurs implications, moins soucieuse de l’approbation de la société, moins calculatrice et cynique, ils peuvent produire ces trésors de sagesse et de vérité que nous, adultes, aimons tant entendre : « La vérité sort de la bouche des enfants » dit-on. Au point que ici et là quelques théoriciens érigeront sans hésitation l’enfant en véritable maître, et comme souvent lorsqu’un maître est posé sur un piédestal et glorifié, les idolâtres capituleront devant leur propre capacité à penser ; dans le cas présent, ils abandonneront leur propre capacité de se confronter à eux-mêmes et à la radicalité de la jeunesse.
Ceux-là oublient trop facilement que l’enfant lui-même ignore son enfance : on doit avoir parcouru un long chemin avant de se connaître soi-même et de connaître son entourage. L’esprit humain est malin : il est suffisamment renseigné sur lui-même pour être capable de nourrir et de flatter ses propres tendances tortueuses. Notre charmant esprit est entraîné depuis son plus jeune âge à interpréter le monde, à lui donner du sens, à adapter son langage et sa vérité afin de se sentir plus à l’aise, afin de se sentir mieux, et d’oublier sa propre faiblesse et sa mortalité. Que ce soit en n’écoutant pas l’enfant, de manière grossière ou subtile, en le faisant taire avec des réponses, en souriant ou en riant à ses mots puérils, en contemplant et en admirant son « petit soi merveilleux », en basculant dans le piège douillet de la nostalgie : un simple quart de tour de cheville sépare l’utilitarisme, le dogmatisme, le cynisme et le romantisme. Dans tous les cas, ces attitudes protègeront notre vieil être usé par l’expérience, des étincelles de génie primitif jaillissants de manière inattendue de l’inconscience de notre progéniture. Il est trop facile d’utiliser ces petits êtres et leurs éjaculations simplement pour offrir à notre soi anxieux et timoré un complément d’âme. Ne ressemblons pas à ces vieux empereurs chinois pitoyables qui avaient pour habitude de se baigner avec des douzaines d’adolescentes dans le but d’obtenir de ce bain de jouvence quelque jeunesse et quelque longévité. Nous pouvons aimer les enfants comme la dame de charité aime ses pauvres. Elle visite les taudis chaque dimanche après-midi, après le déjeuner et avant le thé, apportant quelques vêtements usés et installant deux ou trois rideaux en dentelle aux fenêtres abîmées. Elle se sent bien, tellement bien, et ce sentiment intense de chaleur et de bonne conscience la suivra tout au long de la semaine, tandis qu’elle s’emploie à ses activités mondaines, frivoles et sans intérêt. Les enfants peuvent être des esprits très provocateurs, dans la mesure où nous provoquons leur esprit. L’adulte qui se présente lui-même comme l’ « animateur » d’une discussion philosophique avec les enfants, qui ne les confronte pas à leur propre pensée en général ne se confrontera pas lui-même : s’il ne s’engage pas lui-même dans une activité philosophique, il ne pourra pas s’assurer que les enfants philosophent, ne serait-ce que parce que les enfants ignorent en quoi consiste la philosophie et ses exigences, qu’il s’agit bien de leur enseigner. Si l’adulte ne trouve pas une façon de s’engager lui-même plus profondément dans la réflexion philosophique au cours du travail en classe — un engagement qui ne prendra pas nécessairement une forme identique à celle des enfants — ceux-ci seront moins enclins à s’engager plus avant. Après tout, c’est lui l’enseignant, et si l’enseignant agit comme un spectateur, les enfants feront de même, et participeront seulement de manière formelle à l’exercice.
En général, les adultes sont contents des enfants, comme de n’importe quel autre être ou objet, lorsqu’ils obtiennent d’eux ce qu’ils attendaient. Cette affirmation semblera très dure envers ces adultes « pleins de bonne volonté ». Pourtant, peu importe la nature et la légitimité de la volonté, elle reste une volonté. Et cette volonté est diverse. Le schéma le plus classique est la volonté de voir dans l’enfant ce que nous y mettons – le retour de l’investissement -, et celle d’être satisfait en entendant l’écho de nos propres mots, de notre propre système mental. Que ce soit en l’écoutant avec une sorte de hochement de tête paternaliste, qui signifie « Vas-y petit garçon, vas-y petite fille, participe, exprime-toi, c’est bien de t’entendre parler, même si j’en sais plus que toi et je te le dirai à la première occasion. » Ou que ce soit par l’imposition plus franche et directs d’une axiologie, d’une éthique, qui sans patience aucune ne supporte aucune déviance ou hérésie. Ou encore, ce peut être en ne laissant aucun moment ni interstice pour le questionnement. Le résultat reste le même : l’adulte ne saisit pas l’opportunité de philosopher, de problématiser sa propre pensée, et par conséquent, comment peut-il induire ou encourager un processus philosophique dans l’esprit de l’enfant ? Comme pour commencer à philosopher, l’adulte doit être conscient de ses propres raisons de philosopher, a fortiori s’il veut philosopher avec les enfants. Ainsi ses élèves ne deviendront pas un quelconque refuge pour qu’il se sente mieux. Assez étrangement, devenir conscient de la vraie nature du philosopher avec les enfants passe probablement par l’aveu d’un désir égoïste de la part de l’enseignant, qui peut seulement s’accomplir en confrontant sa propre pensée avec la pensée des enfants, puisqu’ils sont dotés d’un génie naturel, mélangé à une suprême banalité, combinaison que les adultes ne sauraient par eux-mêmes produire Simultanément, nous découvrons de véritables perles, si nous sommes capables de les entendre, car nous nous sentons si puissants avec notre propre connaissance « accomplie » et nos compétences. Mais enfin, pourquoi pas, il y a de pires conditions et chemins pour philosopher !
La philosophie en maternelle
La philosophie en maternelle
Cet article est le résultat d’un travail mené par l’auteur, philosophe de formation, avec plusieurs classes de maternelle. Les divers exercices dont il est question ont été déterminés en concertation avec les instituteurs et s’effectuaient en leur présence.
1re partie : Le fonctionnement
1 – Philosopher en maternelle ?
Tentons en premier lieu de cerner en quoi une discussion avec des enfants serait philosophique. Car il ne peut s’agir que de discussion, dans la mesure où l’écrit n’est pas encore au rendez-vous. “Ne s’agirait-il pas uniquement d’une propédeutique à la philosophie, d’une simple préparation au philosopher ?” nous sera-t-il demandé. Mais en fin de compte, dans une certaine tradition socratique, le philosopher n’est-il pas en essence une propédeutique, ne consiste-t-il pas en une préparation jamais achevée ? Sa matière vive ne serait-elle pas un questionnement incessant ? Toute idée particulière n’est-elle pas une simple hypothèse, moment éphémère du processus de la pensée ?
Dès lors, philosophe-t-on moins en une ébauche du philosopher qu’au cours d’une théorisation épaisse et complexe ? L’érudit philosophe-t-il plus que ne le fait un enfant en maternelle ? Rien n’est moins sûr ; pire encore, la question est dépourvue de sens. Car si le philosopher est une mise à l’épreuve de l’être singulier, il est nullement certain que l’éveil de l’esprit critique ne représente pas un bouleversement personnel plus fondamental que les analyses savantes de notre routier de la pensée. C’est en ce sens que cette pratique se doit de s’installer très tôt chez l’enfant, à défaut de quoi il est à craindre que la vie de la pensée n’en vienne ultérieurement à se concevoir comme une opération périphérique, extérieure à l’existence, phénomène que l’on observe très souvent dans l’institution philosophique et dans l’enseignement en général.
Toutefois, admettons qu’en tentant d’installer une pratique philosophique chez les enfants en bas age, nous prenions le risque de toucher aux limites de la philosophie. N’avons-nous pas simplement versé dans le simple apprentissage du langage, dans toute sa généralité ? Ou dans quelque art minimal de la discussion ? L’ingrédient philosophique n’est-il pas ici tellement diluée que c’est se faire plaisir que d’employer encore un tel mot pour définir cette pratique pédagogique ? Prenons là aussi ce problème sous un autre angle. Demandons-nous si au contraire le fait de rencontrer des situations limites, en mettant à l’épreuve l’idée même du philosopher et sa possibilité, ne nous place pas dans l’obligation de resserrer au maximum la définition de cette activité, d’articuler sous une forme minimale et donc essentielle son unité constitutive et limitative. Autrement dit, l’émergence du philosopher ne serait-il pas par hasard la substance même du philosopher ? Cette question est celle vers laquelle semble pointer du doigt Socrate, qui à tout bout de champ, phénomène incompréhensible pour bien des érudits modernes, fait philosopher le premier venu, y compris les soi-disant ennemis de la philosophie que sont les savants sophistes, afin de nous mettre au défi en nous montrant ce qui peut être accompli. Cette banalisation extrême de la philosophie n’en devient-elle pas le révélateur par excellence, dramatisation de cette activité mystérieuse qui, à l’instar du sentiment amoureux, échappe à celui qui pense en détenir l’objet ?
En guise de point de départ de notre pratique, déterminons trois aspects de l’exigence philosophique, trois aspects qui serviront à en composer la pratique. Ces trois facettes de l’activité semblent exprimer l’exigence supplémentaire au simple exercice de la parole, comme le pratique déjà n’importe quel instituteur. Il s’agit des dimensions intellectuelles, existentielles et sociales, termes que chacun renommera comme il l’entend. L’ensemble des trois activités se résumant à l’idée de penser par soi-même, être soi-même, et être dans le groupe.
Intellectuel
– Comprendre
– Articuler cette compréhension afin d’être compris
– Proposer analyses et des hypothèses
– Argumenter
– Pratique de l’interrogation
– Initiation à la logique
– Elaboration du jugement
– Utilisation et création de concepts : erreur, mensonge, vérité, “carabistouille”
– Reformuler ou modifier sa propre pensée
Existentiel
– Découvrir et exprimer une identité au travers de ses choix et de ses jugements
– Prendre conscience de sa propre pensée
– S’interroger, découvrir et reconnaître l’erreur et l’incohérence en soi-même
– Contrôler ses réactions
Social
– Écouter l’autre, lui faire place, le respecter et le comprendre
– Se risquer et s’intégrer dans un groupe
– Comprendre, accepter et appliquer des règles de fonctionnement
– Discuter les règles de fonctionnement
3 – Les ateliers
Trois modes formules différentes de l’exercice sont utilisées, qui fonctionnent à peu près de la même manière. La principale différence portant sur le support à utiliser. Atelier sur un thème général, atelier sur texte, atelier sur film. Dans les trois cas de figure le fonctionnement repose sur le fait que l’enseignant opère en creux et non pas en plein, c’est–à-dire qu’il travaille comme un animateur plutôt que comme un enseignant. Son rôle est avant tout d’interroger les enfants, de mettre en valeur les interventions et leurs enjeux, de mettre en rapport les différentes prises de paroles, de susciter des moments philosophiques, de réguler, dramatiser ou dédramatiser le débat.
Atelier sur thème
Soit le thème est imposé par l’enseignant, pour des raisons diverses (problèmes existentiels, sociaux, ou plus directement scolaires) : Faut-il être gentil avec son copain ? Doit-on toujours obéir ? Pourquoi allons-nous à l’école ? Préférons-nous la classe ou la récréation ? Ou encore le thème peut être choisi par l’ensemble de la classe, choix et vote qui deviennent alors une partie de l’exercice, voire l’exercice en soi. Puisqu’il s’agira non seulement de choisir collectivement, mais d’argumenter sur son choix et sur ceux des autres. Dans le cas du choix par la classe, selon les niveaux, le thème peut être une phrase, mais elle se réduit souvent à un simple mot : les parents, la télévision, un animal ou un autre, le Père Noël, les voitures, etc.
Atelier sur texte
Il s’agit généralement d’une histoire, d’un conte, qui au préalable sera raconté aux enfants, de préférence au moins deux ou trois fois, afin qu’ils en retiennent le mieux possible les éléments narratifs. Lors de l’atelier, la trame de base de la discussion portera en gros sur des questions du type : “L’histoire vous a-t-elle plu, et pourquoi ?”, “Quel personnage avez-vous préféré, et pourquoi ?“. Les élèves devront à la fois articuler leurs choix, les argumenter et les comparer à ceux de leurs camarades.
Atelier sur film
Le principe est identique à celui de l’atelier sur texte, bien que le film ait en général, pour des raisons pratiques, été visionné une seule fois. Il s’agira d’articuler et de comparer différents éléments narratifs, différents rejets ou préférences de personnages, et différentes appréciations ou interprétations du film.
4 – Articuler des choix
Comme nous l’avons en partie expliqué, l’atelier commence d’emblée par une prise de risque, de la part de l’élève et de la part de l’animateur. En réfléchissant sur ses choix, en les articulant, tout en sachant qu’il devra les argumenter, voire les justifier, l’enfant prend un risque qu’il ne faut pas sous-estimer : certains n’y arriveront d’ailleurs pas. Risque d’exprimer ce qu’il pense, risque de parler devant les camarades, risque de parler devant l’enseignant, risque de ne pas pouvoir justifier ses choix, crainte de “mal faire”, etc. Pour l’enseignant, la prise de risque est d’entendre des choix et des arguments qui pourront lui sembler aberrants, inquiétants, voire faux. Sans pour autant manifester sa désapprobation ou son inquiétude. Tout en continuant son questionnement, à cet élève ou à un autre. Certains enseignants avouent leur impatience dans ce genre de situation, révélatrice d’une certaine inquiétude.
Pour dédramatiser la prise de risque auprès des élèves, l’exercice est souvent présenté comme un jeu, comparable à un autre, et l’aspect ludique doit être périodiquement rappelé, en alternance avec des moments plus sérieux. Pour les enfants qui ont du mal à exprimer leur opinion, il s’agit d’être patient, de recourir à eux de temps à autre afin qu’ils ne se sentent pas exclus, quand bien même ils ne réussissent pas à verbaliser, et à les rassurer en leur proposant de parler plus tard. L’animateur devrait veiller à ce que tous puissent s’exprimer un minimum.
5 – Ne pas répéter
L’idée d’effectuer un choix personnel constitue en soi un acte de réflexion, une prise de conscience, qui demande aux enfants un effort, à certains plus qu’à d’autres. Car il s’agit déjà de se poser consciemment la question, ce qui en maternelle n’est pas nécessairement un acquis. Pour que cet acte s’effectue, il s’agit tout d’abord ne pas tomber dans un piège : le réflexe de la répétition, très courant à cet âge. Dire comme les autres, fussent-ils les élèves ou le maître, c’est la tentation et la solution de facilité. C’est pour cette raison que dans cet exercice, il est crucial que l’animateur ne manifeste ni accord ni désaccord, tout au moins en cet aspect de la discussion. Quant au rapport avec les camarades, afin d’assurer qu’il n’y ait pas de répétition, une des règles du jeu consiste à interdire de répéter ce que quelqu’un d’autre a déjà dit, au risque d’un symbolique “mauvais point”. On observera d’ailleurs certains élèves qui tentent d’articuler différentes formulations d’une même idée afin de ne pas être sanctionnés par la règle du jeu, ce qui en soi est un mécanisme intéressant. Car il s’agira pour tous de se demander si c’est la même chose ou pas. L’animateur pourra à tout moment demander à la classe : “Est-ce que quelqu’un a déjà dit cela ?”. Et pour que la proposition soit refusée, il faudra qu’au moins un élève reconnaisse qu’il s’agit d’une réponse identique à celle de quelqu’un d’autre, qu’il devra nommer. En cas de doute, l’animateur pourra proposer une discussion et provoquer un vote sur la question. Cet élément a aussi un avantage, c’est qu’il oblige chacun à écouter et à se rappeler ce que disent les autres.
6 – Pourquoi ?
S’il est un principe fondamental qu’il s’agit d’inculquer, c’est le réflexe du pourquoi, car cet élément fondateur de la pensée et du discours donnera à la pensée et au discours sa substance. Si la notion du “pourquoi” est encore difficile en petite section, elle semble être plus ou moins assimilée en moyenne section, et largement en grande section. Le “pourquoi ?” rencontre souvent le “pasque”, un “parce que” qui est à la fois une ébauche et un obstacle à la réponse. Ici l’animateur peut demander à la cantonade si “pasque” suffit comme réponse, afin que tous s’habituent à aller au-delà de ce mot. La justification d’un choix ou d’une préférence doit devenir une habitude, un rituel, un automatisme. Si un enfant a du mal à exprimer le pourquoi de sa réponse, l’animateur pourra en un premier temps lui proposer une raison absurde, afin de provoquer une réponse plus appropriée. Par exemple si l’enfant a aimé un film drôle sans arriver à dire pourquoi, l’enseignant lui demandera si c’est parce que c’est triste et qu’il a pleuré. Cette petite provocation assiste l’enfant, lui fournit un cadre facilitant, tout en lui permettant néanmoins d’articuler sa réponse avec ses propres mots. En cas de grande difficulté, l’enseignant pourra proposer une série de réponses possibles, parmi lesquelles l’enfant en choisira une, mais ce principe du Q. C. M. devra être utilisé en dernier recours, pour éviter l’échec répété, car il fausse quelque peu la partie.
Autre piège où s’enlise le pourquoi, plus subtil : “Parce que j’aime bien”, “Parce que c’est bien”, ou autres propositions d’acabit identique. Là encore il s’agira de demander à la classe si cette réponse suffit, et dès la moyenne section, il se trouve toujours un certain nombre d’élèves qui sauront reconnaître l’insuffisance de la réponse, ce qui amène l’élève en question à tenter d’exprimer pourquoi il aime bien, pourquoi c’est bien. Comme exemples de ces raisons, s’il s’agit d’un film ou d’une histoire, on pourra préférer tel ou tel personnage parce qu’il est gentil, parce qu’il est méchant, parce que personne n’est gentil avec lui, parce qu’il est beau, parce qu’il est fort, parce qu’il est courageux, parce qu’il tue les autres, parce qu’il aide les autres, etc. On pourra aussi aimer ou ne pas aimer l’histoire parce que c’est triste, parce que c’est drôle, parce que ça fait peur, parce que c’est joli, etc., autant de réponses qui devront être ensuite comparées et confrontées.
Exemple de travail avec un enfant de moyenne section qui a du mal avec le “pourquoi ?”, lors d’une discussion à propos d’un dessert. Il a du mal car il doit imaginer et théoriser une situation dans laquelle il ne se trouve pas dans l’immédiat. Il s’agit donc de l’amener par des questions à effectuer cette démarche. (Notons au passage que le questionnement doit habituer l’élève au mode hypothétique, utilisé ici, ou à la forme négative, éléments cruciaux de la construction et de la flexibilité intellectuelles.)
Pourquoi tu veux un dessert ? Je ne sais pas.
Est-ce que c’est pour jouer ? Oui.
Est-ce que tu joues avec un dessert ? Non.
Alors, est-ce que tu veux un dessert parce que tu veux jouer ? Non.
Pourquoi veux-tu un dessert ? Je ne sais pas.
Est-ce parce que tu as soif ? Oui.
Si je te donne de l’eau, est-ce que ça te donne un dessert ? Non.
Est-ce que tu veux un dessert parce que tu as soif ? Non.
Pourquoi veux-tu un dessert ? Parce que j’ai faim.
7 – Répondre à l’autre
Comme nous l’avons évoqué lors du paragraphe sur la répétition, il s’agit d’écouter et d’entendre ce qui émerge des autres. D’une part afin de ne pas répéter ce qu’ils disent, d’autre part afin de comparer leurs réponses aux nôtres, ensuite afin de leur répondre si l’on n’est pas d’accord. Périodiquement, l’animateur demandera si tout le monde est en agrément avec ce qu’a dit untel ou untel, surtout si la proposition a un contenu original ou provocateur. Ou bien il lancera ou relancera la discussion en demandant quels sont ceux qui ont aimé et quels sont ceux qui n’ont pas aimé ceci ou cela. Ceci permet d’installer une pluralité de perspectives, une prise de conscience des oppositions, permettant (donnant lieu) à l’enfant de se situer par rapport à ses pairs, l’obligeant de fait à se distinguer du groupe ou d’une quelconque autorité, celle du maître ou celle des pairs.
L’articulation et le travail sur ces désaccords, désaccords tant sur la récapitulation de faits que sur les appréciations et jugements, incitent et entraînent l’enfant à argumenter et à justifier sa propre parole plutôt que d’en rester au “Oui ! Non ! Si ! Non !”. Cette mise en scène de la parole doit engendrer une situation de réflexion et de décrispation, ce qui offre la possibilité d’utiliser l’autre afin de revoir ses propres pensées et affirmations. En même temps, un travail sur la concentration et la mémoire s’effectue, car chacun est censé se rappeler ce que les uns et les autres ont dit, ce qui périodiquement sera vérifié et demandé par l’animateur, surtout lorsqu’il s’y trouvera un enjeu, comme celui de l’opposition ou de la répétition.
8 – Moments philosophiques
Au cours de la discussion naîtront des situations privilégiées, moments de retournement, moment de prise de conscience, moment de conversion, qui constituent le cœur de la pratique, que nous nommons “moments philosophiques”. C’est en ces moments que la parole ou la pensée ne sont plus simplement des paroles et des pensées, car ils représentent la mise à l’épreuve de l’être, moments à la foi conceptuels, libérateurs et constitutifs du soi singulier. Ils sont générés par deux types de situation. Soit lorsque l’enfant rencontre une idée contraire à la sienne, idée de préférence argumentée qui le fera hésiter ou qu’il acceptera de faire sienne après une hésitation ou une résistance plus ou moins longue et intense. Soit lorsque l’enfant hésite à répondre suite à une question qui l’embarrasse, parce qu’il prend conscience du problème posé par cette question. Peu importe alors qu’il réponde ou pas à la question, du moment qu’il en envisage un minimum les enjeux et les conséquences sur sa propre parole, particulièrement lorsque cela soulève un problème de contradiction interne dans ses propos. Devant l’embarras de l’enfant, l’enseignant lui demande “Avons-nous un problème ?” ou “Vois-tu le problème ?”. Car il s’agit d’apprendre à reconnaître un problème, à l’objectiver, à ne pas nécessairement le voir comme un moment négatif, ce qui représente une percée en soi et une grande part de la résolution. La notion de carabistouille, mot qui amuse beaucoup les enfants, s’est avérée ici porteuse. Elle qualifie une réponse dépourvue de sens, une incohérence, toute parole dont la légitimité est mise en question. La menace permanente de carabistouille invite l’enfant à émettre un jugement sur ses propres propos et celui des autres, en allégeant toutefois la portée du jugement.
Ces moments sont qualifiés de philosophique parce qu’ils sont ceux où l’enfant prend conscience d’une notion du vrai et du faux qui n’est pas déterminée extérieurement et arbitrairement, mais de manière indépendante et autonome. Car en ce moment-là il est libre d’accepter ou de refuser l’argument, nullement imposé, et il est libre de reconnaître le problème ou la contradiction posée. Il peut les reconnaître ou ne pas les reconnaître. Mais la reconnaissance de ce moment, composante cruciale du philosopher, prend des formes multiples, que l’enseignant tentera de percevoir au mieux. L’enfant peut par exemple affecter un sourire coquin parce qu’il voit le problème et ne veut pas l’admettre, ou répéter ce qu’il a déjà dit de manière drôle et peu convaincue. Il peut aussi se mettre de manière visible à dandiner sur sa chaise, manifestant ainsi perplexité et embarras. Ce peut être tout le groupe qui éclate soudain de rire en face de la contradiction. L’enfant peut aussi devenir très mécontent, se mettre à bouder, esquisser un geste de colère ou s’entêter dans ses propos initiaux d’une manière qui exprime une mauvaise foi visible. Quoi qu’il en soit, il s’agit de considérer qu’il y a une forme de reconnaissance, admise ouvertement ou non, reconnaissance qu’il faut souligner afin que chacun en profite. On peut solliciter une confirmation de l’enfant en lui demandant : “On a un problème ici, n’est-ce pas ?”. L’enseignant peut dédramatiser la situation en soulignant son aspect comique : “N’est-ce pas rigolo ?” Ou faciliter la reconnaissance en demandant à l’enfant s’il apprécie ce qui a été dit, ou bien s’il aime ce genre de question. Mais un problème reste en permanence, auquel l’enseignant se doit d’être très attentif : l’enfant ne veut-il pas ou ne peut-il pas, pour diverses raisons, effectuer le renversement qui lui est demandé ? La marge entre les deux est parfois très ténue.
Exemples : Dans une discussion sur la réalité d’un film à la télévision, un premier enfant affirme qu’un poney est vrai parce qu’il est dans la télévision et qu’il l’a vu. Un autre lui rétorque alors que si le poney était vrai, il aurait cassé la télévision parce qu’il est plus grand qu’elle. Le premier enfant est interloqué par l’argument, et l’enseignant lui demande ce qu’il en pense : l’enfant conclut par un sourire. L’enseignant lui redemande si le poney de la télévision est un vrai poney, et l’enfant répond que non.
Dans une discussion à propos d’un film, une élève dit aimer un film parce qu’elle trouve rigolo que la grande sœur tape la petite sœur. L’enseignant la questionne.
– Est-ce que tu as une grande sœur ?
– Oui.
– Trouves-tu rigolo qu’elle te tape ?
Silence. Grand sourire de l’élève.
Toute la classe éclate de rire.
2e partie : Analyse et critique
1 – Penser par soi-même
Un des résumés possibles de l’activité que nous décrivons en cet article est le principe du “Penser par soi-même”, idée chère à la tradition philosophique, que Platon, Descartes ou Kant articulent comme injonction première et fondamentale. Bien entendu, certains esquisseront un sourire à l’idée du “Penser par soi-même” à la maternelle. Nous traiterons un peu plus tard dans notre travail de ces réticences ; qu’il nous suffise d’affirmer pour l’instant que si l’on poursuit jusqu’au bout ce schéma du soupçon, on n’hésitera pas à affirmer en Terminale quand ce n’est pas à l’université – comme cela est courant – que les élèves n’ont de toute façon rien d’intéressant à dire. Pas étonnant dès lors, qu’ignorance et mépris, de soi et des autres, fassent florès.
“Penser par soi-même” signifie avant tout comprendre que la pensée et la connaissance ne tombent pas du ciel, toute armée et casquée, mais qu’elle est produite par des individus, qui ont pour seul mérite de s’être arrêtés sur des idées et de les avoir exprimées. La pensée est donc une pratique, pas une révélation. Or si l’enfant s’habitue dès le plus jeune âge à croire que la pensée et la connaissance se résument à l’apprentissage et à la répétition des idées des adultes, idées toutes faites, ce n’est que fortuitement qu’il apprendra à penser par lui-même. De manière générale, c’est l’hétéronomie plutôt que l’autonomie qui sera encouragée dans son comportement général. Une difficulté reste : comment celui qui se pose en maître, l’enseignant, peut-il inciter ou encourager l’enfant à penser par lui-même ?
Il s’agit en premier lieu de croire que la pensée se définit malgré tout comme un acte naturel, dont est doté à divers degré chaque être humain, dès son plus jeune âge. Toutefois un travail important doit s’accomplir, dont parents et enseignants ont la charge. En classe, tout exercice en ce sens consistera d’abord à demander à l’élève d’articuler les pensées plus ou moins conscientes qui surgissent et flottent dans son esprit. Leur articulation constitue la première et cruciale composante de la pratique du “penser par soi-même”. D’une part parce que la verbalisation permet une conscience accrue de ces idées et la pensée qui les génère. D’autre part parce que les difficultés dans l’élaboration de ces idées renvoient assez directement aux difficultés de la pensée elle-même : imprécisions, paralogismes, incohérences, etc. Il ne s’agit donc pas simplement de faire parler l’enfant, de le faire s’exprimer, mais de l’inviter à une plus grande maîtrise de sa pensée et de sa parole. Mentionnons au passage que si la compréhension, l’apprentissage et la récapitulation d’une leçon aident aussi à acquérir cette capacité, ce mode traditionnel de l’enseignement, livré à lui-même, encourage au psittacisme, au formalisme, à la parole désincarnée et surtout au double langage : une rupture radicale entre exprimer ce que l’on pense et tenir le discours que l’autorité attend de nous. Rupture aux conséquences on ne peut plus catastrophiques tant sur le plan intellectuel que social et existentiel.
En résumé, “Penser par soi-même” se compose de plusieurs éléments constitutifs. En premier lieu, cela signifie exprimer ce que l’on pense sur tel ou tel sujet, ce qui exige déjà de se le demander, et de préciser cette pensée afin d’être compris. Deuxièmement, cela signifie devenir conscient de ce que l’on pense, prise de conscience qui nous renvoie déjà partiellement aux implications et aux conséquences de ces pensées, d’où ébauche forcée de raisonnement. Troisièmement, cela signifie travailler sur cette pensée et cette parole, afin de satisfaire des exigences de clarté et de cohérence. Quatrièmement, cela signifie se risquer à l’autre, cet autre qui nous interroge, nous contredit, et dont nous devons assumer la pensée et la parole en revoyant et en ré-articulant la nôtre. Or il n’est aucune leçon formelle qui pourra jamais remplacer cette pratique, pas plus que les discours sur la natation ne remplaceront jamais le saut dans le bain et les mouvements dans l’eau.
2 – Penser ensemble
Une bonne partie de l’exercice de la discussion philosophique se résume à la mise en rapport de l’enfant avec le monde qu’il habite, ce que l’on pourrait appeler un processus de socialisation. Là encore on pourrait déclarer que ce processus spécifique ne distingue en rien l’exercice que nous décrivons, puisque toute activité scolaire en groupe implique une dimension ou une autre de socialisation. D’autre part, on peut s’interroger sur le rapport entre cette socialisation et la philosophie. Proposons l’idée que la dramatisation accrue du rapport à l’autre, rapport qui est central au fonctionnement de notre exercice, permet de créer une situation où ce rapport devient un objet pour lui-même. Il est plusieurs angles sous lesquels nous pouvons expliquer cela. Premièrement les règles énoncées exigent pour chacun de se distinguer des autres. Deuxièmement, elles impliquent de connaître l’autre : savoir ce qu’il a dit. Troisièmement, elles impliquent d’entrer dans un dialogue, voire une confrontation avec l’autre. Quatrièmement, elles impliquent de pouvoir changer l’autre et de pouvoir être changé par lui. Cinquièmement, elles impliquent de verbaliser ces relations, d’ériger en partie de la discussion ce qui habituellement reste dans l’obscurité du non-dit ou à la rigueur se cantonne à la simple alternance entre réprimande et récompense.
Il serait ici possible de comparer notre activité à celle du sport d’équipe, facteur important de socialisation chez l’enfant, qui aussi implique de connaître l’autre, de savoir ce qu’il fait, d’agir sur lui et de se confronter à lui. Ce type d’activité se distingue de l’activité intellectuelle classique, qui en général s’effectue seul, même lorsque l’on est en groupe. Tendance intellectuelle individualiste que l’école encourage naturellement, souvent sans que les enseignants en soient pleinement conscients, tendance qui tend à s’exacerber au fil des années, avec les nombreux problèmes que cela pose et posera, en amplifiant le côté “gagnant et perdant” de l’affaire.
L’atelier que nous décrivons ici encourage au contraire la dimension du “penser ensemble”. Il tente d’introduire l’idée que l’on pense non pas contre l’autre ou pour se défendre de l’autre, parce qu’il nous effraie ou parce que nous sommes en concurrence avec lui, mais grâce à l’autre, au travers de l’autre. D’une part parce que la réflexion générale évolue au fur et à mesure des contributions des élèves à la discussion. L’enseignant devra d’ailleurs périodiquement, au cours de l’atelier, récapituler les diverses contributions importantes qui donnent cadre et forment à la discussion. D’autre part parce que l’on apprend à profiter de l’autre, en discutant avec lui, en changeant d’avis, en le faisant changer d’avis, plutôt que de se cramponner frileusement, quand ce n’est pas rageusement, à son frileux quant à soi. Là encore, le fait que les difficultés de prise en charge des problèmes posés par un camarade ou par l’enseignant fassent partie de la discussion, aide à dédramatiser la crispation individuelle et encourage l’enfant à raisonner plutôt qu’à avoir raison. Mentionnons au passage que ce genre de crainte, non traitée, engendre des difficultés majeures, de plus en plus visibles au cours des années d’école, sans parler des répercussions chez l’adulte. Si dès les premières années l’enfant s’habitue à penser en commun, il apprend à la fois à assumer une pensée singulière, à l’exprimer, à la mettre à l’épreuve de celle des autres, à profiter de la pensée des autres et à faire profiter les autres de la sienne. La dimension philosophique consiste donc à faire que l’enfant prenne conscience des processus de pensée individuels et collectifs, des obstacles épistémologiques qui réfrènent la pensée et son expression, en verbalisant ces freins et ces obstacles, en les érigeant en sujet de discussion.
Un dernier argument en faveur de ce processus accru de socialisation de la pensée est que l’inégalité des chances entre les enfants apparaît très tôt, dès la maternelle, où il est visible que certains enfants n’ont pas du tout l’habitude de la discussion. Indépendamment de la relative facilité ou difficulté individuelle de discuter, l’enseignant s’aperçoit qu’il est des enfants qui ne sont pas fondamentalement surpris que l’on veuille discuter avec eux, alors que d’autres semblent ne pas comprendre du tout ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils sont invités à parler, comportements renvoyant sans doute au contexte familial. Pour ces raisons, la parole, qui devrait être source d’intégration et de socialisation, devient source de ségrégation et d’exclusion.
3 – Difficultés, critiques et commentaires
Il est difficile de distinguer difficultés de l’exercice et critiques de l’exercice, pour des raisons qui apparaîtront au cours de l’analyse. Commençons par la remarque suivante. Après diverses interventions en maternelle, ponctuelles ou régulières, deux constats s’imposent. Premièrement, la majorité des enseignants rencontrés ne s’intéressent pas tellement à ce genre de pratique, en tout cas pas suffisamment pour souhaiter en comprendre ou en observer au moins ponctuellement le fonctionnement. Ceci pour des raisons très diverses sur lesquelles nous ne spéculerons pas ici. Deuxièmement, la majorité des instituteurs ayant assisté à l’atelier ne souhaitent pas se risquer eux-mêmes à ce genre d’exercice. Non pas qu’ils ne considèrent pas utile, voire constructif ou nécessaire ce type de pratique, mais simplement parce qu’ils ne se sentent pas à même de la mener, ce que plusieurs avouent très naturellement. Ayant plus de données sur ce deuxième cas de figure, nous nous risquerons à une analyse.
Les premières objections des enseignants, les plus formelles, portent sur les qualifications spécifiques de l’animateur qui démontre l’exercice, qu’ils déclarent différentes des leurs : “Nous ne sommes pas philosophes”. Ils expliquent cette différence de capacité par un problème de formation : “Nous n’avons pas été formés à cela”. Ou par un décalage de compétence : “Le philosophe est habitué à aller jusqu’au bout des choses, à creuser plus profondément”. “Je n’approfondirai pas : c’est le danger de notre métier”. “C’est votre seconde nature de répondre à des questions par des questions. Cette gymnastique vous est propre. Ce n’est pas le cas pour tout le monde.” “Vous trouvez du sens partout, je ne sais pas si j’y arriverai.”
Un deuxième type d’argument porte sur la rupture, sur la contradiction entre le travail habituel de l’instituteur et ce type d’exercice, sur le changement dans le rapport entre enseignant et élève. “D’habitude je dois mettre ma casquette de gendarme et là je dois leur demander ce qu’ils pensent de ceci ou de cela”. “Il me semble difficile de faire ce que vous faites, car il n’ont pas le même comportement avec vous qu’avec moi. Vous insistez, et avec vous ils n’osent pas se plaindre.” “L’enseignant doit construire une discipline, qui exige un travail quotidien.” Or accepter que les élèves expriment librement ce qu’ils pensent sur des sujets sensibles est perçu comme une atteinte, au moins potentielle, à cette discipline. L’atelier exige un renversement que l’enseignant croit parfois dangereux ou inutile, ou encore qu’il ne se sent pas prêt à effectuer.
Un troisième type d’argument, qui surprendra peut-être à la maternelle, est celui du temps, dans son rapport au programme scolaire. “Nous avons déjà beaucoup d’activités à mener à bien.” Ou encore, plus spécifiquement, les critiques portent sur la lenteur de l’exercice proposé. “Des fois ça n’avance pas, c’est trop lent”. L’enseignant n’entrevoit pas toujours l’exercice dans sa dimension de pratique ; il considère l’échange sous l’angle de la connaissance formelle : savoir ou ne pas savoir, plutôt que comme activité de réflexion, avec ses bégaiements, ses ratures et ses manques.
Un quatrième type d’argument porte sur la difficulté que pose l’exercice aux enfants. “Certains enfants n’aiment pas cet exercice. Dès qu’on l’annonce en classe, ils se mettent à pleurer.” Signalons au passage que parfois les classes ont été scindées, sur la base d’une participation volontaire, ce qui en général représente une division approximative de moitié. Et même parmi les volontaires, il se trouve toujours certains enfants qui refusent de participer à la discussion. De plus, l’exercice est parfois laborieux, lorsqu’un groupe est à une occasion plus apathique, à une autre plus dissipée, l’humeur et la concentration restant très aléatoires, particulièrement en petite et moyenne section. “La discussion n’avance pas.” La tentation est alors pour l’enseignant de recourir à la méthode courte, la voie directe où il explique ex-cathedra et donne lui-même les réponses. Que ce soit parce qu’il a l’impression que les enfants connaissent la réponse et ne la disent pas, ou parce qu’il pense qu’il est impossible pour eux de répondre. L’embarras de l’élève gêne quelque peu l’enseignant, qui de temps à autre ne pourra pas s’empêcher d’intervenir : “C’était trop pénible. J’ai voulu venir en aide à mon élève.” “Si c’était moi, je risquerais de donner la solution.” Un soupçon pèse ici: celui du facteur traumatisant de l’exercice. Ce même soupçon qui portera l’enseignant à éviter par exemple les contes avec une certaine portée dramatique et existentielle, pour favoriser le “gentillet”, alors que les premiers portent plus naturellement à la réflexion que les seconds.
Un cinquième type d’objection est celui de la vérité : que fait-on du critère du vrai et du faux ? Cette objection recoupe la première : celle du “changement de casquette”. Car l’enseignant peut se sentir floué par le relativisme au moins apparent qui s’installe dans de telles discussions : que faire de réponses fausses qui perdurent au travers de la discussion, par un effet de mimétisme ou de psittacisme, fréquent chez les petits ? L’imagination débordante ou le désir de faire le pitre peut l’emporter facilement sur la mémoire et le souci de véracité. Ainsi lors de la discussion à propos d’un film ou d’une histoire, lorsqu’un enfant raconte un passage ou importe un personnage qui n’a rien à voir avec le sujet traité, et que d’autres, amusés, continuent sur la lancée. Mais c’est précisément là que l’animateur doit jouer son rôle, et au travers de ses multiples questions inviter les élèves à distinguer l’imagination et le raisonnement, la mémoire et l’envie de s’amuser. C’est là que se trouve l’enjeu de l’exercice, et non pas dans l’obtention d’une bonne réponse. Or la prise de conscience passe par l’articulation de l’erreur, une erreur qu’il s’agit de ne pas craindre car elle est porteuse de sens. L’erreur est productive car elle manifeste les difficultés de l’élève et montre son fonctionnement, ce qui permet à l’enseignant d’évaluer mieux la situation. D’autre part elle laisse une marge de manœuvre à l’autonomie de l’élève, considération trop souvent oubliée, aux conséquences ultérieures dramatiques. Il n’est qu’à observer comment bon nombre d’élèves de lycée ne se posent plus la question de leur rapport à la matière enseignée, ayant gommé la part de subjectivité dans l’apprentissage.
Sixième objection, reliée à la précédente : celle des principes à inculquer, le dilemme de la morale imposée. Que faire lorsqu’un jugement ou une idée qui nous paraît inadmissible emporte clairement le soutien de la majorité des élèves ? Problème d’autant plus crucial que les premières années d’école constituent justement le moment et le lieu où se posent les premières bases de l’éducation et de la vie en société. Que faire lorsqu’une opinion sur un sujet donné s’installe, contraire aux principes que l’enseignant essaie d’inculquer ? Prenons comme exemple le cas d’une discussion sur le fait de rapporter ou pas les mauvaises actions des autres. Après quelques avis contradictoires, les enfants semblent se rallier au moins temporairement à l’idée qu’il ne faut pas rapporter. Commentaire de l’enseignant “J’avais vraiment envie de bondir. Si vous n’aviez pas été là je l’aurais fait. Vous vous rendez compte des conséquences dans la cour de l’école, avec ce qui s’y passe !”. Le problème est ici de savoir si la morale s’impose ou si elle doit se fonder en raison, avec le côté aléatoire de celle-ci. Certes certains principes ou règlements peuvent être considérés non négociables. Mais il ne faut pas occulter le danger du double discours : le discours de la classe, destiné à faire plaisir aux autorités, superposé artificiellement à celui de l’extérieur, plus sincère mais inavouable. Ce hiatus, tout à fait courant, pose de nombreux problèmes, tant sur le plan social qu’intellectuel. Solution de facilité qui privilégie l’immédiat au détriment de l’éducation à long terme. Ne serait-ce que parce que le rapport à l’autorité s’installe comme un rapport factice et mensonger. Pourtant, ce type d’atelier n’exclut pas la parole du maître. D’une part parce qu’il questionne, ce qui n’est pas dénué d’importance. D’autre part, rien n’empêche en un deuxième temps de revenir sur la discussion et de traiter en profondeur et en connaissance de cause les arguments invoqués par les élèves.
4 – Comparaison des sections
L’école maternelle regroupe trois âges dont les fonctionnements diffèrent de manière importante. Il est clair qu’entre les trois sections nous ne sommes plus dans les mêmes cas de figure. Dans notre expérience en petite section, il s’est avéré pratiquement impossible d’installer des discussions avec une classe entière ou même en demi-classe. Les élèves ne se sentent pas directement concernés, n’osent pas répondre, ou disent la première chose qui leur traverse la tête, ce que les voisins s’empressent de reprendre en chœur. Toutefois, un exercice plus poussé de discussion sera réalisable et trouvera son sens en petits groupes de trois ou quatre élèves, avec bien entendu les restrictions pratiques que cela pose. Une discussion relativement argumentée peut dès lors s’installer, où les élèves s’écoutent et se répondent. Néanmoins, étude que nous n’avons pas eu le temps de mener à bien, il est possible que seule une minorité puisse à cet age mener d’emblée ce genre d’activité. Or c’est sans doute sur cette disparité à la base qu’il s’agirait de travailler. Cependant, si l’on veut mener à bien des exercices en groupes plus nombreux, il en est un qui fonctionne à peu près. Il consiste à choisir au travers du groupe le sujet à débattre (un mot), le personnage préféré d’un film ou d’une histoire, etc. Les enfants font eux-mêmes des propositions, argumentent plus ou moins, et le tout se termine par un vote.
La notion de carabistouille, mot qui amuse beaucoup les enfants, s’est avérée intéressante. Elle qualifie une réponse dépourvue de sens, une incohérence, toute parole dont la légitimité est mise en question. La menace permanente de carabistouille invite l’enfant à émettre un jugement sur ses propres propos et celui des autres, en allégeant toutefois la portée du jugement.
En moyenne section, le problème du fonctionnement de groupe se pose déjà nettement moins, néanmoins le demi-groupe s’impose (une douzaine d’élèves). Les règles de base fonctionnent assez bien : demander la parole en levant le doigt et attendre son tour, répondre aux questions de manière appropriée, émettre des hypothèses et des jugements, se souvenir de la parole des autres et y répondre, etc. Toutefois, certaines séquences restent totalement improductives car l’humeur n’y est pas, par passivité ou par dissipation, situations où il semble très difficile de redresser la barre. D’autre part, une proportion encore conséquente d’élèves se refusent à parler ou ne tentent pas de répondre aux questions. Peut-être faudrait-il les prendre à part, séparés de ceux qui manient déjà assez bien l’exercice.
En grande section, il semble adéquat d’affirmer que tout élève devrait pouvoir participer à la discussion, bien que la demi-classe semble encore s’imposer. Toutefois certains éléments se démarquent très nettement par la qualité de leurs interventions. L’idée du “pourquoi ?” et de l’argumentation, indispensable à l’exercice, est globalement bien intégrée. Les élèves comprennent en gros leurs arguments mutuels et se rappellent à peu près de qui a dit quoi. Il est assez enthousiasmant d’observer le fonctionnement d’un groupe d’enfants de cet âge qui pendant quarante-cinq minutes débattent d’un sujet donné, s’écoutent et se répondent tout en acceptant d’admettre que l’autre a peut-être raison. Bien des adultes pourraient profiter d’un tel spectacle.
5 – Les parents
Les parents expriment des réactions assez diverses face à un tel projet. Certains d’entre eux n’apprécient pas tellement l’idée car ils partent du principe que l’enfant est un enfant, qu’il est donc trop petit pour être impliqué dans ce genre de pratique. D’autres sont carrément méfiants. Leur inquiétude est en partie liée à la crainte de ce que l’enfant pourra dire, car on le fera parler sur des sujets “personnels” : que dira-t-il de ses parents ? D’autres, plutôt enthousiastes, sont très demandeurs de retours sur le comportement de leur enfant dans ces discussions. D’autant plus que certains voient dans cet exercice une possibilité d’évaluation, ce dont ils se plaignent de manquer.
Quant aux effets rapportés par eux, ils sont assez éclairants. Certains enfants ont parlés de l’atelier à la maison, d’autres non. Mais quoi qu’il en soit, il semblerait que l’installation du questionnement systématique soit un acquis assez important. Plusieurs parents mentionnent l’accentuation très nette de l’utilisation du “pourquoi ?” dans le discours de l’enfant, et le désir de discussion. “Maintenant, chaque fois que nous allons au cinéma, j’ai le droit à des commentaires en sortant.” “À table, de temps à autre il lève son doigt et dit que c’est à lui de parler.” “J’ai dit à la maîtresse que depuis qu’il fait cet atelier il semble vouloir raisonner sur toutes sortes de choses.” Disons quand même afin de tempérer l’analyse, que ce petit sondage a été effectué auprès des parents dont l’enfant participait assez activement à l’atelier. Afin d’être plus rigoureux, il aurait fallu effectuer une analyse plus conséquente, ce qui n’a guère été possible jusqu’ici pour diverses raisons, mais serait souhaitable.
6 – Trop tôt et trop tard
Au-delà de savoir si ce type exercice est utile ou pas, il est vrai que l’on peut se demander si l’enseignant est à même d’effectuer le basculement en question dans sa propre classe. Cela pose un véritable problème, en maternelle comme en d’autres classes. En général, traditionnellement, lorsque l’enseignant utilise le questionnement comme outil de travail, il est clair pour les élèves que l’on veut arriver à la “bonne réponse”, avec l’implication que toute mauvaise réponse sera d’une manière ou d’une autre sanctionnée. Comment arriver soudain à installer une situation ouverte ? Est-ce souhaitable ? Peut-on passer naturellement d’un rôle en plein à un rôle en creux ? Faudrait-il systématiquement faire appel à un intervenant extérieur ? Ce sont des questions sur lesquelles, au-delà de nos convictions propres, à ce point il nous paraît ardu de trancher. D’autre part peut-on toujours demander à des enfants d’effectuer des choix, et surtout d’en rendre compte, en exigeant des raisons, des explications, un langage plus précis, en insistant lourdement sur certains mots utilisés, en entrant dans le détail de ses réponses, en analysant le sens et la structure de ce que chacun énonce ? Peut-on aussi demander à un enfant de cet âge de parler en attendant son tour, avec la frustration que cela implique, au risque de ne plus se rappeler ce qu’il avait à dire ? Ne risque-t-on pas au travers de ces exigences formelles d’inhiber la parole de tous ceux qui ont déjà du mal à s’exprimer? N’est-ce pas un peu tôt pour “obliger” des enfants à élaborer la parole plutôt que d’exprimer un discours plus intuitif ? Un travail sur la conscience et la rationalité n’est-il pas prématuré en maternelle ?
Il est vrai que dès cet âge de grandes disparités sont observables. Disparités encore plus saisissantes en maternelle que plus tard en Terminale par exemple, où une sélection partielle a déjà été effectuée. Car s’il est des enfants pour qui discuter avec un adulte, réfléchir et exprimer ses propres idées sont des actes qui semblent aller de soi, il en est d’autres pour qui un tel échange pose un véritable problème. Que ce soit pour des raisons d’ordre psychologique, telles que la timidité, ou pour des raisons plutôt intellectuelles, il semble parfois impossible d’engager le dialogue. Certains enfants paraissent ne pas entrevoir du tout ce que l’on attend d’eux lorsqu’on les interroge. N’est-ce pas déjà là qu’il s’agit d’intervenir ? Autant de questions que soulève l’exercice que nous proposons.
Toutefois, n’ignorons pas que le questionnement n’est pas neutre : il est nécessairement source de conflits. Platon relate que Socrate, l’insatiable questionneur, fut exécuté sous prétexte qu’il pervertissait la jeunesse et introduisait de nouveaux dieux. Cela est compréhensible, dans la mesure où toute société se fonde et s’organise sur une bonne part d’arbitraire, un arbitraire de refus de repenser lui-même : il a trop à perdre. Questionner, c’est défier ; questionner, c’est provoquer. Pourtant, les textes pédagogiques officiels, sans aborder le sujet de la philosophie à la maternelle ou au primaire, prônent les situations ouvertes où l’élève doit être amené à s’exprimer. (Notons toutefois que la Belgique ou le Brésil tendent à systématiser la philosophie à l’école primaire.) Mais qu’est-ce qui empêche souvent que ces directives soient mises en œuvre ? Rien d’autre sans doute que nos propres habitudes. La question est donc : quand, où et à quel âge faudrait-il commencer à oser penser par soi-même, à oser parler pour soi-même, à oser parler aux autres ? A quel âge est-il trop tard ? Là est l’enjeu de notre affaire.